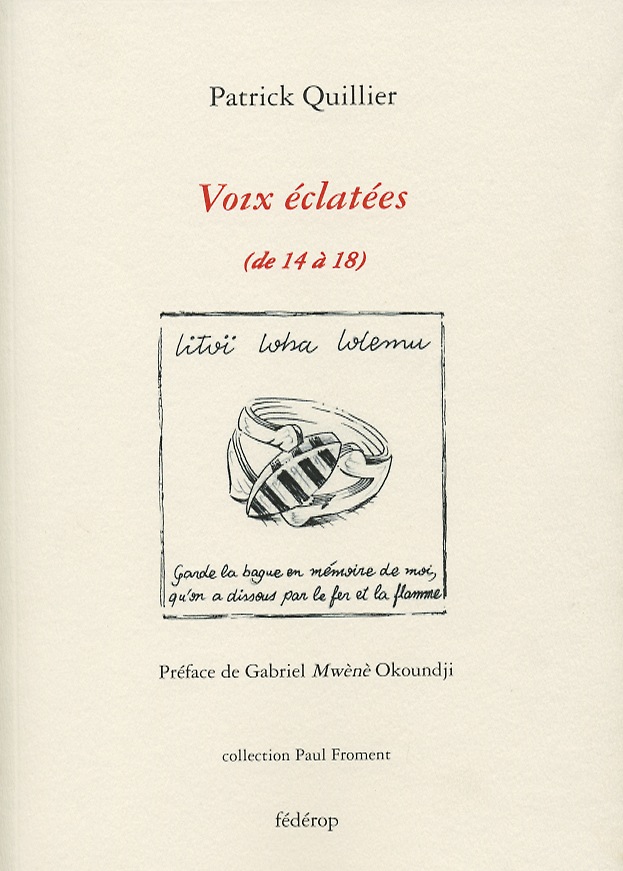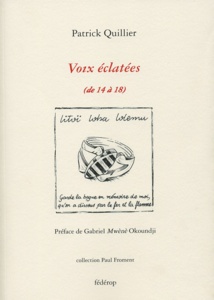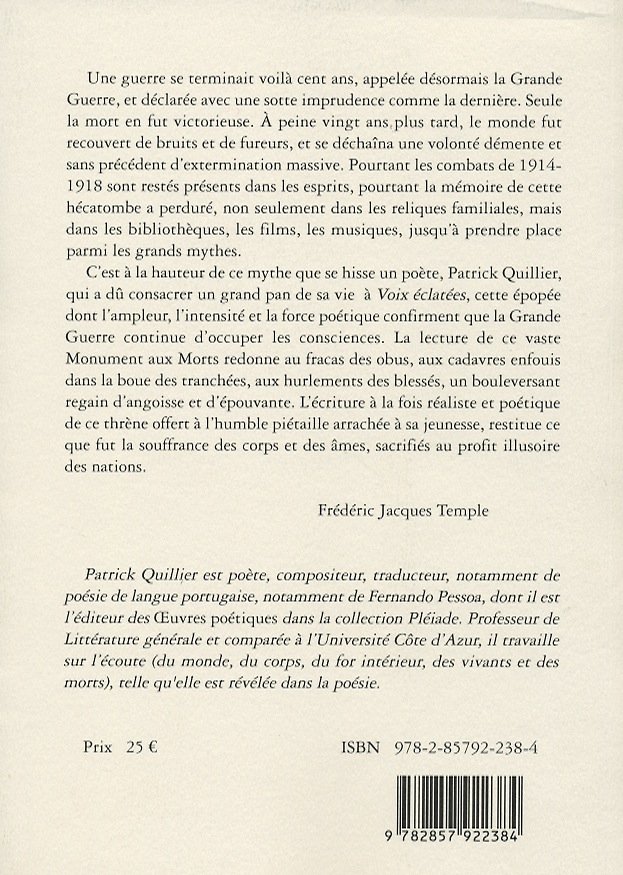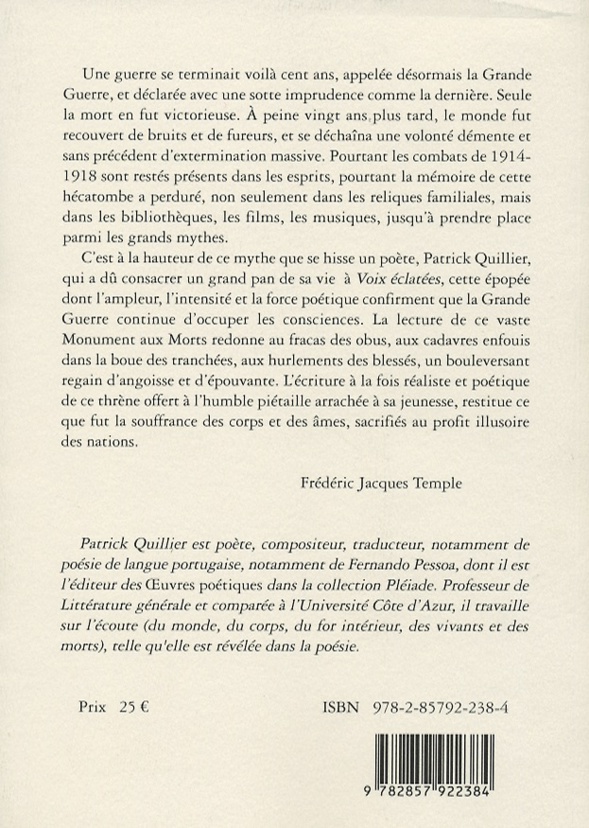BIOBIBLIOGRAPHIE

Patrick Quillier a longtemps erré en Europe, Afrique, Océan Indien, notamment comme enseignant de Lettres Classiques au Portugal, en Autriche, en Hongrie. Depuis 1999 il enseigne la Littérature Générale et Comparée à l'Université de Nice. Traducteur et éditeur de Fernando Pessoa en Pléiade, il a traduit des poètes portugais et hongrois contemporains. Le premier vers de son recueil Office du murmure (1996, Éditions de la Différence) évoque « toute une tentation de ténèbres », non pour revendiquer une posture hermétique, mais par référence aux « leçons de ténèbres » de la musique baroque, dans lesquelles l'inévitable travail du deuil se fait œuvre de vie. Le murmure est pour lui le modèle du poème et de la musique, répétition tremblée de la force fragile du vivre, inlassable ostinato de liberté et de révolte. Voix ténue qu'on n'entend guère, si ce n'est grâce à une fine écoute. Il espère que cela est sensible non seulement dans ses poèmes et ses compositions musicales, mais aussi dans ses articles, préfaces et essais universitaires. Il tente de donner à entendre cela dans les performances de ses poèmes, réalisées seul ou en contrepoint avec le musicien traditionnel Sérgio Morais.
Publications :
Poésie :
Office du murmure, Éditions de la Différence, 1996
Orifices du murmure, Éditions de la Différence, 2010
Voix éclatées (de 14 à 18), Éditions Fédérop, juin 2018
En préparation :
D’une seule vague (épopée des épopées)
Publications :
Poésie :
Office du murmure, Éditions de la Différence, 1996
Orifices du murmure, Éditions de la Différence, 2010
Voix éclatées (de 14 à 18), Éditions Fédérop, juin 2018
En préparation :
D’une seule vague (épopée des épopées)
EXTRAITS DE "VOIX ÉCLATÉES (DE 14 À 18) Editions Fédérop, juin 2018
LES TRAITS DU FILS AÎNÉ DE GASTON SCHNEGG
Pierre-Guillaume, son fils de 20 ans,
le 17 avril 17, caporal
au 41ème régiment
d’infanterie coloniale, au Chemin
des Dames, disparaît à l’ennemi.
Lui, Gaston, le père, ami de Rodin,
ne cesse de voir, dans ses cauchemars
mais aussi quand, les yeux ouverts, il fixe
la vie simple et banale autour de lui,
la face effrayée du fils stupéfait
devant l’éclair de l’explosion qui va
l’anéantir.
C’est cette face-là,
les yeux exorbités, la bouche bée,
un cri figé resté gelé en gorge,
qu’il sculpte à Quinsac, sur le monument
aux morts.
Ainsi, le visage du fils
sort de la colonne, au-dessus d’un coq
qui chante victoire et qui chante gloire.
Et donc au-dessus de l’image pieuse,
c’est la vision même qui le poursuit
qu’il représente, son fils au dernier
moment de sa vie, au saisissement
inouï d’une horreur indescriptible.
Seul le visage fasciné d’un jeune
homme pouvait nous faire ressentir
une émotion de nature indicible.
Seuls les traits de son fils aîné pouvaient,
figurés dans la pierre, apprivoiser
quelque peu la douleur, sans la dompter,
cette douleur d’un père exaspéré.
Et seuls ces traits, avec cette expression
d’ange foudroyé, à tout jamais peuvent
nous donner à penser.
Qu’appelle-t-on
penser, si ce n’est bien entendre en soi
ce qu’un face-à-face avec la beauté
assassinée fait retentir sans fin,
là-même où le nous triomphe du moi,
là-même où de l’amour nous avons faim ?
DEUX GREFFÉS : UN RÉCIT ÉNIGMATIQUE
Le 17 mars 1917,
à l’hôpital militaire du Grand
Palais, on procède à la tentative
d’une greffe osseuse sur deux soldats
mutilés. Lorsque la lueur oblique
du couchant traverse les carreaux de
leur porte-fenêtre et vient caresser
sur leurs lits de douleur leur deux visages,
le plus âgé remonte sa chemise,
découvrant son nombril et sa poitrine,
peau frémissante et glabre, à la chaleur
douce d’un soleil déjà printanier.
Ses jambes sont bandées, et là opère,
il y met tout le poids de son espoir,
une silencieuse chimie de vie.
Le plus jeune s’est accoudé, non sans
peine, au rebord d’un lit articulé,
d’où il laisse pendre, pliée, sa jambe
droite, elle aussi bandée, du pied jusqu’au
dessus du genou. La tête posée
à la renverse sur un gros coussin,
il laisse la lumière scintiller
sur son profil perdu, l’air épuisé,
les traits sereins pourtant. Sa main pianote
une valse-musette sur sa cuisse
droite (la gauche n’est plus qu’un moignon),
comme pour anesthésier la douleur,
comme pour encourager les cellules
du greffon à se lancer dans la danse,
à s’entrelacer, s’épouser, s’étreindre,
se féconder. Dans sa tête pourtant
la musique est mélancolique et tourne
à l’obsession dans un mode aigre-doux.
L’odeur de pharmacie les enveloppe
tous deux, qui se sentent flotter très loin,
très haut, très allégés, au creux de limbes
qui les ramènent tendres à l’enfance.
Faible chaleur du soir, fine lumière
en aura transparente sur leurs fronts,
effluves lents et lisses des produits
qui font dans l’air flux et reflux de souffles
s’immisçant dans le silence, l’esprit
des deux greffés réinvestit leurs corps
avec délicatesse, avec prudence,
comme si une paix pouvait venir
en armistice singulier avant
la paix qui soulagerait les armées,
la vraie paix générale, universelle,
la paix qu’ils n’ont jamais cessé d’aimer.
Qu’adviendra-t-il de ces deux-là, cobayes
consentants et reconnaissants de la
faculté acculée à progresser
devant tant de souffrance et tant d’horreur ?
Nous laisserons ici l’issue ouverte.
Nous resterons devant cette photo
que la faculté des deux à fait prendre
dans le soleil du soir, pour ses archives.
Nous resterons devant cette photo,
paralysés par la fraternité
qui nous unit à ces deux mutilés,
fragiles survivants d’une curée
dont nous ne savons toujours pas jauger
l’impact irrémédiable sur le monde.
Tôt ou tard ils mourront et nous mourrons,
précédés par des millions d’agonies
brutales ou interminables, des
morts données par l’homme et par son génie
prédateur qui invente toujours plus
d’armes de destruction universelle.
Tôt ou tard ils mourront et nous mourrons,
c’est ce que dit comme toute photo
cette photo d’archive, et cependant
plus que d’autres photos ce cliché-là
semble suspendre un bref moment le flux
irrépressible qui nous bouleverse
et nous entraîne à la mort tard ou tôt.
Nous sommes tous greffés sur la photo.
Nous frémissons du friselis de la
lumière chaude du couchant, sentons
les pas de la valse-musette des
cellules sur la piste des chimies
mystérieuses de la vie, flottons
en compagnie de ces deux-là, aux limbes
d’une enfance perdue qui nous revient.
Et telle la couronne d’un corymbe
une atmosphère d’émotions sans fin
unit morts et vivants en communion.
LA NOSTALGIE SANS FIN D’ULYSSE LHOMME
(Extraits)
Il éclaire d’abord un porte boîte
d’allumettes formant la couverture
bien ouvragée d’un livre relié
avec méthode et soin. C’est dans du fer
de récupération, morceau de tank
sans doute, que l’ouvrier appliqué
a travaillé, réalisant cette œuvre
dans la patience et la méditation.
« Je suis Jean Lepetit de Francarville.
J’ai eu des ancêtres Parfaits cathares.
Je faisais office de maréchal-
ferrant dans mon village et mon enclume
au dernier coup de mon marteau donnait
le soir venu le signal du repos
pour tous. Et voilà qu’à présent je gis
dans le repos d’une fosse commune. »
Ulysse, recueilli, touche le livre
de métal d’un doigt léger, caressant,
respectueux. Dans son for intérieur,
il promet à Jean un je-ne-sais-quoi
plein de douceur, mais qu’il serait en peine
de définir, s’il avait à le dire.
*
Une bague en aluminium scintille
sous l’éclairage ému du luminaire.
Au niveau du chaton l’anneau se scinde
en deux pour soutenir un bel ovale
posé en oblique sur des rebords
élargis en forme de petits ronds.
L’ovale est traversé de 5 rayures
de cuivre qui évoquent l’abdomen
des abeilles. Tout le long de l’anneau
ces trois vocables ont été gravés,
minuscules, d’une main minutieuse :
litoï loba lolemu. Les 5
traits de cuivre orangé font résonner
en Ulysse Lhomme quelques symboles
qui ont le chiffre 5 pour signature.
Tandis qu’une douleur telle un éclair
traverse tout son corps puis disparaît,
sur une pierre il dépose sa torche.
Sa main droite saisit la bague et la
fait glisser, elle s’y ajuste, autour
de l’annulaire gauche, et le voilà,
Ulysse, ayant repris sa torche, qui
l’oriente vers l’abeille bienveillante
et de sa main soudain fait un essaim
en quête d’un miel qui n’a pas de nom.
« Je suis Jean Malamba de Brazzaville.
J’ai toujours entendu les voix du monde,
bourdonnement riche d’enseignements.
Tu pourrais m’appeler griot, djéli, mvet,
géwal ou maabe. Mais peu importe
le nom qu’ici ou là on donne à ceux
qui comme moi font à leurs congénères
le récit de la vie. Appelle-moi
Jean Mwènè Malamba, tu comprendras
qu’en moi c’est l’oreille qui parle et dit
la langue, quelle qu’elle soit, de toute
chose et de tout être dans l’univers
que tout être et toute chose ont reçue
en partage. Je suis venu de loin
défendre la terre des tes ancêtres
car rien n’est loin dans la géographie
de l’esprit, tes aïeux et mes aïeux
ont respiré dans les mêmes matins
du monde un même oxygène naissant.
Abeilles, coccinelles, sphinx, lucioles,
Lucanes, doriphores, téléphores,
agrions, cercopes, sphex, scarabées,
eumènes, grillons, cérèses, criquets…,
tous les insectes savent ça, écoute
dans leur rumeur les archives des mondes.
Garde la bague en mémoire de moi,
qu’on a dissous par le fer et la flamme
dans l’air évanescent où l’homme vit. »
Plus que jamais Ulysse a la ferveur
de qui doit traverser un lot d’épreuves
afin de retrouver ses vrais appuis.
Le bruissement est plus fort, de son cœur.
*
C’est une canne en bois sculpté qui s’offre
alors au faisceau de la torche. Ulysse
s’en saisit et touche avec émotion
le serpent qui, comme un caducée,
s’entrelace à la canne, sans son double
pourtant, ce qui intrigue et préoccupe.
En haut sa tête semble menacer
le chef casqué d’un poilu hérissé.
Ulysse caresse le bois, se trouble
infiniment de la surface douce
si finement polie dans sa patine.
« Je suis Jean Barrelel de Pouvourville.
J’ai des aïeux qui labouraient les pentes
de ces coteaux en surplomb de Garonne.
J’ai moi aussi labouré cette glaise
tout en sculptant des sortes de fétiches
en écoutant les beaux récits d’un oncle
qui avait vécu à La Réunion
et me parlait d’un vieil ami à lui,
créole, assis sur le seuil d’une case
en tôle, et travaillant pendant des heures
du bois tropical, tout en racontant
des histoires du temps d’il y a longtemps.
Mais qui contera mon sort lamentable ? »
Ulysse en réponse embrasse la canne
et dit en pensant devenir oiseau
ou cobra ailé :
« J’accepte ton offre,
très cher Jean Barrelel de Pouvourville :
je serai ton conteur, marquant le rythme
des récits grâce à ce bâton sculpté
que je conserve en mémoire de toi. »
DE LA GRANDE GUERRE À LA GRANDE MÈRE
(extrait)
chant lézardé ravagé torsadé
zébré cassé brassé cambré courbé
grevé dévasté plombé aheurté
brisé abouté arcbouté bouté
chant d’oiseaux affolés chant d’oiseaux pris
au piège chant de chiens chant de chevaux
chants des prés chants des taillis chants des arbres
chant de la guerre en terre de la guerre
en mère de la mère en guerre en terre
chant de terre-mère de terre-guerre
chant de mère-terre de guerre-terre
chant de mère-guerre de guerre-mère
chant-insti-tueur chant-instituteur
chant-insti-tué pas institué
chant-insti-tuant insistant tuteur
insis-tué insis-tuant huant
ululant hurlant pupulant poignant
pas aguerri oh non pas aguerri
amer amer amer amer amer
aptère aptère aptère aptère aptère
— Romain Rolland contre la « religion
du cadavre. » — Dorgelès dénonçant
l’édulcoration et l’escamotage
de la violence : « On a amené hier
le corps broyé d’un soldat, mais demain
repartira un héros de légende. »
— On a donné le nom de Rosalie,
la rose, l’alliée, la douce amie,
à la baïonnette réglementaire,
l’amie de l’hallali, de la curée,
de l’étreinte étroite entre deux morts-nés,
celle qui aux tranchées nous fera taire.
mais chant qui écherra aux échéances
pas aguerri oh non pas a-guéri
au risque d’échouer dans ses errances
au risque de chuter dans la souffrance
chant que dicteront les chevaux les chiens
les oiseaux les taillis les prés les arbres
dépouillement du chant aux échancrures
de ses haillons aux distorsions de ses
maillons aux tremblements de la raison
chant de x à b chant de o à a
de la scie qui tronçonne à l’oraison
de la scie qui poursuit l’esprit saisi
chant qui fait le paon sur un pan de ruine
chant du grand pan le mort sur tout l’empan
d’une mélancolie qui se déploie
phénoménologie sans origine
sans téléologie sans espérance
et pourtant malgré tout tout comme si
Oui, reprendre les fragments déformés,
Les ranimer, les faire retentir
À nouveau, les faire à la fois neufs et
Veufs de leur auteur, archéologie
De l’éclat des voix éclatées, paroles
Volantes comme autrefois mais volées,
Soustraites à l’envol de leur syntaxe,
Dérobées à la tire, à la volée,
Par un hermès soucieux de pharmacie,
De phorminx et de lyre, et les voilà,
Ces voix, volant tant bien que mal sur la
Scansion déhanchée de vers de dix pieds,
Dansant en ce temps-là jusqu’à extase.
GOULES DES VOIX DANS LES OURLETS DE TERRE
DES OURLETS DE TERRE AUX HOULES DES VOIX
DE LA GRANDE MÈRE À LA GRANDE GUERRE
MAIS LA TERRE TOUJOURS RECOMMENCÉE
Pierre-Guillaume, son fils de 20 ans,
le 17 avril 17, caporal
au 41ème régiment
d’infanterie coloniale, au Chemin
des Dames, disparaît à l’ennemi.
Lui, Gaston, le père, ami de Rodin,
ne cesse de voir, dans ses cauchemars
mais aussi quand, les yeux ouverts, il fixe
la vie simple et banale autour de lui,
la face effrayée du fils stupéfait
devant l’éclair de l’explosion qui va
l’anéantir.
C’est cette face-là,
les yeux exorbités, la bouche bée,
un cri figé resté gelé en gorge,
qu’il sculpte à Quinsac, sur le monument
aux morts.
Ainsi, le visage du fils
sort de la colonne, au-dessus d’un coq
qui chante victoire et qui chante gloire.
Et donc au-dessus de l’image pieuse,
c’est la vision même qui le poursuit
qu’il représente, son fils au dernier
moment de sa vie, au saisissement
inouï d’une horreur indescriptible.
Seul le visage fasciné d’un jeune
homme pouvait nous faire ressentir
une émotion de nature indicible.
Seuls les traits de son fils aîné pouvaient,
figurés dans la pierre, apprivoiser
quelque peu la douleur, sans la dompter,
cette douleur d’un père exaspéré.
Et seuls ces traits, avec cette expression
d’ange foudroyé, à tout jamais peuvent
nous donner à penser.
Qu’appelle-t-on
penser, si ce n’est bien entendre en soi
ce qu’un face-à-face avec la beauté
assassinée fait retentir sans fin,
là-même où le nous triomphe du moi,
là-même où de l’amour nous avons faim ?
DEUX GREFFÉS : UN RÉCIT ÉNIGMATIQUE
Le 17 mars 1917,
à l’hôpital militaire du Grand
Palais, on procède à la tentative
d’une greffe osseuse sur deux soldats
mutilés. Lorsque la lueur oblique
du couchant traverse les carreaux de
leur porte-fenêtre et vient caresser
sur leurs lits de douleur leur deux visages,
le plus âgé remonte sa chemise,
découvrant son nombril et sa poitrine,
peau frémissante et glabre, à la chaleur
douce d’un soleil déjà printanier.
Ses jambes sont bandées, et là opère,
il y met tout le poids de son espoir,
une silencieuse chimie de vie.
Le plus jeune s’est accoudé, non sans
peine, au rebord d’un lit articulé,
d’où il laisse pendre, pliée, sa jambe
droite, elle aussi bandée, du pied jusqu’au
dessus du genou. La tête posée
à la renverse sur un gros coussin,
il laisse la lumière scintiller
sur son profil perdu, l’air épuisé,
les traits sereins pourtant. Sa main pianote
une valse-musette sur sa cuisse
droite (la gauche n’est plus qu’un moignon),
comme pour anesthésier la douleur,
comme pour encourager les cellules
du greffon à se lancer dans la danse,
à s’entrelacer, s’épouser, s’étreindre,
se féconder. Dans sa tête pourtant
la musique est mélancolique et tourne
à l’obsession dans un mode aigre-doux.
L’odeur de pharmacie les enveloppe
tous deux, qui se sentent flotter très loin,
très haut, très allégés, au creux de limbes
qui les ramènent tendres à l’enfance.
Faible chaleur du soir, fine lumière
en aura transparente sur leurs fronts,
effluves lents et lisses des produits
qui font dans l’air flux et reflux de souffles
s’immisçant dans le silence, l’esprit
des deux greffés réinvestit leurs corps
avec délicatesse, avec prudence,
comme si une paix pouvait venir
en armistice singulier avant
la paix qui soulagerait les armées,
la vraie paix générale, universelle,
la paix qu’ils n’ont jamais cessé d’aimer.
Qu’adviendra-t-il de ces deux-là, cobayes
consentants et reconnaissants de la
faculté acculée à progresser
devant tant de souffrance et tant d’horreur ?
Nous laisserons ici l’issue ouverte.
Nous resterons devant cette photo
que la faculté des deux à fait prendre
dans le soleil du soir, pour ses archives.
Nous resterons devant cette photo,
paralysés par la fraternité
qui nous unit à ces deux mutilés,
fragiles survivants d’une curée
dont nous ne savons toujours pas jauger
l’impact irrémédiable sur le monde.
Tôt ou tard ils mourront et nous mourrons,
précédés par des millions d’agonies
brutales ou interminables, des
morts données par l’homme et par son génie
prédateur qui invente toujours plus
d’armes de destruction universelle.
Tôt ou tard ils mourront et nous mourrons,
c’est ce que dit comme toute photo
cette photo d’archive, et cependant
plus que d’autres photos ce cliché-là
semble suspendre un bref moment le flux
irrépressible qui nous bouleverse
et nous entraîne à la mort tard ou tôt.
Nous sommes tous greffés sur la photo.
Nous frémissons du friselis de la
lumière chaude du couchant, sentons
les pas de la valse-musette des
cellules sur la piste des chimies
mystérieuses de la vie, flottons
en compagnie de ces deux-là, aux limbes
d’une enfance perdue qui nous revient.
Et telle la couronne d’un corymbe
une atmosphère d’émotions sans fin
unit morts et vivants en communion.
LA NOSTALGIE SANS FIN D’ULYSSE LHOMME
(Extraits)
Il éclaire d’abord un porte boîte
d’allumettes formant la couverture
bien ouvragée d’un livre relié
avec méthode et soin. C’est dans du fer
de récupération, morceau de tank
sans doute, que l’ouvrier appliqué
a travaillé, réalisant cette œuvre
dans la patience et la méditation.
« Je suis Jean Lepetit de Francarville.
J’ai eu des ancêtres Parfaits cathares.
Je faisais office de maréchal-
ferrant dans mon village et mon enclume
au dernier coup de mon marteau donnait
le soir venu le signal du repos
pour tous. Et voilà qu’à présent je gis
dans le repos d’une fosse commune. »
Ulysse, recueilli, touche le livre
de métal d’un doigt léger, caressant,
respectueux. Dans son for intérieur,
il promet à Jean un je-ne-sais-quoi
plein de douceur, mais qu’il serait en peine
de définir, s’il avait à le dire.
*
Une bague en aluminium scintille
sous l’éclairage ému du luminaire.
Au niveau du chaton l’anneau se scinde
en deux pour soutenir un bel ovale
posé en oblique sur des rebords
élargis en forme de petits ronds.
L’ovale est traversé de 5 rayures
de cuivre qui évoquent l’abdomen
des abeilles. Tout le long de l’anneau
ces trois vocables ont été gravés,
minuscules, d’une main minutieuse :
litoï loba lolemu. Les 5
traits de cuivre orangé font résonner
en Ulysse Lhomme quelques symboles
qui ont le chiffre 5 pour signature.
Tandis qu’une douleur telle un éclair
traverse tout son corps puis disparaît,
sur une pierre il dépose sa torche.
Sa main droite saisit la bague et la
fait glisser, elle s’y ajuste, autour
de l’annulaire gauche, et le voilà,
Ulysse, ayant repris sa torche, qui
l’oriente vers l’abeille bienveillante
et de sa main soudain fait un essaim
en quête d’un miel qui n’a pas de nom.
« Je suis Jean Malamba de Brazzaville.
J’ai toujours entendu les voix du monde,
bourdonnement riche d’enseignements.
Tu pourrais m’appeler griot, djéli, mvet,
géwal ou maabe. Mais peu importe
le nom qu’ici ou là on donne à ceux
qui comme moi font à leurs congénères
le récit de la vie. Appelle-moi
Jean Mwènè Malamba, tu comprendras
qu’en moi c’est l’oreille qui parle et dit
la langue, quelle qu’elle soit, de toute
chose et de tout être dans l’univers
que tout être et toute chose ont reçue
en partage. Je suis venu de loin
défendre la terre des tes ancêtres
car rien n’est loin dans la géographie
de l’esprit, tes aïeux et mes aïeux
ont respiré dans les mêmes matins
du monde un même oxygène naissant.
Abeilles, coccinelles, sphinx, lucioles,
Lucanes, doriphores, téléphores,
agrions, cercopes, sphex, scarabées,
eumènes, grillons, cérèses, criquets…,
tous les insectes savent ça, écoute
dans leur rumeur les archives des mondes.
Garde la bague en mémoire de moi,
qu’on a dissous par le fer et la flamme
dans l’air évanescent où l’homme vit. »
Plus que jamais Ulysse a la ferveur
de qui doit traverser un lot d’épreuves
afin de retrouver ses vrais appuis.
Le bruissement est plus fort, de son cœur.
*
C’est une canne en bois sculpté qui s’offre
alors au faisceau de la torche. Ulysse
s’en saisit et touche avec émotion
le serpent qui, comme un caducée,
s’entrelace à la canne, sans son double
pourtant, ce qui intrigue et préoccupe.
En haut sa tête semble menacer
le chef casqué d’un poilu hérissé.
Ulysse caresse le bois, se trouble
infiniment de la surface douce
si finement polie dans sa patine.
« Je suis Jean Barrelel de Pouvourville.
J’ai des aïeux qui labouraient les pentes
de ces coteaux en surplomb de Garonne.
J’ai moi aussi labouré cette glaise
tout en sculptant des sortes de fétiches
en écoutant les beaux récits d’un oncle
qui avait vécu à La Réunion
et me parlait d’un vieil ami à lui,
créole, assis sur le seuil d’une case
en tôle, et travaillant pendant des heures
du bois tropical, tout en racontant
des histoires du temps d’il y a longtemps.
Mais qui contera mon sort lamentable ? »
Ulysse en réponse embrasse la canne
et dit en pensant devenir oiseau
ou cobra ailé :
« J’accepte ton offre,
très cher Jean Barrelel de Pouvourville :
je serai ton conteur, marquant le rythme
des récits grâce à ce bâton sculpté
que je conserve en mémoire de toi. »
DE LA GRANDE GUERRE À LA GRANDE MÈRE
(extrait)
chant lézardé ravagé torsadé
zébré cassé brassé cambré courbé
grevé dévasté plombé aheurté
brisé abouté arcbouté bouté
chant d’oiseaux affolés chant d’oiseaux pris
au piège chant de chiens chant de chevaux
chants des prés chants des taillis chants des arbres
chant de la guerre en terre de la guerre
en mère de la mère en guerre en terre
chant de terre-mère de terre-guerre
chant de mère-terre de guerre-terre
chant de mère-guerre de guerre-mère
chant-insti-tueur chant-instituteur
chant-insti-tué pas institué
chant-insti-tuant insistant tuteur
insis-tué insis-tuant huant
ululant hurlant pupulant poignant
pas aguerri oh non pas aguerri
amer amer amer amer amer
aptère aptère aptère aptère aptère
— Romain Rolland contre la « religion
du cadavre. » — Dorgelès dénonçant
l’édulcoration et l’escamotage
de la violence : « On a amené hier
le corps broyé d’un soldat, mais demain
repartira un héros de légende. »
— On a donné le nom de Rosalie,
la rose, l’alliée, la douce amie,
à la baïonnette réglementaire,
l’amie de l’hallali, de la curée,
de l’étreinte étroite entre deux morts-nés,
celle qui aux tranchées nous fera taire.
mais chant qui écherra aux échéances
pas aguerri oh non pas a-guéri
au risque d’échouer dans ses errances
au risque de chuter dans la souffrance
chant que dicteront les chevaux les chiens
les oiseaux les taillis les prés les arbres
dépouillement du chant aux échancrures
de ses haillons aux distorsions de ses
maillons aux tremblements de la raison
chant de x à b chant de o à a
de la scie qui tronçonne à l’oraison
de la scie qui poursuit l’esprit saisi
chant qui fait le paon sur un pan de ruine
chant du grand pan le mort sur tout l’empan
d’une mélancolie qui se déploie
phénoménologie sans origine
sans téléologie sans espérance
et pourtant malgré tout tout comme si
Oui, reprendre les fragments déformés,
Les ranimer, les faire retentir
À nouveau, les faire à la fois neufs et
Veufs de leur auteur, archéologie
De l’éclat des voix éclatées, paroles
Volantes comme autrefois mais volées,
Soustraites à l’envol de leur syntaxe,
Dérobées à la tire, à la volée,
Par un hermès soucieux de pharmacie,
De phorminx et de lyre, et les voilà,
Ces voix, volant tant bien que mal sur la
Scansion déhanchée de vers de dix pieds,
Dansant en ce temps-là jusqu’à extase.
GOULES DES VOIX DANS LES OURLETS DE TERRE
DES OURLETS DE TERRE AUX HOULES DES VOIX
DE LA GRANDE MÈRE À LA GRANDE GUERRE
MAIS LA TERRE TOUJOURS RECOMMENCÉE
EXTRAITS DE ORIFICES DU MURMURE Éditions de la Différence, 2010
5 sonnets tirés de
Orifices du murmure, Éditions de la Différence, 2010
Amour, tu m'as ourlé sur moi-même, en la trame
du murmure louré dont tu moules ma vie,
et je t'ai entouré à mon tour au glacis
chaleureux de ces mots, amour, d'où vont nos flammes.
Tu m'as brûlé, amour, dans ton regard de femme
flamme et d'homme océan, par la même alchimie
qui m'a sacré ton mage aérien, ton amie
tellurique – et le chant se hausse de nos gammes.
Faiseur de sortilège au creux de l'athanor
argileux du poème, ou sirène à vertige
dans l'envol des vocables, amour, je cherche l'or
que tu ourdis, épouse mer, homme incendie,
dans tes yeux, marées, braises: amour, ma voix y court,
vocalise accueillant l'entrelacs de nos jours.
***
Ta voix survient toujours en tournoyant:
elle se joue, comme un surfeur filant
sa vague, des tourbillons, des spirales
qui fendent l'air et font danses ou râles
où je pourrais périr sous trop d'émois.
Ta voix n'est pas suprême ni profonde,
ne fond pas sur moi comme sur sa proie
un aigle terrible, et ne sourd, par ondes
débordantes, menaces de noyades,
d'aucun antre secret où veillerait
une chimère. Elle est ta voix, nomade
pacifique et fidèle, où se parfait
un contrepoint transparent et subtil.
À ta voix je tiens comme sur un fil.
***
Non, je ne parle pas de chimères, d'objets mis en facteur
x ou z, de spectres figuraux ou d'alchimie.
Il existe des nœuds gordiens dans le poème, certes,
et des trous noirs, et des irisations incontrôlables.
Mais c'est de l'arc-en-ciel naissant dans ton regard que monte
le rayonnement sourd dont les mots s'auréolent; et l'ombre
qui se porte aux abords du langage n'est pas un puits
mais un miroir sans tain dont nos surfaces jouent, mains, dos,
joues, cuisses, lèvres, cous; quant aux spirales qui vont nouant,
chiasmes ou asyndètes, tant d'émotions, métaphores,
symboles, c'est autour de nos peaux qu'elles courent, ô toi
l'unique monstre de ces vers, leur seul objet de culte,
et le visage nécessaire qui les hante, et l'orage
qui précipite le réel dans l'enclos de mes jours.
***
Curieux du sort et de l'essor
dont chaque corps tire son or,
curieux des cieux et des essieux
dont les yeux orientent leurs lieux,
curieux des lyres, des délires,
dont nos dires s'ornent de rires,
curieux des sons et des frissons
que nos façons fêtent chansons,
curieux des excès, des réflexes,
dont nos sexes sont les silex,
curieux des bris et des critères
dont nos cribles trient nos cris verts,
déraisons, sanglots, hurlements,
nous sont tropes, étincelles, élans.
***
Amour, tu as roulé sur nous la vague même
du murmure écumant dont s'enivrent nos vies,
et si nous emmurons tout le tour du glacis
minutieux des sonnets, amour, c'est stratagème:
nous y brûlons, amour, aromates et gemmes
jusqu'au cri, jusqu'au sang, afin que l'alchimie
qui nous massacre en nous consacrant trois amis
cristallins aboutisse à des perles, et les sème.
Amour, vous nous lisez quand nous vous écrivons
dans l'agile vertige étrange où nous jetons
les fables, les vocables, amour, de cet essor
qui nous ourdit, vous étourdit, à tous assure
que l'espace qui suit, ouvert aux aventures
de l'émoi pluriel, n'est pas encore la mort.
Orifices du murmure, Éditions de la Différence, 2010
Amour, tu m'as ourlé sur moi-même, en la trame
du murmure louré dont tu moules ma vie,
et je t'ai entouré à mon tour au glacis
chaleureux de ces mots, amour, d'où vont nos flammes.
Tu m'as brûlé, amour, dans ton regard de femme
flamme et d'homme océan, par la même alchimie
qui m'a sacré ton mage aérien, ton amie
tellurique – et le chant se hausse de nos gammes.
Faiseur de sortilège au creux de l'athanor
argileux du poème, ou sirène à vertige
dans l'envol des vocables, amour, je cherche l'or
que tu ourdis, épouse mer, homme incendie,
dans tes yeux, marées, braises: amour, ma voix y court,
vocalise accueillant l'entrelacs de nos jours.
***
Ta voix survient toujours en tournoyant:
elle se joue, comme un surfeur filant
sa vague, des tourbillons, des spirales
qui fendent l'air et font danses ou râles
où je pourrais périr sous trop d'émois.
Ta voix n'est pas suprême ni profonde,
ne fond pas sur moi comme sur sa proie
un aigle terrible, et ne sourd, par ondes
débordantes, menaces de noyades,
d'aucun antre secret où veillerait
une chimère. Elle est ta voix, nomade
pacifique et fidèle, où se parfait
un contrepoint transparent et subtil.
À ta voix je tiens comme sur un fil.
***
Non, je ne parle pas de chimères, d'objets mis en facteur
x ou z, de spectres figuraux ou d'alchimie.
Il existe des nœuds gordiens dans le poème, certes,
et des trous noirs, et des irisations incontrôlables.
Mais c'est de l'arc-en-ciel naissant dans ton regard que monte
le rayonnement sourd dont les mots s'auréolent; et l'ombre
qui se porte aux abords du langage n'est pas un puits
mais un miroir sans tain dont nos surfaces jouent, mains, dos,
joues, cuisses, lèvres, cous; quant aux spirales qui vont nouant,
chiasmes ou asyndètes, tant d'émotions, métaphores,
symboles, c'est autour de nos peaux qu'elles courent, ô toi
l'unique monstre de ces vers, leur seul objet de culte,
et le visage nécessaire qui les hante, et l'orage
qui précipite le réel dans l'enclos de mes jours.
***
Curieux du sort et de l'essor
dont chaque corps tire son or,
curieux des cieux et des essieux
dont les yeux orientent leurs lieux,
curieux des lyres, des délires,
dont nos dires s'ornent de rires,
curieux des sons et des frissons
que nos façons fêtent chansons,
curieux des excès, des réflexes,
dont nos sexes sont les silex,
curieux des bris et des critères
dont nos cribles trient nos cris verts,
déraisons, sanglots, hurlements,
nous sont tropes, étincelles, élans.
***
Amour, tu as roulé sur nous la vague même
du murmure écumant dont s'enivrent nos vies,
et si nous emmurons tout le tour du glacis
minutieux des sonnets, amour, c'est stratagème:
nous y brûlons, amour, aromates et gemmes
jusqu'au cri, jusqu'au sang, afin que l'alchimie
qui nous massacre en nous consacrant trois amis
cristallins aboutisse à des perles, et les sème.
Amour, vous nous lisez quand nous vous écrivons
dans l'agile vertige étrange où nous jetons
les fables, les vocables, amour, de cet essor
qui nous ourdit, vous étourdit, à tous assure
que l'espace qui suit, ouvert aux aventures
de l'émoi pluriel, n'est pas encore la mort.