CLAUDE BER: EFFRACTION:DIFFRACTION:MOUVEMENT REVUE CITÉ N° 73
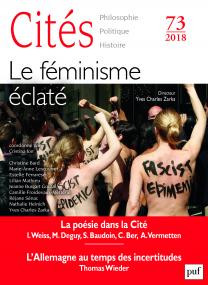
EFFRACTION/DIFFRACTION/MOUVEMENT
Claude Ber
Revue Cités n° 73
1- Rencontre
La brume sur Paris. Son gris entre les pas et la ville. Vers où elle et les genoux pliés qui l’arpentent ? Le poète dans la Cité ? Où peut-il être hormis là. Avec, toujours avec.
Que la Cité accueille le poète ou le bannisse, qu’elle l’écoute ou reste sourde à sa parole, qu’elle l’encense ou le méprise, que lui-même choisisse de s’en écarter ou de plonger dans la mêlée de l’engagement, il en demeure indissociable. Pas de poète ni de poème hors d’elle et de son histoire.
Rencontre. Le poème, une « poignée de main » disait Celan. Indissociablement lié aux autres, à l’autre, supposant, appelant le regard qui le lit, la voix qui le remet en corps, l’interprétation qui déploie ses lectures, n’existant que d’être recueilli, visité, revisité. Sans cet accueil du poème qui le rend visible, il n’est que virtuellement poème. Le poème hors de la Cité, hors relation, n’est pas.
Pas de poète s’il n’est dit tel par d’autres. Dans un statut mouvant, de la reconnaissance immédiate ou posthume à l’oubli où sombrent aussi bien le méconnu que le favori de la mode. Figures oscillant au gré de désamours et de redécouvertes, de purgatoires, d’enfers ou de panthéons ponctuant sa rencontre avec la Cité.
Rencontre. Qui croise cycliquement l’histoire collective quand Liberté de Paul Eluard fait écho à la Résistance, quand le « Debout la négraille !» de Césaire inaugure avec Senghor la parole de la négritude, quand le poème d’Ingrid Jonker cité par Mandela lors de son investiture joue rôle d’étendard, quand, pendant le printemps arabe, la foule tunisienne scande les vers d’Abou el Kacem Chebbi mort en 1934 « Si le peuple décide de vivre un jour / Force est au Destin de répondre ». Et tant d’autres rencontres, contemporaines de l’ouvrage ou différées.
Rencontres éclatantes du poète et d’un peuple. Ou plus cachées, plus singulières. Dans le tête-à-tête silencieux du livre et du lecteur, de la voix et de l’oreille. Au secret de l’intime de ceux et celles qu’il accompagne.
2- Diffraction
« Le poète dans la Cité » ? Invite au constat, au manifeste implicite, à la réflexion théorique ? La question aimante les trois et se diffracte.
Poètes et Cités sont pluriels, leurs relations varient. Selon les époques, les cultures, les formes du politique et du poétique. Même dans le cercle étroit d’un ici et maintenant réduit à la poésie française contemporaine, les postures divergent. Dès qu’on le quitte pour une Cité planétaire à la fois maillée par les réseaux inter-nautiques, mondialisée par la spéculation financière et pulvérisée en microcosmes identitaires, l’écart est grand entre un Darwich indissociable de la destinée du peuple palestinien et la poésie textuelle déclarant la mort de la poésie ou ne la concevant qu’autotélique. Le débat théorique sur le poète et la Cité éclate dans le pluriel des poètes et des cités pris dans une histoire, y compris littéraire par rapport à laquelle une écriture travaille en échos et écarts. « Il ressort de la poésie, de la littérature, des discours, qu’il n’y a pas d’essence, seulement une historicité. Une histoire des historicités. Seulement des individus. C’est ce que les œuvres nous apprennent à lire. » (Meschonnic)
Sur les rayons de la bibliothèque des colonnes de livres. À décliner relations et postures, le poète sortirait d’eux en vates doté sinon de pouvoirs magiques du moins de celui de ressusciter le réel dans la langue, en officiant des exploits olympiques quand l’ode pindarique participait à la liesse festive du komos, en aède célébrant l’épopée mythique de la Cité ou déplorant ses malheurs, en invité aux Jeux Floraux de Clémence Isaure célébrant la fine amor au trobar clus et au trobar leu, en fabuliste et satiriste dans la lignée de Juvénal et de La Fontaine comme en courtisan du Prince, en « pâtre promontoire » (Hugo) éclairant l’avenir des peuples, en « phare » (Baudelaire) témoin de notre humanité, en « voyant » (Rimbaud) tourné vers l’exploration d’une intériorité dédoublée non seulement en « je est un autre », mais en multiples hétéronymes à la manière d’un Pessoa dans le miroitement d’une identité rien moins qu’univoque et toujours « intranquille », en chantre de la liberté insurgé contre toutes les tyrannies et subvertissant les codes sociaux de la langue, en praticien de cette dernière attaché à fabriquer un objet de langage sans autre but que lui-même quand « ce n’est pas avec des idées qu’on écrit des poèmes, c’est avec des mots » (Mallarmé), en spéléologue de « l’espace du dedans » (Michaux), en « passant rien de plus » (Si Mohand U Mand) interrogeant notre énigme ou claudiquant en quête d’une vérité ontologique nichée au cœur de la parole, en huissier attaché au constat d’un réel jamais saisissable hors des mots qui le parlent et le pensent, prenant « le parti pris des choses » (Ponge) ou à « la poursuite passionnée de la Réalité » (Milosz), en explorateur de l’imaginaire, de l’inconscient surréaliste et des confins du langage, en « suicidé de la société » (Artaud) arrachant bribes de sens à la barbarie bégayante de l’histoire, « cette éternelle répétition et ce beau nom de l’horreur » (Borgès), etc. etc. etc. Et ces et cetera en précaution contre simplifications et généralisations comme en rappel de l’historicité du poème contre une sacralisation de ce dernier et un essentialisme de la poésie.
Et ce d’autant plus qu’aucun poème n’est l’illustration d’une poétique. Qu’une œuvre et même un seul poème mêle plusieurs de ces postures et les excède. Que théories et arts poétiques comme les controverses qui les accompagnent, ont rôle d’aiguillon, mais ni ne déterminent les œuvres ni n’en font le tour. La pratique poétique dépasse les injonctions. « La meilleure façon de savoir ce qu’est la poésie est de lire des poèmes. » soulignait salutairement Zukofsky. Le poème ne vit que de déjouer ses définitions et les rôles qu’il endosse, d’être ouvert à des interprétations recommencées et d’une actualité qui ne se confond pas avec celle de sa publication.
Il faut renoncer au panorama et serrer au plus près une expérience subjective, qui, comme toute démarche artistique s’élabore au carrefour d’une individualité, d’une culture et d’une époque dans lesquelles elle émerge et sinon d’une universalité du moins d’une commune « espèce humaine » pour reprendre l’expression d’Antelme.
S’écarter, autant que possible, du discours surplombant. À la fois dans la conscience d’une complexité disproportionnée à la mesure d’un article comme par manière de rappeler que le discours sur le poème n’est pas le poème. Qu’il prive, dès l’orée, de la possibilité de dire ce qui ne se dit qu’en poésie et par elle. À défaut d’écrire en poésie, s’en tenir au fragment, convoquer un brouhaha de voix, entre lesquelles se glisse la mienne, comme un signe vers la pluralité du poème, qui brise l’ambition totalisante du dissertatif, travaille par éclats et retours, se diffracte, ne cessant, mon propos, de tourner et retourner sur lui-même à quelque zodiaque de la parole et au temps qu’il décline comme revient le poème sur ce que « parler veut dire ». Car c’est autour de la parole, du statut et des enjeux de la langue que se noue le rapport du poète et de la Cité.
3- Effraction
Le poème fait usage « non ustensilitaire » de la langue disait Artaud. Retournant le langage, sur une redondance et une attention à lui-même dans ce versus, ce retour de la charrue en bout de sillon, qui le met originellement sous le signe du retour sans l’obliger pour autant à l’aller à la ligne. Conscience « de ce que parler veut dire » pour citer de nouveau Mandelstam, mallarméen « sens plus pur donné aux mots de la tribu », réactivation du langage, du lien aux autres et au monde à travers quelque parole réanimée, qui, d’une manière ou d’une autre, vise le réveil des yeux habitués à voir et des oreilles déshabituées d’entendre, cela se dit multiplement.
Déjà le mythe d’Orphée n’est que retournements. Retournant à ces enfers dont le mystère d’après mort réplique le sans mot d’avant vie, se retournant sur Eurydice, Orphée ne cesse de se retourner quand Œdipe va de l’avant, basculant dans l’abîme et le père et le Sphinx pour finir par errer sur les chemins jusqu’à Athènes, où il sera rédimé. Ces figures ne s’épuisent pas à la distinction entre la prose qui déplie dans son prorsus et le poème qui replie, elles n’en esquissent qu’une schématique allégorie opposant la successivité de la narration et la logique du discours à la feuillature du poème. Différenciation à la fois pertinente et factice car le poème n’exclut ni narration ni discours. De l’épopée aux Gedankenlyric ou aux chants-pensée des Indiens Tépuhas, il fait feu de tout bois. S’il écarte, par période, et notamment dans l’histoire récente du poème français, certains de ses possibles et de ses modalités, ce n’est jamais que local, ponctuel et transitoire. Le poème est métamorphique, allant du vers rimé ou non à la prose poétique en passant par poèmes en prose et « proèmes » pongiens. C’est davantage avec le statut du signe qu’avec les frontières de genre qu’a maille à partir le poème dans sa mise en échec de la primauté du sens, auquel il ne se réduit pas. Débordant le signe et la notion de sens.
Le rythme, cet écho de la voix dans l’écrit qui fait entendre du « sujet », et la feuillature du poème, pour reprendre ce mot artisan qui désigne l’action et son résultat car le poème est à la fois une action, une pratique et un objet de langage, organisent le couche sur couche polysémique du poème, dont les multiples strates font sens en tous sens séparément et ensemble (son, rythme, disposition visuelle, images, figures…) quand le son signifie et le sens résonne. Entre énigme et clarté, le poème ne délivre pas un sens dans l’immédiat de son illusoire possession, mais œuvre multiplement au prisme de la vie, ne révélant souvent que lentement et même rétrospectivement ses virtualités.
En cela, le poème est méditation de mots, méditation sensible quand « Le sensible de la langue, ce qui tombe sous le sens, c’est l’énigme de la présence d’une voix (personne) » écrit Celan dans Meridian-materialien. Et Valéry de noter dans ses cahiers « le principe de la poésie est à rechercher dans la voix et dans l’union singulière, exceptionnelle, difficile à prolonger de la voix avec la pensée ». Qu’on la prête aux Muses, à l’inconscient, à un arbitraire de l’agencement rythmique ou du calembour à la Brisset peu importe. Elle résonne. Dans cette « atmosphère de la pensée » où, selon Kierkegaard, « nous plonge le poème » et dans autre chose qu’un comme de la pensée, qui ferait du poème une illusion ou un ersatz de la pensée. Deleuze comparant sciences, art et philosophie - « Les trois voies sont spécifiques, aussi directes les unes que les autres, et se distinguent par la nature du plan et de ce qui l’occupe. Penser, c’est penser par concepts, ou bien par fonctions, ou bien par sensations, et l’une de ces pensées n’est pas meilleure qu’une autre, ou plus complètement, plus synthétiquement pensée (…). » - suffira, ici, à placer rapidement le poème dans son rapport au sensible et à la vérité.
Ce dernier se joue dans sa matière même, le langage dans et par lequel se nomme cette « voix » sans identité – « personne » précise Celan – et pourtant audible comme le sourire sans chat du chat de Chester chez Lewis Carroll. Nettement voix et même précisément cette voix spécifique de la pensée, non asservie à une quelconque finalité, que la poésie a diversement nommée voix de l’âme, des dieux, de l’être, du monde et que l’écriture comme la lecture du poème fait entendre dans l’expérience singulière d’une parole à la jonction du rythme de la langue et du rythme de la pensée, dans une sorte d’exercice sensible de la pensée.
Réenchantement du monde, conversion du regard, inauguration d'un mode spécifique d'être et de sentir, revitalisation d’une langue usée et anémiée par la réduction à sa fonction de communication, les poètes formulent de diverses manières ce travail de la langue, qui cherche à élargir les possibles du langage se rendant par là « plus utile(s) qu'aucun citoyen de (leur) tribu » (Lautréamont), à donner présence au monde - « Là où la montagne dépasse du mot qui la désigne se trouve un poète » (Elytis) - à restaurer l’être en nous « retirant à notre vue intérieure la couche de familiarité, qui nous obscurcit la merveille de notre être » (Shelley) ou à « l’intensifier » (Bonnefoy). Il faut que ça (y compris le désir qui se love allusivement dans ces deux lettres) fasse présence par et au cœur des mots. Altéré au double sens du terme, habité par une soif inextinguible et tourné vers l’autre, y compris l’autre ou les autres de soi et de nous, le poème met du jeu dans les rouages d’une langue inerte et s’ouvre à toute altérité dans une conjonction du singulier et du commun.
En cela, le poème enjambe les limites et déplace les bornes de l’usage ordinaire et social de la langue. Provoquant surprise, perplexité et réveil de l’attention. Court-circuit. Faisant à la fois résistance et mouvement. Il y a poème quand il y a naissance, présence et court-circuit. Quand quelque chose meut et émeut dans l’é-mouvoir de l’émotion. Quand se dérègle d’une manière ou d’une autre la mécanique du signe soumis à la raison technique et à la raison d’État. Non que le poème divague, il est, à l’inverse un effort de clarté -« une œuvre [poétique] consiste essentiellement en élucidations. » (Wittgenstein) – qui élucide selon un mode qui lui est propre et qui fait effraction. Effraction de l’indécidable dans l’assurance du signe. À la question du qu’est-ce que ça veut dire, le poème répond par un ça dit ce que ça dit quand la forme informe dans une signifiance, qui outrepasse les significations. Le poème ne « veut » rien dire. Il dit. Cela est effraction. De quoi ? De ce que du je (non assimilable au moi), du nous, du monde, des choses, de nos corps, de la vie ne dit précisément que la poésie.
Le poème n’entrerait-il dans la Cité que par effraction, dans une effraction dans et par la langue ? Le poème fait, je le crois, irruption, effraction dans l’inerte et l’arraisonné de la langue. Déverrouillant, au passage, la langue stérile du discours politique ou technocratique (langue de bois engoncée dans idéologies et représentations la nomme la langue courante comme en contrepoint de la langue de chair qui habite nos bouches) et d’une communication tournée vers une compréhension immédiate et univoque, diffusant exponentiellement un minimum de sens sur le maximum de surface. Maximum de sens sur minimum de surface, pour le dire façon slogan et en référence à une intensité plus qu’à une taille car le poétique va des quelques vers du haïku ou du triolet aux milliers d’Homère, le poème est, de ce fait, antithétique des impératifs du politique. Cette effraction du poème est-elle propre à la Cité ici et maintenant ?
4- Adresse
Ce n’est qu’à la rêverie de paradis perdus du poétique et avec force entorses à son histoire que s’imagine le poète trônant au centre de la Cité. Il arrive qu’elle parle par sa voix. Ponctuellement. Dans l’imprévisible de ce qui joint cette dernière et un élan collectif. Mais le poète erre aussi dans ses bas-fonds en « poète maudit », jeté dans ses oubliettes sous les traits de Villon au pied de la potence, de Desnos déporté, de Hölderlin, d’Artaud ou de Sylvia Plath dans leur asile de fous, de Dante, de Hugo, de Pouchkine ou de Tsvetaïeva exilés, de tous et toutes les poètes fuyant, en ce moment même, fondamentalisme et dictatures, d’Hikmet et de Ritsos dans leur prison et de ceux et celles croupissant dans les geôles du Qatar ou de la Syrie tels Mohammed al-Ajami, Nazim Hamadi ou Nasser Bunduq. La liste serait longue à égrener. Et d’une immédiate actualité.
Il y a longtemps que constat a été fait de l’antinomie du poème et de l’ordre établi et il n’y a que passagèrement retrouvailles unanimes entre le poète et la Cité. Le poème habite moins l’espace que le temps. Davantage la mémoire de la Cité, qui l’exhume de sa tombe, que son hic et nunc. C’est à sa diffusion dans la durée que se mesure l’impact du poème plus marathonien que sprinter. Mais, depuis plusieurs décennies, le lamento sur le poète coupé de la Cité est récurrent. La poésie, ici et maintenant, est censée être en crise, aux marges de la Cité dans un bannissement réitérant l’exclusion platonicienne du poïein, qui marque l’imaginaire occidental.
Il est, de fait, relégué à l’écart des grands circuits médiatiques et semble sinon quasi invisible du moins confiné à des cénacles restreints. Mais n’y-a-t-il pas, là, à la fois mirage d’un âge d’or du poème et un de ces constats censément de réalité qui modèlent cette réalité ? N’y-a-t-il pas quelque sophisme à affirmer que la poésie ne fait pas audience quand on ne lui en donne quasi aucune ? Que le poème ne trouve plus de lecteurs quand tout relai d’importance auprès du lectorat a disparu ? À qui, d’ailleurs, s’adresse le poème ? À un public ou à un peuple dans une rencontre où les deux ont part ? À tout le monde ou à n’importe qui ?
Le poème relève de l’intime comme du collectif, parfois même du national dans l’enjeu politique de la langue, de l’intériorité comme de l’histoire, jaillit au croisement des deux, mais n’est pas tourné vers un public quand ce terme désigne le destinataire d’une culture non pas populaire mais de masse, dont le critère est l’extension et l’indéfinie croissance.
À l’impératif d’efficacité de la communication, le poème oppose l’intensité. Si le poème est parole oblique et chargée, que cette intensité travaille dans le dépouillement ou l’excès, rien d’étonnant qu’il ait audience restreinte. Le poème ne s’adresse pas à tout le monde dans la conquête exponentielle d’une clientèle poétique ou alors à un « tous » en écho d’une espérance politique où résonne, comme dans le « poétariat » de Jean-Claude Pinson, une nostalgie ou un espoir d’émancipation universelle, il s’adresse à n’importe qui parmi tous. À chacun.
Quand la Cité du citoyen devenu client est celle du « peuple absent » et que se confondent singularité et individualisme, à qui s’adresse le poème ? Kafka faisait déjà l’hypothèse que la littérature serait peut-être « le dernier chemin vers notre prochain ». Ce mot a significativement disparu au profit du terme « autre », sans doute à cause de sa connotation religieuse, mais effaçant les notions de proximité et de succession qu’il supposait quand le prochain est à la fois le proche et le suivant. L’Autre même majuscule, l’altérité même logée au cœur du sujet comme par Levinas, retrouve-t-elle le proche et le suivant ? Le langage n’est pas innocent. C’est une des connaissances du poème. Et ni le proche ni le suivant ne sont au centre de la logique économique et politique de la Cité encore moins réceptive quand elle est planétairement traversée par des résurgences fascisantes, des régressions fanatiques et des dérives dictatoriales.
À qui s’adresse le poème ? Le poème use des pronoms. Il s’adresse à toi, à vous, à nous. Dans le singulier et le commun. Quelque « singulier quelconque » d’Agamben ? Philosophie et poésie conjuguent une gémellité dizygote. L’une dépose, l’autre témoigne… Trop vite dit, passons, à leur croisement, parfois, l’une l’autre s’éclairent et leur dialogue ne se résume pas à l’exclusion du fauteur de trouble que serait le poète. Commun et singularité donc quand une singularité ne devient « différence » que par le marquage d’un pouvoir qui l’érige en critère de distinction de droits, de traitement, de considération. Ce que le poétique oppose déjà au politique est la singularité contre l’identité et le commun contre les variations nationalistes ou mondialistes d’un collectif disqualifié par la dissolution du lien politique et social.
Quel terme qualifierait alors le poème à la fois dans sa genèse et son adresse ? L’eccéité peut-être, vocable scolastique emprunté au théologien Duns Scot, qui suppose un principe d’individuation comme ce lit, à côté de moi, sur lequel tu as dormi, sur lequel nous avons fait l’amour. C’est de ce lit particulier et de nul autre, de cette femme-là, de cet homme-là et non de l’homme ou la femme en général, de cet individu là, unique, insaisissable dans une définition ou dans des identités aussi multipliées soient-elles, qu’écrit le poème dépassant les deux termes d’identité et de différences et leur impasse vers une singularité commune reliant l’eccéité de chacun et le commun à tous. Adresse non pas « pour » ni « vers », mais avec. Sujet s’adressant à des sujets dans la réciprocité d’une adresse utopique et d’un « Tout-monde » à la Glissant? C’est mon expérience du poème. Cela est-il recevable, audible par une Cité doublement travaillée par l’uniformisation et l’identitaire ?
5- Confiteor
À qui la faute dans l’exil supposé du poème ? Essais, articles et colloques se multiplient depuis plusieurs décades, autant n’en citer aucun faute de pouvoir les citer tous. À la louche, deux coupables sont désignés : les poètes et la Cité.
Les poètes (ici et maintenant sans cesse sous-entendu car ce n’est ni toujours ni partout) seraient, selon certains, responsables de s’être retranchés dans un excès d’intellectualisme sophistiqué, ne s’adressant plus qu’à un happy few d’initiés. Déjà Milosz intentait un procès à la poésie française accusée d’appauvrissement dans un formalisme ascétique et hermétique souvent plus rhétorique et langagier qu’inspiré par quelque mystère héritier du Trismégiste et dont « le petit exercice solitaire » » entraînerait « une scission et un malentendu entre le poète et la grande famille humaine ». C’est débat récurrent, autant politique que poétique. Les querelles et points de vue reflètent l’historicité de la poésie, ses questions, ses audaces, ses impasses. Si ces affrontements théoriques, où épigones et tenants de courants antagonistes se disputent sur la définition et le rôle de la poésie, peuvent servir de carburant, ils ne me semblent pas d’une incidence décisive quand le poème est avant tout un risque renouvelé dans une réinvention de lui-même jamais finie comme dans une invention du sujet dans et par la langue. Quelles que soient esthétiques et postures, elles ne sont pas garantes du poème et son essai n’est pas toujours transformé. Parfois le poème s’égare. Ou attend son heure dans une temporalité distincte de l’immédiat et dont il n’est pas seul à décider.
Majoritairement, c’est la Cité qui est accusée d’être devenue incapable d’entendre le poème, avide qu’elle est de significations immédiatement consommables et rassurantes et non d’écritures qui la déroutent et la questionnent. Sous l’emblème de « la boite Campbell » érigée en symbole d’une contemporanéité dominée par la marchandisation, la Cité consommatrice de biens périssables et gérée par la rentabilité exclut de son achalandage ce qui dérange les plans marketing. Le poème n’est pas produit rentable, suppose une temporalité incompatible avec les impératifs du time is money, exprime et appelle un lien personnel et actif là où domine la parcellisation d’une clientèle passive.
Ce peut être, évidemment, plus finement analysé en mettant sur la sellette une domination économique et idéologique d’une puissance inégalée dépassant les formes de dictatures plus classiquement identifiables, dans lesquelles toute expression, dont celle du poète, est, cette fois, muselée sans détour. S’exprimerait une nouvelle version de la tension entre poésie – et plus largement poïein – tels qu’ils ont été amplement décrits et tout aussi largement illustrés par le tribut que les poètes exilés, assassinés, emprisonnés, d’Ovide à, de nos jours, Meyomesse, Li Bifeng, Mutis, Breytenbach en passant par bien d’autres, ont payé et payent encore à la voracité du Léviathan politique.
In fine, la poésie serait, selon la nature du pouvoir, bâillonnée de manière soft ou hard pour emprunter à l’époque sa « novlangue ». Sous le règne de « la société du spectacle » et de « l’universel reportage », le plus efficace bâillon n’est pas la censure, mais le silence. Face à l’hémorragie du sens et à la déroute de l’esprit, le poème incarnerait à la fois une ultime résistance de franc-tireur et l’affirmation têtue d’une humanité, qui est moins une donnée qu’une espérance sans cesse à inventer.
6- Déplacé
Où donc la place du poème dans une Cité, dont l’idéologie et le discours dominant dissolvent insidieusement à la fois le peuple, le citoyen et la personne ou les oppressent ouvertement ? Déplacé. Poèmes et poètes sont déplacés au sens propre et figuré. Et d’autant plus que dans leurs représentations courantes, le poète rêvasse en inconséquent amuseur ou en fabricant d’élucubrations absconses et la poésie endosse les oripeaux d’une niaiserie sentimentale sans rapport avec un réel, dont le discours idéologique et l’écosystème médiatique entre télé-réalité et scientisme de pacotille se donnent pour seuls légitimes possesseurs.
Charge exagérée ? À peine. Au contact de la « réalité rugueuse », poème et poète croulent sous leurs caricatures. Trivialités? Expérience. Dont celle, tant de fois répétée, d’inaugurations de manifestations de poésie par l’évocation de souvenirs de maternelle. Là est la place du poème. Pour les enfants. Bien sûr l’enfant et l’enfance du poème qui inaugure, nativus et matinal dans l’aube de la parole – ce peut-être aussi un cliché -, mais sûrement pas l’infantilisme ni l’infantilisation.
C’est pourtant vers elles que ses représentations poussent trop souvent le poème, vers l’insignifiance ludique. Bien sûr, le poème joue, met du jeu (bis repetita) dans la langue, desserrant l’étau de son usage politique et social – et au passage y met du « je » singulier quand le « je » n’est pas le moi ni le sujet l’égo – mais il ne se réduit pas à l’amusement, au passe-temps, au loisir quand le terme évacue la liberté de l’otium et n’en retient qu’un vide bien différent de la vacuité spirituelle.
Ces représentations poussent non seulement le poème hors de la Cité, mais hors de lui-même. Si nul enjeu vital ne réside plus en lui, pourquoi s’y intéresser? Ce discours dominant ne peut s’écarter d’un revers de main. Il pénètre partout, autant dans sa version grossière que dans des façons raffinées d’entonner le thrène de la rupture entre le poète et la Cité. Aussi bien dans l’usage dévalué du terme de poésie que dans la transmission du poème, auquel l’école comme l’université octroient une part du pauvre souvent elle-même indigente. Pas toujours bien sûr et s’indigneraient à juste titre les « passeurs de poème » qui ne le réduisent ni à la seule technique (même si la poésie l’est et même technique de pointe) ni au seul amusement (même si elle est jeu de langage et revendique une gratuité refusant d’intérioriser la norme de la rentabilité). Ces passeurs de poèmes pourraient témoigner de leur expérience comme en témoignent les poètes.
Cette dernière à la fois accrédite et dément le discours convenu. Non, pas de poète sur les plateaux télévisuels. Très peu ou pas du tout dans les grands médias, avec toujours quelques exceptions ponctuelles. Pourtant revues, lectures, sites, manifestations abondent. Même dans le maillage inter-nautique, le poème s’est faufilé entre tweets et fake news, s’accommodant de tout support, circulant aussi bien de bouche à oreille qu’en cd et podcasts, de l’estrade à youtube, sur la page comme sur l’écran. Qu’à cela ne tienne rétorque la parole autorisée, les poètes parlent aux poètes dans quelque névrotique contemplation d’eux-mêmes où se mirerait une poésie narcissique. Cela lui arrive, mais ne la résume pas.
L’objection peut se faire subtile et le poème aussi a ses cul-de-sac et ses manies d’époque, mais, à l’expérience de l’éditer, il se diffuse plus qu’on ne croit. Loin des tirages du best-seller, lentement, mais durablement. Essaimant. S’infiltrant, imprégnant peu à peu. À l’expérience de lire publiquement le poème car c’est en nomade, son livre sous le bras, que se croise aussi le poète allant de lectures publiques en performances, d’ateliers en séminaires, se dissolvent les stéréotypes. « Ce pelé, ce galeux » s’invite un peu partout et pas dans les seuls lieux dédiés à la poésie. Il est même des contrées lointaines, où il « festivale » devant quelques milliers de personnes. Contrastes, disparités. Mais, ici même, les poètes pourraient témoigner que, oui, le poème s’adresse à n’importe qui et pas à ceux et celles auxquels le préjugé présuppose qu’il s’adresse, que, oui, il est entendu et pas nécessairement par qui le mépris du plus grand nombre décrète qu’il le sera. La question est politique, le poème n’a pas de clientèle, mais parfois un peuple et des vis-à-vis de visages toujours.
Anecdotes à foison sortiraient de la besace du poète, se souvenant, par exemple, de ce matin du 18 avril 2008, où, sur le quai d’une gare de banlieue, une femme sanglotait sur un banc. « Césaire est mort ! » murmurait-elle, serrant un exemplaire du Cahier du retour au pays natal. Elle n’aurait sûrement pas fait partie du ciblage des potentiels lecteurs de poésie, mais pour elle Césaire… De ces anecdotes, les poètes en auraient tous beaucoup à raconter. Ce sont elles qui justifient d’écrire, sortent le poème des débats théoriques et le confrontent à l’inattendu de son destin.
Exemples, même nombreux, même innombrables, ne font pas preuve. Mais une représentation dominante ne vaut pas davantage vérité. Elle vaut ce qu’elle est : un discours idéologique, qui se donne pour parole de vérité et contribue à la construction d’une réalité prétendument objective. Je ne peux pas la cautionner en tant que poète comme en tant que citoyenne d’ailleurs car le poète n’est, lui-même, personne d’autre que n’importe qui. C’est, en cénacles choisis, l’équivalent des marronniers journalistiques. Il suffit de prendre le risque de donner la parole non pas seulement aux poètes, mais au poème pour s’en apercevoir. Je ne peux pas alimenter le discours convenu même si force est faite d’en constater les méfaits. Pas que sur la poésie au demeurant. Mais, abrégeons, il est presque minuit. Claudique la langue dans sa fatigue. Comme Œdipe au pied bot entre aveuglement et déraison de l’histoire. Le revoilà aède à présent, les allégories ne sont que des oripeaux, dont on se dévêt.
À se dévêtir de ses représentations et de leurs fariboles, de ses assignations et de leurs injonctions, où se trouve donc le poète ? Dans quelque anamorphose qui le révèlerait caché dans l’ombre du buisson ou derrière le pilier d’un parking souterrain ? Dans l’intériorité silencieuse de ceux et celles qui l’accueillent et pour qui il est viatique vital face à une extorsion, moyen de se réapproprier le monde et la parole face au bavardage d’une « société du spectacle » qui le réduit à la version qu’elle en donne dans une illusoire transparence mirador ?
Sur le fil peut-être. Dans une énième figure du poète, en funambule cette fois et où se dit de la place du poète dans la Cité qu’elle est avant tout risquée. Comme est toujours le poème au risque de ne pas exister. Il n’y a pas de place réservée au poète dans la Cité. Toute place circonscrite, désignée comme telle est aux antipodes du poème qui déplace et se déplace. Ailleurs que là où on l’installe à résidence. Nomade, migrant. Levier et moyen de transport. Menacé d’académisme, de dépérissement ou d’inféodation au pouvoir quand sa place est institutionnalisée.
Dérangé, dérangeant? En mouvement. Faisant mouvement. En soi et hors de soi. Explorant l’espace du dedans et l’entour. Déplaçant dans la langue et par la langue. Dé/placé parce que dé/plaçant. Pas de place du poète dans la Cité, mais le zigzag du poème. En allusion à quelque éclair créateur originel ou à quelque modeste allumeur de réverbères convertis en lueurs de portables ? Sur le fil entre nuit et lumière. Clarté du logos et méandres du mythos. Flamboiement apollinien et ivresses dionysiaques. Lucidité et aveuglement. Tout rentre, tout fait ventre dans le poème qui témoigne de nous et interroge la langue, par laquelle se constitue et se dit notre humanité.
Laissons-le sur le fil et se mouvoir sinon dans le vide quantique, du moins entre les précipices, dans l’oxymore, le paradoxe et l’écart des couples contraires d’une condition humaine, à la dualité de laquelle spiritualités ou sagesses espèrent échapper par la réduction à l’un, la fusion au divin ou la cessation des cabrioles du « singe samsarique », mais que le poème travaille de front. De face. Les mains dans le pétrin. À tous les sens du terme. Au pétrissage de la langue pour quelque hypothétique manne partagée et dans l’empêtrement. Avec chacun empêtré dans son histoire et dans l’histoire, dans la langue et dans sa langue quand la langue de la Cité est aussi la manière dont elle se pense. En subvertir codes linguistiques et usages langagiers n’est pas insignifiant. Ce n’est pas dans l’inconscience de ce qu’il fait que le poète distord l’usage usuel de la langue pour la et s’en désempêtrer.
Que le poème désosse le mot à la lettre jusqu’à trouver « mot » dans mort et or en elle, jusqu’à faire comme si l’arbitraire de la langue tendait à l’énigme de la vie et de l’histoire un miroir révélateur, compatissant ou ironique, dans tous les cas, le mot se médite en poésie et c’est dans cet espace langagier que se déploie une parole qui, comme le bâton de Diogène, brise et désigne d’un même mouvement.
7- Nocturne
Ce soir lassitude de « la culture camelote » et des discours. Dans leur inévitable clôture de la parole incompatible avec l’arborescence du poème, ses scansions et ses ramifications rhizomatiques. Cet herbu de la langue qui ne se dit qu’en poésie quand le poème dit ce qui ne se dit qu’en poésie et ne peut se dire hors de ce dire (bis et ad limitum repetita). Me donne l’impression le poète de s’exposer en démarcheur rameutant le chaland en défense et illustration du rôle de la poésie dans la Cité. Cela ne se démontre pas. A lieu. Ou pas. Le poème est action.
Paroles flottantes, fantômes, parasitent le propos. Adorno par exemple : « Je suis prêt à concéder que, tout comme j’ai dit que, après Auschwitz, on ne pouvait plus écrire de poèmes — formule par laquelle je voulais indiquer que la culture ressuscitée me semblait creuse —, on doit dire par ailleurs qu’il faut écrire des poèmes, au sens où Hegel explique, dans l’Esthétique, que, aussi longtemps qu’il existe une conscience de la souffrance parmi les hommes, il doit aussi exister de l’art comme forme objective de cette conscience. »
Culture creuse bien sûr, dans laquelle se débat l’exigence du poème. Souffrance des hommes aussi. Je n’imagine pas de poésie qui ne s’élève contre ce qui diminue dans l’être. Qui, d’une manière ou d’une autre, ne lui dise non. « Fati non foste a viver come bruti /Ma per seguir virtute e conoscenza. » récitait une aïeule florentine psalmodiant La Divine Comédie, « Il y a des choses que non » répétait l’autre en son parler populaire de vieille libertaire. C’est de ce Il y a des choses que non, dont j’ai titré mon dernier livre tout entier traversé par l’Histoire et qui interroge plus explicitement que les autres le destin de la Cité dans le sentiment d’urgence, qui l’a fait naître.
La question du poète dans la Cité est politique autant que poétique et se dresse alors sur la barricade de Delacroix, le poète déguisé à présent en communard au prix de quelque anachronisme pictural. C’est déjà parti pris. Le poète n’est pas toujours juché sur la barricade, même s’il l’est le plus souvent. Péret distinguait les poètes de « l’honneur des poètes » de ceux du « déshonneur des poètes ». Rien ne se dissocie. Tout se diffracte dans l’historicité du poème. Poète-citoyen dit-on volontiers en ce moment. Intéressante redondance pour qui, comme moi, le second est inclus dans le premier. De multiples manières d’ailleurs. S’écarter, faire écart au grand écart de la langue, est aussi politique. Écrire du poème est politique. « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience. » et « comment vivre sans inconnu devant soi ? ». Char bien sûr, pour une parole tranchant au vif.
Le poème est une des manières de dire non à tout ce qui enchaîne ou humilie. De décliner ce « non » jusque dans la langue. Parfois explicitement, mais pas nécessairement. Cela se dit dans et entre les lignes. Dans cet entre qui tend le poème sur le vide de la langue mutique. Qu’il bouscule. Où parfois il s’effondre. Sur lequel parfois tressaille le fil fragile d’une parole tâtonnant au parcours de l’humain. Le plus ample, mais aussi le plus menu de vies minimes et précaires.
Le poème comme résistance à l’entropie. Éveil dans l’indigence de la parole. Ration de survie en des temps de disette mentale. Déni à la désertion de la pensée. Langue résistante, langue consistante, langue nourrissante... J’ai écrit quelque chose d’approchant quelque part. Autrement. En poésie. Me voilà à redire. Mais ce « redire » a partie liée avec le poème et la Cité.
La rumination de et sur la langue, sur soi, sur tout l’entour est travail du poème, travaillant et retravaillant l’évidence. « Ce qui tombe sous le sens ». Le poème dit et redit ce qui tombe sous le sens et sous les sens. Il le redit sans cesse, le re-donnant à entendre. Il dit, re-dit entre le babil du naissant, le babillage amoureux et le radotage d’une très vieille expérience humaine. Face à l’expertise, l’expérience comme risque et concrétion de temps dont nous sommes faits – Rilke : « Il faudrait attendre, accumuler toute une vie le sens et le nectar – une longue vie, si possible – et seulement alors, tout à la fin, pourrait-on écrire dix lignes qui soient bonnes. Car les vers ne sont pas faits, comme les gens le croient, avec des sentiments (ceux-là, on ne les a que trop tôt) – ils sont faits d’expériences vécues. » Cela ne voue pas le poème au grand âge, mais au temps dont il est fait, à la vie. Tsvetaïeva : « Ma spécialité à moi, c’est la vie ». Le poème mâche et remâche dans et par la langue l’expérience d’humanité, qui se recommence pour chacun, il la redit mais ne répète pas – à le faire il s’annule -, toujours en quête de l’autrement dit, autrement dire qui en rende compte dans son avènement. Dans le recommencement du sujet et du poème comme dans le mutant de l’histoire.
À l’usure des mots comme au frai de la monnaie le « tombe sous le sens » tombe dans son dessous. Dans la fosse de l’oubli et du sommeil de l’esprit et des sens. Dans la rigidité du sens ou d’un sens. Alors le poème redit. L’expérience commune. L’irremplaçable de l’instant. Le quelconque commun et unique d’un temps de vie, de chaque vie. Ce qui fait de chacun l’anonyme et l’irremplaçable et pour chacun le goût de la vie. Sur le bout de la langue, la saveur, le savoir, la parole, entre les lèvres qui prononcent le goût de la vie, leurs mouvements en écho au tout mouvement, le poème mâchant les mots dans sa bouche. En pie rouge, jersiaise ou blonde d’Aquitaine le poète, ruminant de la langue pour que revienne au palais la saveur fade de la pluie qui tombe à cet instant, à l’oreille un crissement de pneus sur le gravier ? Leibniziennes précieuses « petites perceptions » : « Il y a à tout moment un infinité de perceptions en nous (…). Ce sont elles qui forment ce je ne sais quoi, ces goûts, ces images, ces qualités des sens, claires dans l’assemblage, mais confuses dans les parties, ces impressions que des corps environnants font sur nous, qui enveloppent l’infini, cette liaison que chaque être a avec tout le reste de l’univers. On peut même dire qu’en conséquence de ces petites perceptions, le présent est gros de l’avenir et chargé du passé, que tout est conspirant... »
Le poème est « conspirant ». Respirant avec. Avec tout. Du majeur au minime. Grillons et galaxies. Il travaille avec ces infimes perceptions, ces sensations qui font le corps vivant et relié à tout, attirant sur elles l’attention et en gardant mémoire. S’efforçant de les convoquer dans la langue comme à la réduction alchimique dans l’œuvre au blanc d’une parole à la fois attentive et trouée par la conscience qu’elle n’évoque jamais que l’absent et l’absence.
Cet infime fugace d’une vie aussi essentiel que les ébranlements de l’histoire n’est pas moins constitutif de la Cité que ses soubresauts. Cette dernière n’est rien si elle n’est plus habitacle de vies vivantes, qui n’est pléonasme qu’à oublier qu’on peut-être mort en vie ou condamné à une mort en vie dans quelque géhenne déclinée aux multiples figures de l’aliénation. Ce sont ces restes que recueille le poème quand il n’est que ce qui reste. Et ce peu qui reste d’une vie, rassemblé dans une attention attentive, rappelle que nous sommes sans raison ni justification et, tout autant que la dénonciation, subvertit la réduction des vies et des corps à leur utilité voire à leur rentabilité.
La gratuité du poème quand à travers la voix de Baudelaire (« La poésie n’a pas d’autre but qu’elle-même ») parmi bien d’autres, il se déclare tel, refusant rôles et justifications, fait écho à celle de la vie, de toute vie. Redisant que nous sommes simplement. Que ce « sommes » somme un être-là immédiat et total. Dans la sommation du poème sinon à un age quod agis d’antique sagesse dans la souvenance que savoir, saveur et sagesse ont même racine dans un sapere (goûter), où se donnent à re-sentir et ressentir le goût de la vie comme l’appétence à être et le désir, du moins à l’attention, la plus extrême attention à toutes formes de vie, aux plus petits tressaillements de la vie. De cela, la Cité peut-elle s’en passer ? Et celle qui s’en passe, de quoi fait-elle l’impasse? De quoi sinon de chacun de nous ?
À l’injonction du pouvoir, qui dresse et soumet les corps, le poème oppose le langage du corps, corps individuel et social qui passe entre les signes, dans le silence des signes. Souffrant ou exultant, peu importe, désignant ce que le signe évacue, présent dans l’encombrant de la chair et des sens, l’encombrement de ce qui meurt et veut vivre, vivre et non servir. Subversif rien qu’en cela. Dans cette présence du corps, que les dévots de toutes croyances vouent aux gémonies (les mystiques, eux, rien là d’étonnant, sont parfois poètes : saint Jean de la Croix, Al-Maʿarri …), que tout pouvoir doit contrôler pour asseoir sa puissance. Nos corps. Auxquels donne séjour et voix le poème, rappelant à la Cité qu’elle en est faite. D’abord et au final de corps mortels. De peu face à la démesure de l’esprit.
Prendre la part du corps, c’est prendre la part à la fois de la jouissance non domestiquée et du refoulé de la mort. Cela fait le poème. Chacun peut l’entendre, mais pas tout le temps. Est-il surprenant que la Cité ne veuille pas, ne puisse pas toujours l’entendre et le pouvoir, les pouvoirs et toutes leurs formes de cléricatures, jamais ?
Avec le poème, c’est le corps qui fait effraction dans la langue et dans la Cité. Toujours peu ou prou à la fois louange d’exister et Memento mori rien qu’à poser les doigts sur l’os du crâne.
8-Memento mori
Memento mori, le poème l’est au delà du « recueil » ou du « tombeau », qui en nomment des formes comme en souvenance des stoïciens opposant sôma, le corps et sêma, signe et cadavre. Recueillant « ce qui reste » dans la conscience que le geste d’écrire face à la mort ne la vainc ni ne la dépasse. Ce n’est pas le durable du poème qui riposte à la poussière, qu’il rejoint tôt ou tard lui aussi, c’est son incandescence. L’éternité est d’instant et d’intensité de quelque manière qu’on la convoque.
Le court-circuit du poème rappelle qu’il y a, souvent, archaïque mémoire du feu dans la pratique poétique et ce jusque dans la métaphore, la rime, l’assonance ou le calembour. Lueur qui étincelle dans les Ténèbres. Ou croit le faire. De la répétition sonore et rythmique de la berceuse à l’incantation ultime du psaume, poèmes et chants président aux passages, veillent aux seuils de la naissance et de la mort. Y font intercession et consolation. Parce qu’il travaille le sens dans la présence aux sens et des sens, d’un même mouvement le poème dit un deuil qui outrepasse chaque deuil. Blesse et répare. Recoud de mots la plaie du sans mot.
Que la poésie contemporaine, du moins ici, ait déboulonné depuis longtemps la statue du poète en thaumaturge, et qu’il y ait belle lurette que, dépouillée de sa prétention à la plénitude du verbe, la poésie n’ait plus ni fonction cathartique ni vocation prophétique, la mort n’en demeure pas moins présente à son socle et à son horizon, qui est simplement le nôtre. Dans la déploration ou le balbutiement, dans un forage de la langue qui en démantèle le corps, brise sa syntaxe, tranche le mot en fin de ligne… À défaut de savoir pourquoi on meurt et de s’y résoudre, se bricole une imitation de la mort. Mimétisme et parodie ensemble. La destruction de la langue y vaut celle des croyances. Dans tout les cas, c’est aussi la mort qui se nomme et fait question dans la question du poème comme elle le fait dans la Cité. Dans sa violence guerrière récurrente, son refoulement au marges d’une Cité privilégiée et apeurée comme dans les charniers de sa périphérie.
Dans la langue du poème rôde le fantôme de la mort. Dans le spectral du réel, fantomatique même dans sa célébration. Car si le poème appelle la présence de l’être dans la langue, il en inscrit d’un même mouvement l’insaisissable, l’impossible arraisonnement. Non pas l’indicible, mais l’ombre portée. Lui-même ombre sonore, traces sur l’écran ou la page. Fantômes. Puissance et impuissance se nourrissent l’une l’autre de leur impossible dissociation. Dans l’évidence et l’évidemment de la langue. À son débord.
Que cela se dise en plein ou en creux, au blanc qui troue le poème ou à la mélopée qui le sature, dans la soustraction, le retrait ou le potlatch langagier et l’outrance, il y a, dans le poème quelque chose qui outre-passe et passe outre à la fois. Cet au-delà-de ne s’entend qu’à la mémoire. Dans l’acte d’écrire décalé de ce qu’il évoque, le poème se souvient, quoiqu’autrement qu’à la remémoration. Dans une remembrance, qui travaille après et avec l’oubli et remembre autrement le corps d’Orphée dispersé par les Ménades, notre corps. Revenant dans la langue après disparition du souvenir. Son lieu et sa matière : le temps. Dont nous sommes. « Les jours s’en vont, je demeure » et où le et la « demeure » apollinarienne sinon au poème penché sur un pont entre deux rives ? Dans son ombre et à son ombre emportée au fil d’une eau héraclitéenne.
Mémoire intime et mémoire de la Cité, le poème se souvient de « nous » réduits au monosyllabe d’un pronom. À un à-la-place-du-nom. Par manière de « dé/nommer ». Le poème nomme et dé/nomme à la fois, conjoignant et disjoignant, liant et déliant d’un même geste. L’oxymore poétique n’est pas qu’une échappatoire. Il faut bien qu’à un moment où un autre s’évacue le réel de l’illusion de le saisir, l’être de l’enclos du nom qui l’y convoque, comme le poète du poème.
Écrire en poésie, c’est aussi se désécrire, s’anonymer dans le quelconque et le commun de ceux et celles, singuliers multiples, qui s’approprient du poème. Altéré ce dernier, ai-je dit, ouvert à l’autre mais aussi modifié par l’autre, les autres autant sinon davantage maîtres de sa destinée que le poète lui-même, qui n’existe qu’à être désapproprié de son poème.
De même écrire est aussi désécrire dans une double récusation de l’indicible comme du rêve de toute puissance. Appeler fantômes dans la langue. Y-a-t-il autre place que fantomatique pour le poème, hantant la Cité d’un revenant, qui revient de nulle part sinon de son profond et hante le vide du mot mort, parfois comparant, jamais comparé - La mort n’est jamais comme - et dont celui qui l’écrit comme celui qui le lit ne peut avoir nulle expérience autre qu’indirecte ? Nul exegi monumentum aere perennius horatien nul mot qui la dit ne soustrait la mort d’elle-même. À cette ultime soustraction que le poème, même exultant, réitère dans l’échappée du mot qui échappe se brisant ou s’enchantant de lui-même, se dit une désappropriation, une dépossession face à tout pouvoir qui accumule biens et signes contre la mort avant de s’effondrer en elle.
Le poème n’est pas étranger à la Cité, si ce terme désigne des vivants rassemblés, il l’est au pouvoir, sur lequel il n’a pas de prise, mais lequel demeure lui aussi sans prise sur lui. Là, une forme de liberté s’éprouve – se sent, s’expérimente, se met à l’épreuve et à la preuve – et se donne à expérimenter et à éprouver. À respirer…
9- Respirer
« Conspirant » le poème, conspirateur de quelque insurrection jamais finie de la langue glissant le « skandalon », sous la botte de l’état de fait et du pouvoir qui l’instaure, prométhéen « voleur de feu » même s’il n’est que « mots qui brillent, mais faiblement, aux confins en grisaille de la conscience » (Bonnefoy), et surtout con-spirant, respirant avec tout.
Noyaux de résistance, agrégats de langue, scansions rythmiques visuelles et sonores qui ponctuent la langue poétique, désignent à la fois un plein – un potentiel de sens – et un vide, une suspension. Un arrêt où bute l’accoutumance du déjà dit, déjà ouï. L’effet, qu’on le nomme satori au butoir du koan, illuminations, sensation retrouvée du corps présent à l’existence tant cela se reformule par chaque poète et dans chaque poème, a un effet de déblayement. Balayeur le poète maintenant ? La rimbaldienne « main à plume » valait la main à la charrue, elle peut aussi valoir la ménagère à l’époussetage domestique de la langue et de soi. Et y faire de l’air. De l’air dans la mécanique du sens arraisonné. Du déblayement et du sonore. De l’écoute d’une musique désignant métaphoriquement ce qui est hors de la prise du signe. Et si ce n’est musique des sphères, dans tous les cas pulsation de la vie, sang et sèves résonnant dans la langue.
Le besoin de poème n’a jamais disparu. Il est toujours là, visible ou latent. Il s’ignore, se refoule, se nie, se musèle. Mais il se dit. De manière directe ou bien indirecte dans la chanson, la poésie populaire, dont la coupure avec la poésie savante a toujours été plus forte dans la poésie française que dans d’autres littératures. Qu’on s’exaspère d’une hégémonie médiatique réduisant la poésie au slam ou au rap est légitime – cette assimilation participe aussi de l’idéologie -, mais, si tout n’est pas dans tout, ce n’est pas raison pour réduire la variété et les possibles du poème. Effets comme visées ne sont pas semblables. Mais, pour piller une fois encore Leibniz « d’un point de vue de la plénitude, un dé à coudre plein est aussi plein qu’un tonneau plein » et du point de vue de la poésie, qu’elle fasse étincelle fugace ou incendie durable, elle n’en participe pas moins du besoin de…respirer.
Avant que l’inspiration ne se dégrade en figure académique, elle est un temps de la respiration. Inspiration, expiration dans la dissymétrie qui fait de la seconde l’euphémisme de mort et de la première non pas l’équivalent de vie, mais d’une vitalité de la vie, d’une énergie, d’une néguentropie. De là à dire qu’elles sont la materia prima du poème, il y a peu et place pour autre chose que d’antiques allégories surannées. À moins de les décaper de leur fatras comme doivent l’être les mots de leur caque quand penser est autre chose que réfléchir ou intellectualiser et méditer autre chose que de se tenir jambes croisées sur le tatami des versions commerciales de la respiration profonde. Qu’y souffle l’esprit à travers les bronchioles, c’est que s’y joignent parfois, énigmatiquement, la chair et la langue et cette double respiration physique et métaphysique quand le poème, comme le pneuma grec et le ruah hébreu signifiant souffle et esprit, joint les deux dans son dire.
Le poème est affaire de souffle, même s’il étrangle ce dernier dans sa gorge. « À force de crier, de bondir, de rouler, j’arrive jusqu’au sens » (Tsvetaïeva.) Et la Cité, qui se débat sous l’emprise, a besoin de respirer. Le poème n’est aussi qu’une façon de respirer. Dedans, dehors.
Du vent le poème, cette futilité ? Tout à fait. Il la récupère et l’inverse d’un coup de langue. Du vent, exactement cela. Un coup de vent dans la Cité. Une brise bienveillante, un mistral décoiffant, un alizé, un noroît, un sirocco, un foehn, un zéphyr, une bise, une tramontane, un squamish …et leur énumération interrompue irruption du monde dans la voix qui l’é-voque dans sa diversité, son inépuisable pluriel, où la Cité, elle-même plurielle, est incluse. Elle l’oublie… Le poème le lui rappelle, appelant, épelant.
10- Hospitalité
Bien sûr la Cité, la « polis », cette organisation humaine du monde. Cette désorganisation aussi. Mais elle est prise dans un tout qui la contient. Quand Hölderlin invite à habiter poétiquement la terre - « Plein de mérites, mais en poète / l'homme habite sur cette terre »-, c’est l’habitacle d’une vie pas seulement humaine qu’il désigne. Et Shelley, de son côté: « la poésie reproduit l’Univers commun, dont nous sommes des parties et des êtres sensibles ». Le poète en militant écologiste avant la lettre ? Il l’est depuis toujours (l’écologie n’est pas que l’environnement) déclinant le « tout conspire avec tout » du vieil Hippocrate. Dans la célébration de toutes les formes de vies.
Laissons aux images d’Épinal la niaiserie poétique « broutant les herbes » à la manière d’un Rousseau brocardé par Voltaire. La conscience comme la sensation d’être partie d’un tout, qu’elle se décline spirituellement au Vide taoïste ou à quelque spinoziste « deus sive natura » traverse l’expérience de l’humain. La relie à tout. La rend dépendante de ce tout.
Le poète, de son côté, mélangerait-il tout ? Il s’entretient avec tout . Avec toutes formes de pensée et de vie. Dans une liberté qui n’est pas confusion, mais brassage, mise en relation, où s’insinue, parfois, peut-être, un in/ouï sans pendant d’« invu ». Même voyant, le poème ne cherche pas le point de vue dominant, mais il arrive qu’il ait de l’oreille. Que cela s’entende dans le poème au triple sens du terme, qui joint ouïr, comprendre et une entente, dont l’appel s’étend à tout de nous et en nous comme à tout autour de nous.
La question n’est toujours que d’entendre et de s’entendre. Dans toutes leurs résonnances. Jeu de mots ? « Il suffit de deux lettres communes pour que les mots cessent de s’ignorer » (Jabès) et quand, dans l’arbitraire de ma langue, le sens et les sens sont homonymes, il y a de quoi méditer. Y-a-t-il dans le poème trace de quelque herméneutique, de quelque pilpoul talmudiste ? Il y a de l’entretien avec tout dans et par la langue – avec soi, avec l’autre, avec les mots et les mondes, l’ici comme l’ailleurs, morts et vivants, bêtes et gens, plantes et pierres, novas et neutrinos, possibles et impossibles. Le fatras de tout. Il y a de l’hospitalité dans le poème. De l’aimant aimant et aimantant. De l’utopie.
La parole poétique ne se tient ni en place ni en aucune place. Ni « dans » la Cité ni hors d’elle. Avec elle toujours, je l’ai dit d’emblée, mais aussi dans la tension vers d’autres possibles d’elle. Possibles assimilables à des avancées émancipatrices, mais, au delà de ces dernières comme avec elles, vers un habitat de l’homme, où il s’habite humainement. « La Poésie est l’expression, par le langage humain ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l’existence: elle doue ainsi d’authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle » (Mallarmé).
Dans tout l’empan humain inhumain de l’humain, que le poème n’ignore pas, dont il participe, il prend le parti de l’hospitalité contre le déshumain, édifiant précaire maison de paroles davantage paillote que monument. « Maison perdue » (De Signoribus), parole toujours perdue sans cesse réinventée dans une décision d’acte de foi dans la parole (non une illusion sur ses pouvoirs), qui n’invoque pas nécessairement le Verbe majusculé, mais invite la langue à un travail d’éthique et de vérité par elle et en elle. Tension vers quelque imprononçé et sans doute imprononçable, qui inscrit l’utopie au cœur de la parole poétique. Elan vers « l’être tel que de toute façon il importe». Vers des « propositions de monde » pour reprendre le mot de Ricœur. Utopie.
L’éthique du poème inscrit son hospitalité par et dans une langue cessant d’arraisonner le sens. Le propre du poème est de se déprendre, dans une insurrection implosive de la langue à son murmure comme à sa clameur et dans la conscience de son impuissance, de son impotence qui sait ne convoquer que l’après-coup de ce qui a lieu ou qui s’évanouit dans son dire, dans l’expérience que le compréhension est autant désappropriation qu’appropriation et qu’il n’y a pas d’issue dans l’emprise.
Parce que le poème, son écriture comme sa lecture, invite au colloque singulier et à cet « usage du propre » dont Hölderlin soulignait qu’il est « la tâche la plus difficile » il parle à la Cité du pouvoir qui l’érige comme de son utopie et d’un être « continuellement engendré par sa propre manière » quand, comme l’écrit Agamben, « cet être engendré par sa propre manière est l’unique bonheur vraiment possible pour les hommes. »
Le poème dit cela autrement. Il ne le formule pas. Il le dessine au creux et au plein de sa langue. L’exprime à sa façon, rigoureusement et inventivement, dans et avec la langue. Rappelant aussi que le langage ne sert pas seulement à dire quelque chose, mais, comme l’épouillage des primates, à mettre en contact, à apprivoiser. Cet apprivoisement hospitalier est, pour moi, inséparable du poème. Loin de la bien-pensance et des bonnes intentions - on n’écrit pas du poème avec des intentions et la fraternité du poème n’est pas niaise (« hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère » interpellait déjà Baudelaire)-. Son hospitalité est dans la désappropriation. Dans l’im/propriété toujours – car à proprement parler la langue du poème est impropre à tout usage utilitaire - il la tente. Dans l’utopie explicite ou implicite d’une cité hospitalière au tout vivant.
11-Joie
Parce qu’au bord de l’« entos thalassa », le ciel est haut. Que cette hauteur et son incandescence appellent à la fois le tragique sans mélancolie et sans tristesse – seulement lucide –la joie. Face à la déploration sur la Cité qui s’égare et aux métamorphoses du poème convoqué à sa tribune et à son tribunal, sa joie. Ou son « augmentation dans l’être » pour la synonymer à l’emporte-pièce façon Spinoza. La joie solaire du Dante dans l’amor che move il sole e l’altre stelle.
La légèreté du poème, indissociable d’une densité, qui n’est pas pesanteur, mais tenue. C’est cela aussi la relation du poème à la Cité. Le corps et l’esprit à leur jointure et non à leur déchirement. Une souplesse (de la vie) qui n’est pas mollesse (celle du sentimentalisme). Une rigueur (l’exigence réitérée du poème) qui n’est pas rigidité (celle du sens rangé au rangement définitif de sa clôture ou de la mort). Une complexité qui n’est pas plus complication que sa simplicité simplisme.
Dans « l’entre » le poème. Entre l’immédiateté de l’expérience de vivre et le recul de l’écriture. Entre la vue et la voix. L’oral et l’écrit dans le retrait des deux pour que l’autre soit. Dans l’entre/tien d’une entre/prise où l’oxymore ne figure que le mouvement. Entre diastole et systole. Tsimtsoum kabbaliste et big-bang de l’univers. Dans l’entre de la vie et son écoute qu’il fait écouter. Mode de contact de l'homme avec les choses et le monde, le poème permet de « concevoir son identité personnelle, de la dégager de ce qui n'est pas elle, de la décrasser, décalaminer, de se signifier de s'éterniser enfin, dans l'objoie » écrivait Ponge au néologisme d’un « objoie » qui en lie l'écriture « non comme la transcription, selon un code conventionnel, de quelque idée mais à la vérité comme un orgasme. »
À la fois une jouissance du corps et de l’esprit dans la langue et un medium stare le poème, une médiane oblique ? Pour moi, oui. Une médiation et une méditation de mots et en mots. Une façon d’être au monde. Indissociablement une forme de vie et une pratique de langue joignant le corps et l’esprit, le langage, l’éthique et l’histoire. Partagée ? Plus ou moins aussi bien dans l’histoire commune que dans celle de chacun. Sinon aléatoire, la rencontre du poème est imprévisible. Minoritaire le poème ? Ce n’est pas disqualifiant. Donné en partage, circulant, mais sans nécessité de s’imposer, d’impéria-(lement et listement) s’étendre. Ni honteux ni paradant, ni zélote ni pénitent. Là présent. Sans ambition de totalité, sans dogme et sans ultime révélation. Sans « solution finale ». Simplement là. Dans la question, la relation. Compagnon de route. Dans l’entretien possible avec ceux que Char nommait « les grands astreignants » et Michaux « les copains de génie ». Dans l’entre/tien au tu de toute parole. Le poème accompagne. Sans plus. Aux côtés et à côté. Silencieusement ou à coup d’éclats. Dans l’attention et l’attente. De bouche à oreille. Du trou au trou comme aimaient à dire les Antiques. Ouvert. Dans l’ouvert. L’ouvert de la vie.
Et cet ouvert est joie. Reçue et offerte.
12- Au mitan
Quoique j’écrive, à la diable et au ping-pong de ma voix avec d’autres, demeure point aveugle. Nul ne se retourne sur son ombre ni ne s’extrait de son époque. « Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps. » (Agamben). Le (ou la) poète a quelque avis (opinion voire jugement tranché) sur son rapport à la Cité, n’exagérons pas dans l’aporie, mais ce n’est pas ce qui importe. Ce qu’il ou elle dit d’essentiel de et à la Cité, il ou elle le dit en poésie. Sans savoir s’il ou elle le fait. Non dans la pose de quelque fausse humilité ou parce qu’il n’y aurait pas au poème à la fois impulsion et retour critique distancé, il n’est que de cela, mais parce qu’il est pris dans l’histoire comme chacun.
Si le poème est manière d’être au monde, de le vivre et de le penser, et en cela, pour moi, effort de clarté, incessant effort de clarté, c’est en poésie que je dis quelque chose si tant est que j’y parvienne. De cela je ne peux avoir la certitude. Ecrire en poésie (cet « en poésie » et non « de la poésie » insistant sur l’usage spécifique de la langue que fait le poème) est un acte risqué. Un pari. Une expérience qui s’expérimente et se dit dans cette langue là. Pas dans une autre.
Il est l’heure non de conclure, le poème récuse la parole conclusive et il en a été peu dit comparé à ce qui resterait à dire, mais de s’interrompre, de briser là comme si, en miroir de l’effraction du poème dans la Cité, se devait couper court sans ambages à la parole du poète. Dans la réciprocité. Dans le manque logé dans toute parole, dans l’appel et l’écoute des paroles de l’autre et d’une parole autre.
Où le poète dans la Cité ? Au mitan. Dans l’attention, l’éveil, la vigilance. À l’écoute dans les entrailles de la Cité, qui n’est ni une ni immobile, mais traversée de flux contradictoires et grosse d’autres d’elle-même à la fois promesses et menaces. En plein milieu et excentré car le milieu n’est pas nécessairement le centre de quelque cercle d’une géométrie trop étroitement euclidienne, ni un lieu de stabilité, mais ce que la mathématique nommerait un point d’inflexion ou la physique ce moment de rupture dans un sens ou un autre à partir d'un centre par nature toujours en mouvement
Au mitan de la Cité en mouvement le poème en mouvement. Et parfois dans le mille. Comme au khât décisif du maître zen dans un art poétique à la manière de la pratique du tir à l’arc. Dans « le faisceau de ténèbres» qui émane du présent, parfois, l’éclat diffracté du poème. Dans la Cité, toujours, un besoin de lumière.
Claude Ber
Revue Cités n° 73
1- Rencontre
La brume sur Paris. Son gris entre les pas et la ville. Vers où elle et les genoux pliés qui l’arpentent ? Le poète dans la Cité ? Où peut-il être hormis là. Avec, toujours avec.
Que la Cité accueille le poète ou le bannisse, qu’elle l’écoute ou reste sourde à sa parole, qu’elle l’encense ou le méprise, que lui-même choisisse de s’en écarter ou de plonger dans la mêlée de l’engagement, il en demeure indissociable. Pas de poète ni de poème hors d’elle et de son histoire.
Rencontre. Le poème, une « poignée de main » disait Celan. Indissociablement lié aux autres, à l’autre, supposant, appelant le regard qui le lit, la voix qui le remet en corps, l’interprétation qui déploie ses lectures, n’existant que d’être recueilli, visité, revisité. Sans cet accueil du poème qui le rend visible, il n’est que virtuellement poème. Le poème hors de la Cité, hors relation, n’est pas.
Pas de poète s’il n’est dit tel par d’autres. Dans un statut mouvant, de la reconnaissance immédiate ou posthume à l’oubli où sombrent aussi bien le méconnu que le favori de la mode. Figures oscillant au gré de désamours et de redécouvertes, de purgatoires, d’enfers ou de panthéons ponctuant sa rencontre avec la Cité.
Rencontre. Qui croise cycliquement l’histoire collective quand Liberté de Paul Eluard fait écho à la Résistance, quand le « Debout la négraille !» de Césaire inaugure avec Senghor la parole de la négritude, quand le poème d’Ingrid Jonker cité par Mandela lors de son investiture joue rôle d’étendard, quand, pendant le printemps arabe, la foule tunisienne scande les vers d’Abou el Kacem Chebbi mort en 1934 « Si le peuple décide de vivre un jour / Force est au Destin de répondre ». Et tant d’autres rencontres, contemporaines de l’ouvrage ou différées.
Rencontres éclatantes du poète et d’un peuple. Ou plus cachées, plus singulières. Dans le tête-à-tête silencieux du livre et du lecteur, de la voix et de l’oreille. Au secret de l’intime de ceux et celles qu’il accompagne.
2- Diffraction
« Le poète dans la Cité » ? Invite au constat, au manifeste implicite, à la réflexion théorique ? La question aimante les trois et se diffracte.
Poètes et Cités sont pluriels, leurs relations varient. Selon les époques, les cultures, les formes du politique et du poétique. Même dans le cercle étroit d’un ici et maintenant réduit à la poésie française contemporaine, les postures divergent. Dès qu’on le quitte pour une Cité planétaire à la fois maillée par les réseaux inter-nautiques, mondialisée par la spéculation financière et pulvérisée en microcosmes identitaires, l’écart est grand entre un Darwich indissociable de la destinée du peuple palestinien et la poésie textuelle déclarant la mort de la poésie ou ne la concevant qu’autotélique. Le débat théorique sur le poète et la Cité éclate dans le pluriel des poètes et des cités pris dans une histoire, y compris littéraire par rapport à laquelle une écriture travaille en échos et écarts. « Il ressort de la poésie, de la littérature, des discours, qu’il n’y a pas d’essence, seulement une historicité. Une histoire des historicités. Seulement des individus. C’est ce que les œuvres nous apprennent à lire. » (Meschonnic)
Sur les rayons de la bibliothèque des colonnes de livres. À décliner relations et postures, le poète sortirait d’eux en vates doté sinon de pouvoirs magiques du moins de celui de ressusciter le réel dans la langue, en officiant des exploits olympiques quand l’ode pindarique participait à la liesse festive du komos, en aède célébrant l’épopée mythique de la Cité ou déplorant ses malheurs, en invité aux Jeux Floraux de Clémence Isaure célébrant la fine amor au trobar clus et au trobar leu, en fabuliste et satiriste dans la lignée de Juvénal et de La Fontaine comme en courtisan du Prince, en « pâtre promontoire » (Hugo) éclairant l’avenir des peuples, en « phare » (Baudelaire) témoin de notre humanité, en « voyant » (Rimbaud) tourné vers l’exploration d’une intériorité dédoublée non seulement en « je est un autre », mais en multiples hétéronymes à la manière d’un Pessoa dans le miroitement d’une identité rien moins qu’univoque et toujours « intranquille », en chantre de la liberté insurgé contre toutes les tyrannies et subvertissant les codes sociaux de la langue, en praticien de cette dernière attaché à fabriquer un objet de langage sans autre but que lui-même quand « ce n’est pas avec des idées qu’on écrit des poèmes, c’est avec des mots » (Mallarmé), en spéléologue de « l’espace du dedans » (Michaux), en « passant rien de plus » (Si Mohand U Mand) interrogeant notre énigme ou claudiquant en quête d’une vérité ontologique nichée au cœur de la parole, en huissier attaché au constat d’un réel jamais saisissable hors des mots qui le parlent et le pensent, prenant « le parti pris des choses » (Ponge) ou à « la poursuite passionnée de la Réalité » (Milosz), en explorateur de l’imaginaire, de l’inconscient surréaliste et des confins du langage, en « suicidé de la société » (Artaud) arrachant bribes de sens à la barbarie bégayante de l’histoire, « cette éternelle répétition et ce beau nom de l’horreur » (Borgès), etc. etc. etc. Et ces et cetera en précaution contre simplifications et généralisations comme en rappel de l’historicité du poème contre une sacralisation de ce dernier et un essentialisme de la poésie.
Et ce d’autant plus qu’aucun poème n’est l’illustration d’une poétique. Qu’une œuvre et même un seul poème mêle plusieurs de ces postures et les excède. Que théories et arts poétiques comme les controverses qui les accompagnent, ont rôle d’aiguillon, mais ni ne déterminent les œuvres ni n’en font le tour. La pratique poétique dépasse les injonctions. « La meilleure façon de savoir ce qu’est la poésie est de lire des poèmes. » soulignait salutairement Zukofsky. Le poème ne vit que de déjouer ses définitions et les rôles qu’il endosse, d’être ouvert à des interprétations recommencées et d’une actualité qui ne se confond pas avec celle de sa publication.
Il faut renoncer au panorama et serrer au plus près une expérience subjective, qui, comme toute démarche artistique s’élabore au carrefour d’une individualité, d’une culture et d’une époque dans lesquelles elle émerge et sinon d’une universalité du moins d’une commune « espèce humaine » pour reprendre l’expression d’Antelme.
S’écarter, autant que possible, du discours surplombant. À la fois dans la conscience d’une complexité disproportionnée à la mesure d’un article comme par manière de rappeler que le discours sur le poème n’est pas le poème. Qu’il prive, dès l’orée, de la possibilité de dire ce qui ne se dit qu’en poésie et par elle. À défaut d’écrire en poésie, s’en tenir au fragment, convoquer un brouhaha de voix, entre lesquelles se glisse la mienne, comme un signe vers la pluralité du poème, qui brise l’ambition totalisante du dissertatif, travaille par éclats et retours, se diffracte, ne cessant, mon propos, de tourner et retourner sur lui-même à quelque zodiaque de la parole et au temps qu’il décline comme revient le poème sur ce que « parler veut dire ». Car c’est autour de la parole, du statut et des enjeux de la langue que se noue le rapport du poète et de la Cité.
3- Effraction
Le poème fait usage « non ustensilitaire » de la langue disait Artaud. Retournant le langage, sur une redondance et une attention à lui-même dans ce versus, ce retour de la charrue en bout de sillon, qui le met originellement sous le signe du retour sans l’obliger pour autant à l’aller à la ligne. Conscience « de ce que parler veut dire » pour citer de nouveau Mandelstam, mallarméen « sens plus pur donné aux mots de la tribu », réactivation du langage, du lien aux autres et au monde à travers quelque parole réanimée, qui, d’une manière ou d’une autre, vise le réveil des yeux habitués à voir et des oreilles déshabituées d’entendre, cela se dit multiplement.
Déjà le mythe d’Orphée n’est que retournements. Retournant à ces enfers dont le mystère d’après mort réplique le sans mot d’avant vie, se retournant sur Eurydice, Orphée ne cesse de se retourner quand Œdipe va de l’avant, basculant dans l’abîme et le père et le Sphinx pour finir par errer sur les chemins jusqu’à Athènes, où il sera rédimé. Ces figures ne s’épuisent pas à la distinction entre la prose qui déplie dans son prorsus et le poème qui replie, elles n’en esquissent qu’une schématique allégorie opposant la successivité de la narration et la logique du discours à la feuillature du poème. Différenciation à la fois pertinente et factice car le poème n’exclut ni narration ni discours. De l’épopée aux Gedankenlyric ou aux chants-pensée des Indiens Tépuhas, il fait feu de tout bois. S’il écarte, par période, et notamment dans l’histoire récente du poème français, certains de ses possibles et de ses modalités, ce n’est jamais que local, ponctuel et transitoire. Le poème est métamorphique, allant du vers rimé ou non à la prose poétique en passant par poèmes en prose et « proèmes » pongiens. C’est davantage avec le statut du signe qu’avec les frontières de genre qu’a maille à partir le poème dans sa mise en échec de la primauté du sens, auquel il ne se réduit pas. Débordant le signe et la notion de sens.
Le rythme, cet écho de la voix dans l’écrit qui fait entendre du « sujet », et la feuillature du poème, pour reprendre ce mot artisan qui désigne l’action et son résultat car le poème est à la fois une action, une pratique et un objet de langage, organisent le couche sur couche polysémique du poème, dont les multiples strates font sens en tous sens séparément et ensemble (son, rythme, disposition visuelle, images, figures…) quand le son signifie et le sens résonne. Entre énigme et clarté, le poème ne délivre pas un sens dans l’immédiat de son illusoire possession, mais œuvre multiplement au prisme de la vie, ne révélant souvent que lentement et même rétrospectivement ses virtualités.
En cela, le poème est méditation de mots, méditation sensible quand « Le sensible de la langue, ce qui tombe sous le sens, c’est l’énigme de la présence d’une voix (personne) » écrit Celan dans Meridian-materialien. Et Valéry de noter dans ses cahiers « le principe de la poésie est à rechercher dans la voix et dans l’union singulière, exceptionnelle, difficile à prolonger de la voix avec la pensée ». Qu’on la prête aux Muses, à l’inconscient, à un arbitraire de l’agencement rythmique ou du calembour à la Brisset peu importe. Elle résonne. Dans cette « atmosphère de la pensée » où, selon Kierkegaard, « nous plonge le poème » et dans autre chose qu’un comme de la pensée, qui ferait du poème une illusion ou un ersatz de la pensée. Deleuze comparant sciences, art et philosophie - « Les trois voies sont spécifiques, aussi directes les unes que les autres, et se distinguent par la nature du plan et de ce qui l’occupe. Penser, c’est penser par concepts, ou bien par fonctions, ou bien par sensations, et l’une de ces pensées n’est pas meilleure qu’une autre, ou plus complètement, plus synthétiquement pensée (…). » - suffira, ici, à placer rapidement le poème dans son rapport au sensible et à la vérité.
Ce dernier se joue dans sa matière même, le langage dans et par lequel se nomme cette « voix » sans identité – « personne » précise Celan – et pourtant audible comme le sourire sans chat du chat de Chester chez Lewis Carroll. Nettement voix et même précisément cette voix spécifique de la pensée, non asservie à une quelconque finalité, que la poésie a diversement nommée voix de l’âme, des dieux, de l’être, du monde et que l’écriture comme la lecture du poème fait entendre dans l’expérience singulière d’une parole à la jonction du rythme de la langue et du rythme de la pensée, dans une sorte d’exercice sensible de la pensée.
Réenchantement du monde, conversion du regard, inauguration d'un mode spécifique d'être et de sentir, revitalisation d’une langue usée et anémiée par la réduction à sa fonction de communication, les poètes formulent de diverses manières ce travail de la langue, qui cherche à élargir les possibles du langage se rendant par là « plus utile(s) qu'aucun citoyen de (leur) tribu » (Lautréamont), à donner présence au monde - « Là où la montagne dépasse du mot qui la désigne se trouve un poète » (Elytis) - à restaurer l’être en nous « retirant à notre vue intérieure la couche de familiarité, qui nous obscurcit la merveille de notre être » (Shelley) ou à « l’intensifier » (Bonnefoy). Il faut que ça (y compris le désir qui se love allusivement dans ces deux lettres) fasse présence par et au cœur des mots. Altéré au double sens du terme, habité par une soif inextinguible et tourné vers l’autre, y compris l’autre ou les autres de soi et de nous, le poème met du jeu dans les rouages d’une langue inerte et s’ouvre à toute altérité dans une conjonction du singulier et du commun.
En cela, le poème enjambe les limites et déplace les bornes de l’usage ordinaire et social de la langue. Provoquant surprise, perplexité et réveil de l’attention. Court-circuit. Faisant à la fois résistance et mouvement. Il y a poème quand il y a naissance, présence et court-circuit. Quand quelque chose meut et émeut dans l’é-mouvoir de l’émotion. Quand se dérègle d’une manière ou d’une autre la mécanique du signe soumis à la raison technique et à la raison d’État. Non que le poème divague, il est, à l’inverse un effort de clarté -« une œuvre [poétique] consiste essentiellement en élucidations. » (Wittgenstein) – qui élucide selon un mode qui lui est propre et qui fait effraction. Effraction de l’indécidable dans l’assurance du signe. À la question du qu’est-ce que ça veut dire, le poème répond par un ça dit ce que ça dit quand la forme informe dans une signifiance, qui outrepasse les significations. Le poème ne « veut » rien dire. Il dit. Cela est effraction. De quoi ? De ce que du je (non assimilable au moi), du nous, du monde, des choses, de nos corps, de la vie ne dit précisément que la poésie.
Le poème n’entrerait-il dans la Cité que par effraction, dans une effraction dans et par la langue ? Le poème fait, je le crois, irruption, effraction dans l’inerte et l’arraisonné de la langue. Déverrouillant, au passage, la langue stérile du discours politique ou technocratique (langue de bois engoncée dans idéologies et représentations la nomme la langue courante comme en contrepoint de la langue de chair qui habite nos bouches) et d’une communication tournée vers une compréhension immédiate et univoque, diffusant exponentiellement un minimum de sens sur le maximum de surface. Maximum de sens sur minimum de surface, pour le dire façon slogan et en référence à une intensité plus qu’à une taille car le poétique va des quelques vers du haïku ou du triolet aux milliers d’Homère, le poème est, de ce fait, antithétique des impératifs du politique. Cette effraction du poème est-elle propre à la Cité ici et maintenant ?
4- Adresse
Ce n’est qu’à la rêverie de paradis perdus du poétique et avec force entorses à son histoire que s’imagine le poète trônant au centre de la Cité. Il arrive qu’elle parle par sa voix. Ponctuellement. Dans l’imprévisible de ce qui joint cette dernière et un élan collectif. Mais le poète erre aussi dans ses bas-fonds en « poète maudit », jeté dans ses oubliettes sous les traits de Villon au pied de la potence, de Desnos déporté, de Hölderlin, d’Artaud ou de Sylvia Plath dans leur asile de fous, de Dante, de Hugo, de Pouchkine ou de Tsvetaïeva exilés, de tous et toutes les poètes fuyant, en ce moment même, fondamentalisme et dictatures, d’Hikmet et de Ritsos dans leur prison et de ceux et celles croupissant dans les geôles du Qatar ou de la Syrie tels Mohammed al-Ajami, Nazim Hamadi ou Nasser Bunduq. La liste serait longue à égrener. Et d’une immédiate actualité.
Il y a longtemps que constat a été fait de l’antinomie du poème et de l’ordre établi et il n’y a que passagèrement retrouvailles unanimes entre le poète et la Cité. Le poème habite moins l’espace que le temps. Davantage la mémoire de la Cité, qui l’exhume de sa tombe, que son hic et nunc. C’est à sa diffusion dans la durée que se mesure l’impact du poème plus marathonien que sprinter. Mais, depuis plusieurs décennies, le lamento sur le poète coupé de la Cité est récurrent. La poésie, ici et maintenant, est censée être en crise, aux marges de la Cité dans un bannissement réitérant l’exclusion platonicienne du poïein, qui marque l’imaginaire occidental.
Il est, de fait, relégué à l’écart des grands circuits médiatiques et semble sinon quasi invisible du moins confiné à des cénacles restreints. Mais n’y-a-t-il pas, là, à la fois mirage d’un âge d’or du poème et un de ces constats censément de réalité qui modèlent cette réalité ? N’y-a-t-il pas quelque sophisme à affirmer que la poésie ne fait pas audience quand on ne lui en donne quasi aucune ? Que le poème ne trouve plus de lecteurs quand tout relai d’importance auprès du lectorat a disparu ? À qui, d’ailleurs, s’adresse le poème ? À un public ou à un peuple dans une rencontre où les deux ont part ? À tout le monde ou à n’importe qui ?
Le poème relève de l’intime comme du collectif, parfois même du national dans l’enjeu politique de la langue, de l’intériorité comme de l’histoire, jaillit au croisement des deux, mais n’est pas tourné vers un public quand ce terme désigne le destinataire d’une culture non pas populaire mais de masse, dont le critère est l’extension et l’indéfinie croissance.
À l’impératif d’efficacité de la communication, le poème oppose l’intensité. Si le poème est parole oblique et chargée, que cette intensité travaille dans le dépouillement ou l’excès, rien d’étonnant qu’il ait audience restreinte. Le poème ne s’adresse pas à tout le monde dans la conquête exponentielle d’une clientèle poétique ou alors à un « tous » en écho d’une espérance politique où résonne, comme dans le « poétariat » de Jean-Claude Pinson, une nostalgie ou un espoir d’émancipation universelle, il s’adresse à n’importe qui parmi tous. À chacun.
Quand la Cité du citoyen devenu client est celle du « peuple absent » et que se confondent singularité et individualisme, à qui s’adresse le poème ? Kafka faisait déjà l’hypothèse que la littérature serait peut-être « le dernier chemin vers notre prochain ». Ce mot a significativement disparu au profit du terme « autre », sans doute à cause de sa connotation religieuse, mais effaçant les notions de proximité et de succession qu’il supposait quand le prochain est à la fois le proche et le suivant. L’Autre même majuscule, l’altérité même logée au cœur du sujet comme par Levinas, retrouve-t-elle le proche et le suivant ? Le langage n’est pas innocent. C’est une des connaissances du poème. Et ni le proche ni le suivant ne sont au centre de la logique économique et politique de la Cité encore moins réceptive quand elle est planétairement traversée par des résurgences fascisantes, des régressions fanatiques et des dérives dictatoriales.
À qui s’adresse le poème ? Le poème use des pronoms. Il s’adresse à toi, à vous, à nous. Dans le singulier et le commun. Quelque « singulier quelconque » d’Agamben ? Philosophie et poésie conjuguent une gémellité dizygote. L’une dépose, l’autre témoigne… Trop vite dit, passons, à leur croisement, parfois, l’une l’autre s’éclairent et leur dialogue ne se résume pas à l’exclusion du fauteur de trouble que serait le poète. Commun et singularité donc quand une singularité ne devient « différence » que par le marquage d’un pouvoir qui l’érige en critère de distinction de droits, de traitement, de considération. Ce que le poétique oppose déjà au politique est la singularité contre l’identité et le commun contre les variations nationalistes ou mondialistes d’un collectif disqualifié par la dissolution du lien politique et social.
Quel terme qualifierait alors le poème à la fois dans sa genèse et son adresse ? L’eccéité peut-être, vocable scolastique emprunté au théologien Duns Scot, qui suppose un principe d’individuation comme ce lit, à côté de moi, sur lequel tu as dormi, sur lequel nous avons fait l’amour. C’est de ce lit particulier et de nul autre, de cette femme-là, de cet homme-là et non de l’homme ou la femme en général, de cet individu là, unique, insaisissable dans une définition ou dans des identités aussi multipliées soient-elles, qu’écrit le poème dépassant les deux termes d’identité et de différences et leur impasse vers une singularité commune reliant l’eccéité de chacun et le commun à tous. Adresse non pas « pour » ni « vers », mais avec. Sujet s’adressant à des sujets dans la réciprocité d’une adresse utopique et d’un « Tout-monde » à la Glissant? C’est mon expérience du poème. Cela est-il recevable, audible par une Cité doublement travaillée par l’uniformisation et l’identitaire ?
5- Confiteor
À qui la faute dans l’exil supposé du poème ? Essais, articles et colloques se multiplient depuis plusieurs décades, autant n’en citer aucun faute de pouvoir les citer tous. À la louche, deux coupables sont désignés : les poètes et la Cité.
Les poètes (ici et maintenant sans cesse sous-entendu car ce n’est ni toujours ni partout) seraient, selon certains, responsables de s’être retranchés dans un excès d’intellectualisme sophistiqué, ne s’adressant plus qu’à un happy few d’initiés. Déjà Milosz intentait un procès à la poésie française accusée d’appauvrissement dans un formalisme ascétique et hermétique souvent plus rhétorique et langagier qu’inspiré par quelque mystère héritier du Trismégiste et dont « le petit exercice solitaire » » entraînerait « une scission et un malentendu entre le poète et la grande famille humaine ». C’est débat récurrent, autant politique que poétique. Les querelles et points de vue reflètent l’historicité de la poésie, ses questions, ses audaces, ses impasses. Si ces affrontements théoriques, où épigones et tenants de courants antagonistes se disputent sur la définition et le rôle de la poésie, peuvent servir de carburant, ils ne me semblent pas d’une incidence décisive quand le poème est avant tout un risque renouvelé dans une réinvention de lui-même jamais finie comme dans une invention du sujet dans et par la langue. Quelles que soient esthétiques et postures, elles ne sont pas garantes du poème et son essai n’est pas toujours transformé. Parfois le poème s’égare. Ou attend son heure dans une temporalité distincte de l’immédiat et dont il n’est pas seul à décider.
Majoritairement, c’est la Cité qui est accusée d’être devenue incapable d’entendre le poème, avide qu’elle est de significations immédiatement consommables et rassurantes et non d’écritures qui la déroutent et la questionnent. Sous l’emblème de « la boite Campbell » érigée en symbole d’une contemporanéité dominée par la marchandisation, la Cité consommatrice de biens périssables et gérée par la rentabilité exclut de son achalandage ce qui dérange les plans marketing. Le poème n’est pas produit rentable, suppose une temporalité incompatible avec les impératifs du time is money, exprime et appelle un lien personnel et actif là où domine la parcellisation d’une clientèle passive.
Ce peut être, évidemment, plus finement analysé en mettant sur la sellette une domination économique et idéologique d’une puissance inégalée dépassant les formes de dictatures plus classiquement identifiables, dans lesquelles toute expression, dont celle du poète, est, cette fois, muselée sans détour. S’exprimerait une nouvelle version de la tension entre poésie – et plus largement poïein – tels qu’ils ont été amplement décrits et tout aussi largement illustrés par le tribut que les poètes exilés, assassinés, emprisonnés, d’Ovide à, de nos jours, Meyomesse, Li Bifeng, Mutis, Breytenbach en passant par bien d’autres, ont payé et payent encore à la voracité du Léviathan politique.
In fine, la poésie serait, selon la nature du pouvoir, bâillonnée de manière soft ou hard pour emprunter à l’époque sa « novlangue ». Sous le règne de « la société du spectacle » et de « l’universel reportage », le plus efficace bâillon n’est pas la censure, mais le silence. Face à l’hémorragie du sens et à la déroute de l’esprit, le poème incarnerait à la fois une ultime résistance de franc-tireur et l’affirmation têtue d’une humanité, qui est moins une donnée qu’une espérance sans cesse à inventer.
6- Déplacé
Où donc la place du poème dans une Cité, dont l’idéologie et le discours dominant dissolvent insidieusement à la fois le peuple, le citoyen et la personne ou les oppressent ouvertement ? Déplacé. Poèmes et poètes sont déplacés au sens propre et figuré. Et d’autant plus que dans leurs représentations courantes, le poète rêvasse en inconséquent amuseur ou en fabricant d’élucubrations absconses et la poésie endosse les oripeaux d’une niaiserie sentimentale sans rapport avec un réel, dont le discours idéologique et l’écosystème médiatique entre télé-réalité et scientisme de pacotille se donnent pour seuls légitimes possesseurs.
Charge exagérée ? À peine. Au contact de la « réalité rugueuse », poème et poète croulent sous leurs caricatures. Trivialités? Expérience. Dont celle, tant de fois répétée, d’inaugurations de manifestations de poésie par l’évocation de souvenirs de maternelle. Là est la place du poème. Pour les enfants. Bien sûr l’enfant et l’enfance du poème qui inaugure, nativus et matinal dans l’aube de la parole – ce peut-être aussi un cliché -, mais sûrement pas l’infantilisme ni l’infantilisation.
C’est pourtant vers elles que ses représentations poussent trop souvent le poème, vers l’insignifiance ludique. Bien sûr, le poème joue, met du jeu (bis repetita) dans la langue, desserrant l’étau de son usage politique et social – et au passage y met du « je » singulier quand le « je » n’est pas le moi ni le sujet l’égo – mais il ne se réduit pas à l’amusement, au passe-temps, au loisir quand le terme évacue la liberté de l’otium et n’en retient qu’un vide bien différent de la vacuité spirituelle.
Ces représentations poussent non seulement le poème hors de la Cité, mais hors de lui-même. Si nul enjeu vital ne réside plus en lui, pourquoi s’y intéresser? Ce discours dominant ne peut s’écarter d’un revers de main. Il pénètre partout, autant dans sa version grossière que dans des façons raffinées d’entonner le thrène de la rupture entre le poète et la Cité. Aussi bien dans l’usage dévalué du terme de poésie que dans la transmission du poème, auquel l’école comme l’université octroient une part du pauvre souvent elle-même indigente. Pas toujours bien sûr et s’indigneraient à juste titre les « passeurs de poème » qui ne le réduisent ni à la seule technique (même si la poésie l’est et même technique de pointe) ni au seul amusement (même si elle est jeu de langage et revendique une gratuité refusant d’intérioriser la norme de la rentabilité). Ces passeurs de poèmes pourraient témoigner de leur expérience comme en témoignent les poètes.
Cette dernière à la fois accrédite et dément le discours convenu. Non, pas de poète sur les plateaux télévisuels. Très peu ou pas du tout dans les grands médias, avec toujours quelques exceptions ponctuelles. Pourtant revues, lectures, sites, manifestations abondent. Même dans le maillage inter-nautique, le poème s’est faufilé entre tweets et fake news, s’accommodant de tout support, circulant aussi bien de bouche à oreille qu’en cd et podcasts, de l’estrade à youtube, sur la page comme sur l’écran. Qu’à cela ne tienne rétorque la parole autorisée, les poètes parlent aux poètes dans quelque névrotique contemplation d’eux-mêmes où se mirerait une poésie narcissique. Cela lui arrive, mais ne la résume pas.
L’objection peut se faire subtile et le poème aussi a ses cul-de-sac et ses manies d’époque, mais, à l’expérience de l’éditer, il se diffuse plus qu’on ne croit. Loin des tirages du best-seller, lentement, mais durablement. Essaimant. S’infiltrant, imprégnant peu à peu. À l’expérience de lire publiquement le poème car c’est en nomade, son livre sous le bras, que se croise aussi le poète allant de lectures publiques en performances, d’ateliers en séminaires, se dissolvent les stéréotypes. « Ce pelé, ce galeux » s’invite un peu partout et pas dans les seuls lieux dédiés à la poésie. Il est même des contrées lointaines, où il « festivale » devant quelques milliers de personnes. Contrastes, disparités. Mais, ici même, les poètes pourraient témoigner que, oui, le poème s’adresse à n’importe qui et pas à ceux et celles auxquels le préjugé présuppose qu’il s’adresse, que, oui, il est entendu et pas nécessairement par qui le mépris du plus grand nombre décrète qu’il le sera. La question est politique, le poème n’a pas de clientèle, mais parfois un peuple et des vis-à-vis de visages toujours.
Anecdotes à foison sortiraient de la besace du poète, se souvenant, par exemple, de ce matin du 18 avril 2008, où, sur le quai d’une gare de banlieue, une femme sanglotait sur un banc. « Césaire est mort ! » murmurait-elle, serrant un exemplaire du Cahier du retour au pays natal. Elle n’aurait sûrement pas fait partie du ciblage des potentiels lecteurs de poésie, mais pour elle Césaire… De ces anecdotes, les poètes en auraient tous beaucoup à raconter. Ce sont elles qui justifient d’écrire, sortent le poème des débats théoriques et le confrontent à l’inattendu de son destin.
Exemples, même nombreux, même innombrables, ne font pas preuve. Mais une représentation dominante ne vaut pas davantage vérité. Elle vaut ce qu’elle est : un discours idéologique, qui se donne pour parole de vérité et contribue à la construction d’une réalité prétendument objective. Je ne peux pas la cautionner en tant que poète comme en tant que citoyenne d’ailleurs car le poète n’est, lui-même, personne d’autre que n’importe qui. C’est, en cénacles choisis, l’équivalent des marronniers journalistiques. Il suffit de prendre le risque de donner la parole non pas seulement aux poètes, mais au poème pour s’en apercevoir. Je ne peux pas alimenter le discours convenu même si force est faite d’en constater les méfaits. Pas que sur la poésie au demeurant. Mais, abrégeons, il est presque minuit. Claudique la langue dans sa fatigue. Comme Œdipe au pied bot entre aveuglement et déraison de l’histoire. Le revoilà aède à présent, les allégories ne sont que des oripeaux, dont on se dévêt.
À se dévêtir de ses représentations et de leurs fariboles, de ses assignations et de leurs injonctions, où se trouve donc le poète ? Dans quelque anamorphose qui le révèlerait caché dans l’ombre du buisson ou derrière le pilier d’un parking souterrain ? Dans l’intériorité silencieuse de ceux et celles qui l’accueillent et pour qui il est viatique vital face à une extorsion, moyen de se réapproprier le monde et la parole face au bavardage d’une « société du spectacle » qui le réduit à la version qu’elle en donne dans une illusoire transparence mirador ?
Sur le fil peut-être. Dans une énième figure du poète, en funambule cette fois et où se dit de la place du poète dans la Cité qu’elle est avant tout risquée. Comme est toujours le poème au risque de ne pas exister. Il n’y a pas de place réservée au poète dans la Cité. Toute place circonscrite, désignée comme telle est aux antipodes du poème qui déplace et se déplace. Ailleurs que là où on l’installe à résidence. Nomade, migrant. Levier et moyen de transport. Menacé d’académisme, de dépérissement ou d’inféodation au pouvoir quand sa place est institutionnalisée.
Dérangé, dérangeant? En mouvement. Faisant mouvement. En soi et hors de soi. Explorant l’espace du dedans et l’entour. Déplaçant dans la langue et par la langue. Dé/placé parce que dé/plaçant. Pas de place du poète dans la Cité, mais le zigzag du poème. En allusion à quelque éclair créateur originel ou à quelque modeste allumeur de réverbères convertis en lueurs de portables ? Sur le fil entre nuit et lumière. Clarté du logos et méandres du mythos. Flamboiement apollinien et ivresses dionysiaques. Lucidité et aveuglement. Tout rentre, tout fait ventre dans le poème qui témoigne de nous et interroge la langue, par laquelle se constitue et se dit notre humanité.
Laissons-le sur le fil et se mouvoir sinon dans le vide quantique, du moins entre les précipices, dans l’oxymore, le paradoxe et l’écart des couples contraires d’une condition humaine, à la dualité de laquelle spiritualités ou sagesses espèrent échapper par la réduction à l’un, la fusion au divin ou la cessation des cabrioles du « singe samsarique », mais que le poème travaille de front. De face. Les mains dans le pétrin. À tous les sens du terme. Au pétrissage de la langue pour quelque hypothétique manne partagée et dans l’empêtrement. Avec chacun empêtré dans son histoire et dans l’histoire, dans la langue et dans sa langue quand la langue de la Cité est aussi la manière dont elle se pense. En subvertir codes linguistiques et usages langagiers n’est pas insignifiant. Ce n’est pas dans l’inconscience de ce qu’il fait que le poète distord l’usage usuel de la langue pour la et s’en désempêtrer.
Que le poème désosse le mot à la lettre jusqu’à trouver « mot » dans mort et or en elle, jusqu’à faire comme si l’arbitraire de la langue tendait à l’énigme de la vie et de l’histoire un miroir révélateur, compatissant ou ironique, dans tous les cas, le mot se médite en poésie et c’est dans cet espace langagier que se déploie une parole qui, comme le bâton de Diogène, brise et désigne d’un même mouvement.
7- Nocturne
Ce soir lassitude de « la culture camelote » et des discours. Dans leur inévitable clôture de la parole incompatible avec l’arborescence du poème, ses scansions et ses ramifications rhizomatiques. Cet herbu de la langue qui ne se dit qu’en poésie quand le poème dit ce qui ne se dit qu’en poésie et ne peut se dire hors de ce dire (bis et ad limitum repetita). Me donne l’impression le poète de s’exposer en démarcheur rameutant le chaland en défense et illustration du rôle de la poésie dans la Cité. Cela ne se démontre pas. A lieu. Ou pas. Le poème est action.
Paroles flottantes, fantômes, parasitent le propos. Adorno par exemple : « Je suis prêt à concéder que, tout comme j’ai dit que, après Auschwitz, on ne pouvait plus écrire de poèmes — formule par laquelle je voulais indiquer que la culture ressuscitée me semblait creuse —, on doit dire par ailleurs qu’il faut écrire des poèmes, au sens où Hegel explique, dans l’Esthétique, que, aussi longtemps qu’il existe une conscience de la souffrance parmi les hommes, il doit aussi exister de l’art comme forme objective de cette conscience. »
Culture creuse bien sûr, dans laquelle se débat l’exigence du poème. Souffrance des hommes aussi. Je n’imagine pas de poésie qui ne s’élève contre ce qui diminue dans l’être. Qui, d’une manière ou d’une autre, ne lui dise non. « Fati non foste a viver come bruti /Ma per seguir virtute e conoscenza. » récitait une aïeule florentine psalmodiant La Divine Comédie, « Il y a des choses que non » répétait l’autre en son parler populaire de vieille libertaire. C’est de ce Il y a des choses que non, dont j’ai titré mon dernier livre tout entier traversé par l’Histoire et qui interroge plus explicitement que les autres le destin de la Cité dans le sentiment d’urgence, qui l’a fait naître.
La question du poète dans la Cité est politique autant que poétique et se dresse alors sur la barricade de Delacroix, le poète déguisé à présent en communard au prix de quelque anachronisme pictural. C’est déjà parti pris. Le poète n’est pas toujours juché sur la barricade, même s’il l’est le plus souvent. Péret distinguait les poètes de « l’honneur des poètes » de ceux du « déshonneur des poètes ». Rien ne se dissocie. Tout se diffracte dans l’historicité du poème. Poète-citoyen dit-on volontiers en ce moment. Intéressante redondance pour qui, comme moi, le second est inclus dans le premier. De multiples manières d’ailleurs. S’écarter, faire écart au grand écart de la langue, est aussi politique. Écrire du poème est politique. « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience. » et « comment vivre sans inconnu devant soi ? ». Char bien sûr, pour une parole tranchant au vif.
Le poème est une des manières de dire non à tout ce qui enchaîne ou humilie. De décliner ce « non » jusque dans la langue. Parfois explicitement, mais pas nécessairement. Cela se dit dans et entre les lignes. Dans cet entre qui tend le poème sur le vide de la langue mutique. Qu’il bouscule. Où parfois il s’effondre. Sur lequel parfois tressaille le fil fragile d’une parole tâtonnant au parcours de l’humain. Le plus ample, mais aussi le plus menu de vies minimes et précaires.
Le poème comme résistance à l’entropie. Éveil dans l’indigence de la parole. Ration de survie en des temps de disette mentale. Déni à la désertion de la pensée. Langue résistante, langue consistante, langue nourrissante... J’ai écrit quelque chose d’approchant quelque part. Autrement. En poésie. Me voilà à redire. Mais ce « redire » a partie liée avec le poème et la Cité.
La rumination de et sur la langue, sur soi, sur tout l’entour est travail du poème, travaillant et retravaillant l’évidence. « Ce qui tombe sous le sens ». Le poème dit et redit ce qui tombe sous le sens et sous les sens. Il le redit sans cesse, le re-donnant à entendre. Il dit, re-dit entre le babil du naissant, le babillage amoureux et le radotage d’une très vieille expérience humaine. Face à l’expertise, l’expérience comme risque et concrétion de temps dont nous sommes faits – Rilke : « Il faudrait attendre, accumuler toute une vie le sens et le nectar – une longue vie, si possible – et seulement alors, tout à la fin, pourrait-on écrire dix lignes qui soient bonnes. Car les vers ne sont pas faits, comme les gens le croient, avec des sentiments (ceux-là, on ne les a que trop tôt) – ils sont faits d’expériences vécues. » Cela ne voue pas le poème au grand âge, mais au temps dont il est fait, à la vie. Tsvetaïeva : « Ma spécialité à moi, c’est la vie ». Le poème mâche et remâche dans et par la langue l’expérience d’humanité, qui se recommence pour chacun, il la redit mais ne répète pas – à le faire il s’annule -, toujours en quête de l’autrement dit, autrement dire qui en rende compte dans son avènement. Dans le recommencement du sujet et du poème comme dans le mutant de l’histoire.
À l’usure des mots comme au frai de la monnaie le « tombe sous le sens » tombe dans son dessous. Dans la fosse de l’oubli et du sommeil de l’esprit et des sens. Dans la rigidité du sens ou d’un sens. Alors le poème redit. L’expérience commune. L’irremplaçable de l’instant. Le quelconque commun et unique d’un temps de vie, de chaque vie. Ce qui fait de chacun l’anonyme et l’irremplaçable et pour chacun le goût de la vie. Sur le bout de la langue, la saveur, le savoir, la parole, entre les lèvres qui prononcent le goût de la vie, leurs mouvements en écho au tout mouvement, le poème mâchant les mots dans sa bouche. En pie rouge, jersiaise ou blonde d’Aquitaine le poète, ruminant de la langue pour que revienne au palais la saveur fade de la pluie qui tombe à cet instant, à l’oreille un crissement de pneus sur le gravier ? Leibniziennes précieuses « petites perceptions » : « Il y a à tout moment un infinité de perceptions en nous (…). Ce sont elles qui forment ce je ne sais quoi, ces goûts, ces images, ces qualités des sens, claires dans l’assemblage, mais confuses dans les parties, ces impressions que des corps environnants font sur nous, qui enveloppent l’infini, cette liaison que chaque être a avec tout le reste de l’univers. On peut même dire qu’en conséquence de ces petites perceptions, le présent est gros de l’avenir et chargé du passé, que tout est conspirant... »
Le poème est « conspirant ». Respirant avec. Avec tout. Du majeur au minime. Grillons et galaxies. Il travaille avec ces infimes perceptions, ces sensations qui font le corps vivant et relié à tout, attirant sur elles l’attention et en gardant mémoire. S’efforçant de les convoquer dans la langue comme à la réduction alchimique dans l’œuvre au blanc d’une parole à la fois attentive et trouée par la conscience qu’elle n’évoque jamais que l’absent et l’absence.
Cet infime fugace d’une vie aussi essentiel que les ébranlements de l’histoire n’est pas moins constitutif de la Cité que ses soubresauts. Cette dernière n’est rien si elle n’est plus habitacle de vies vivantes, qui n’est pléonasme qu’à oublier qu’on peut-être mort en vie ou condamné à une mort en vie dans quelque géhenne déclinée aux multiples figures de l’aliénation. Ce sont ces restes que recueille le poème quand il n’est que ce qui reste. Et ce peu qui reste d’une vie, rassemblé dans une attention attentive, rappelle que nous sommes sans raison ni justification et, tout autant que la dénonciation, subvertit la réduction des vies et des corps à leur utilité voire à leur rentabilité.
La gratuité du poème quand à travers la voix de Baudelaire (« La poésie n’a pas d’autre but qu’elle-même ») parmi bien d’autres, il se déclare tel, refusant rôles et justifications, fait écho à celle de la vie, de toute vie. Redisant que nous sommes simplement. Que ce « sommes » somme un être-là immédiat et total. Dans la sommation du poème sinon à un age quod agis d’antique sagesse dans la souvenance que savoir, saveur et sagesse ont même racine dans un sapere (goûter), où se donnent à re-sentir et ressentir le goût de la vie comme l’appétence à être et le désir, du moins à l’attention, la plus extrême attention à toutes formes de vie, aux plus petits tressaillements de la vie. De cela, la Cité peut-elle s’en passer ? Et celle qui s’en passe, de quoi fait-elle l’impasse? De quoi sinon de chacun de nous ?
À l’injonction du pouvoir, qui dresse et soumet les corps, le poème oppose le langage du corps, corps individuel et social qui passe entre les signes, dans le silence des signes. Souffrant ou exultant, peu importe, désignant ce que le signe évacue, présent dans l’encombrant de la chair et des sens, l’encombrement de ce qui meurt et veut vivre, vivre et non servir. Subversif rien qu’en cela. Dans cette présence du corps, que les dévots de toutes croyances vouent aux gémonies (les mystiques, eux, rien là d’étonnant, sont parfois poètes : saint Jean de la Croix, Al-Maʿarri …), que tout pouvoir doit contrôler pour asseoir sa puissance. Nos corps. Auxquels donne séjour et voix le poème, rappelant à la Cité qu’elle en est faite. D’abord et au final de corps mortels. De peu face à la démesure de l’esprit.
Prendre la part du corps, c’est prendre la part à la fois de la jouissance non domestiquée et du refoulé de la mort. Cela fait le poème. Chacun peut l’entendre, mais pas tout le temps. Est-il surprenant que la Cité ne veuille pas, ne puisse pas toujours l’entendre et le pouvoir, les pouvoirs et toutes leurs formes de cléricatures, jamais ?
Avec le poème, c’est le corps qui fait effraction dans la langue et dans la Cité. Toujours peu ou prou à la fois louange d’exister et Memento mori rien qu’à poser les doigts sur l’os du crâne.
8-Memento mori
Memento mori, le poème l’est au delà du « recueil » ou du « tombeau », qui en nomment des formes comme en souvenance des stoïciens opposant sôma, le corps et sêma, signe et cadavre. Recueillant « ce qui reste » dans la conscience que le geste d’écrire face à la mort ne la vainc ni ne la dépasse. Ce n’est pas le durable du poème qui riposte à la poussière, qu’il rejoint tôt ou tard lui aussi, c’est son incandescence. L’éternité est d’instant et d’intensité de quelque manière qu’on la convoque.
Le court-circuit du poème rappelle qu’il y a, souvent, archaïque mémoire du feu dans la pratique poétique et ce jusque dans la métaphore, la rime, l’assonance ou le calembour. Lueur qui étincelle dans les Ténèbres. Ou croit le faire. De la répétition sonore et rythmique de la berceuse à l’incantation ultime du psaume, poèmes et chants président aux passages, veillent aux seuils de la naissance et de la mort. Y font intercession et consolation. Parce qu’il travaille le sens dans la présence aux sens et des sens, d’un même mouvement le poème dit un deuil qui outrepasse chaque deuil. Blesse et répare. Recoud de mots la plaie du sans mot.
Que la poésie contemporaine, du moins ici, ait déboulonné depuis longtemps la statue du poète en thaumaturge, et qu’il y ait belle lurette que, dépouillée de sa prétention à la plénitude du verbe, la poésie n’ait plus ni fonction cathartique ni vocation prophétique, la mort n’en demeure pas moins présente à son socle et à son horizon, qui est simplement le nôtre. Dans la déploration ou le balbutiement, dans un forage de la langue qui en démantèle le corps, brise sa syntaxe, tranche le mot en fin de ligne… À défaut de savoir pourquoi on meurt et de s’y résoudre, se bricole une imitation de la mort. Mimétisme et parodie ensemble. La destruction de la langue y vaut celle des croyances. Dans tout les cas, c’est aussi la mort qui se nomme et fait question dans la question du poème comme elle le fait dans la Cité. Dans sa violence guerrière récurrente, son refoulement au marges d’une Cité privilégiée et apeurée comme dans les charniers de sa périphérie.
Dans la langue du poème rôde le fantôme de la mort. Dans le spectral du réel, fantomatique même dans sa célébration. Car si le poème appelle la présence de l’être dans la langue, il en inscrit d’un même mouvement l’insaisissable, l’impossible arraisonnement. Non pas l’indicible, mais l’ombre portée. Lui-même ombre sonore, traces sur l’écran ou la page. Fantômes. Puissance et impuissance se nourrissent l’une l’autre de leur impossible dissociation. Dans l’évidence et l’évidemment de la langue. À son débord.
Que cela se dise en plein ou en creux, au blanc qui troue le poème ou à la mélopée qui le sature, dans la soustraction, le retrait ou le potlatch langagier et l’outrance, il y a, dans le poème quelque chose qui outre-passe et passe outre à la fois. Cet au-delà-de ne s’entend qu’à la mémoire. Dans l’acte d’écrire décalé de ce qu’il évoque, le poème se souvient, quoiqu’autrement qu’à la remémoration. Dans une remembrance, qui travaille après et avec l’oubli et remembre autrement le corps d’Orphée dispersé par les Ménades, notre corps. Revenant dans la langue après disparition du souvenir. Son lieu et sa matière : le temps. Dont nous sommes. « Les jours s’en vont, je demeure » et où le et la « demeure » apollinarienne sinon au poème penché sur un pont entre deux rives ? Dans son ombre et à son ombre emportée au fil d’une eau héraclitéenne.
Mémoire intime et mémoire de la Cité, le poème se souvient de « nous » réduits au monosyllabe d’un pronom. À un à-la-place-du-nom. Par manière de « dé/nommer ». Le poème nomme et dé/nomme à la fois, conjoignant et disjoignant, liant et déliant d’un même geste. L’oxymore poétique n’est pas qu’une échappatoire. Il faut bien qu’à un moment où un autre s’évacue le réel de l’illusion de le saisir, l’être de l’enclos du nom qui l’y convoque, comme le poète du poème.
Écrire en poésie, c’est aussi se désécrire, s’anonymer dans le quelconque et le commun de ceux et celles, singuliers multiples, qui s’approprient du poème. Altéré ce dernier, ai-je dit, ouvert à l’autre mais aussi modifié par l’autre, les autres autant sinon davantage maîtres de sa destinée que le poète lui-même, qui n’existe qu’à être désapproprié de son poème.
De même écrire est aussi désécrire dans une double récusation de l’indicible comme du rêve de toute puissance. Appeler fantômes dans la langue. Y-a-t-il autre place que fantomatique pour le poème, hantant la Cité d’un revenant, qui revient de nulle part sinon de son profond et hante le vide du mot mort, parfois comparant, jamais comparé - La mort n’est jamais comme - et dont celui qui l’écrit comme celui qui le lit ne peut avoir nulle expérience autre qu’indirecte ? Nul exegi monumentum aere perennius horatien nul mot qui la dit ne soustrait la mort d’elle-même. À cette ultime soustraction que le poème, même exultant, réitère dans l’échappée du mot qui échappe se brisant ou s’enchantant de lui-même, se dit une désappropriation, une dépossession face à tout pouvoir qui accumule biens et signes contre la mort avant de s’effondrer en elle.
Le poème n’est pas étranger à la Cité, si ce terme désigne des vivants rassemblés, il l’est au pouvoir, sur lequel il n’a pas de prise, mais lequel demeure lui aussi sans prise sur lui. Là, une forme de liberté s’éprouve – se sent, s’expérimente, se met à l’épreuve et à la preuve – et se donne à expérimenter et à éprouver. À respirer…
9- Respirer
« Conspirant » le poème, conspirateur de quelque insurrection jamais finie de la langue glissant le « skandalon », sous la botte de l’état de fait et du pouvoir qui l’instaure, prométhéen « voleur de feu » même s’il n’est que « mots qui brillent, mais faiblement, aux confins en grisaille de la conscience » (Bonnefoy), et surtout con-spirant, respirant avec tout.
Noyaux de résistance, agrégats de langue, scansions rythmiques visuelles et sonores qui ponctuent la langue poétique, désignent à la fois un plein – un potentiel de sens – et un vide, une suspension. Un arrêt où bute l’accoutumance du déjà dit, déjà ouï. L’effet, qu’on le nomme satori au butoir du koan, illuminations, sensation retrouvée du corps présent à l’existence tant cela se reformule par chaque poète et dans chaque poème, a un effet de déblayement. Balayeur le poète maintenant ? La rimbaldienne « main à plume » valait la main à la charrue, elle peut aussi valoir la ménagère à l’époussetage domestique de la langue et de soi. Et y faire de l’air. De l’air dans la mécanique du sens arraisonné. Du déblayement et du sonore. De l’écoute d’une musique désignant métaphoriquement ce qui est hors de la prise du signe. Et si ce n’est musique des sphères, dans tous les cas pulsation de la vie, sang et sèves résonnant dans la langue.
Le besoin de poème n’a jamais disparu. Il est toujours là, visible ou latent. Il s’ignore, se refoule, se nie, se musèle. Mais il se dit. De manière directe ou bien indirecte dans la chanson, la poésie populaire, dont la coupure avec la poésie savante a toujours été plus forte dans la poésie française que dans d’autres littératures. Qu’on s’exaspère d’une hégémonie médiatique réduisant la poésie au slam ou au rap est légitime – cette assimilation participe aussi de l’idéologie -, mais, si tout n’est pas dans tout, ce n’est pas raison pour réduire la variété et les possibles du poème. Effets comme visées ne sont pas semblables. Mais, pour piller une fois encore Leibniz « d’un point de vue de la plénitude, un dé à coudre plein est aussi plein qu’un tonneau plein » et du point de vue de la poésie, qu’elle fasse étincelle fugace ou incendie durable, elle n’en participe pas moins du besoin de…respirer.
Avant que l’inspiration ne se dégrade en figure académique, elle est un temps de la respiration. Inspiration, expiration dans la dissymétrie qui fait de la seconde l’euphémisme de mort et de la première non pas l’équivalent de vie, mais d’une vitalité de la vie, d’une énergie, d’une néguentropie. De là à dire qu’elles sont la materia prima du poème, il y a peu et place pour autre chose que d’antiques allégories surannées. À moins de les décaper de leur fatras comme doivent l’être les mots de leur caque quand penser est autre chose que réfléchir ou intellectualiser et méditer autre chose que de se tenir jambes croisées sur le tatami des versions commerciales de la respiration profonde. Qu’y souffle l’esprit à travers les bronchioles, c’est que s’y joignent parfois, énigmatiquement, la chair et la langue et cette double respiration physique et métaphysique quand le poème, comme le pneuma grec et le ruah hébreu signifiant souffle et esprit, joint les deux dans son dire.
Le poème est affaire de souffle, même s’il étrangle ce dernier dans sa gorge. « À force de crier, de bondir, de rouler, j’arrive jusqu’au sens » (Tsvetaïeva.) Et la Cité, qui se débat sous l’emprise, a besoin de respirer. Le poème n’est aussi qu’une façon de respirer. Dedans, dehors.
Du vent le poème, cette futilité ? Tout à fait. Il la récupère et l’inverse d’un coup de langue. Du vent, exactement cela. Un coup de vent dans la Cité. Une brise bienveillante, un mistral décoiffant, un alizé, un noroît, un sirocco, un foehn, un zéphyr, une bise, une tramontane, un squamish …et leur énumération interrompue irruption du monde dans la voix qui l’é-voque dans sa diversité, son inépuisable pluriel, où la Cité, elle-même plurielle, est incluse. Elle l’oublie… Le poème le lui rappelle, appelant, épelant.
10- Hospitalité
Bien sûr la Cité, la « polis », cette organisation humaine du monde. Cette désorganisation aussi. Mais elle est prise dans un tout qui la contient. Quand Hölderlin invite à habiter poétiquement la terre - « Plein de mérites, mais en poète / l'homme habite sur cette terre »-, c’est l’habitacle d’une vie pas seulement humaine qu’il désigne. Et Shelley, de son côté: « la poésie reproduit l’Univers commun, dont nous sommes des parties et des êtres sensibles ». Le poète en militant écologiste avant la lettre ? Il l’est depuis toujours (l’écologie n’est pas que l’environnement) déclinant le « tout conspire avec tout » du vieil Hippocrate. Dans la célébration de toutes les formes de vies.
Laissons aux images d’Épinal la niaiserie poétique « broutant les herbes » à la manière d’un Rousseau brocardé par Voltaire. La conscience comme la sensation d’être partie d’un tout, qu’elle se décline spirituellement au Vide taoïste ou à quelque spinoziste « deus sive natura » traverse l’expérience de l’humain. La relie à tout. La rend dépendante de ce tout.
Le poète, de son côté, mélangerait-il tout ? Il s’entretient avec tout . Avec toutes formes de pensée et de vie. Dans une liberté qui n’est pas confusion, mais brassage, mise en relation, où s’insinue, parfois, peut-être, un in/ouï sans pendant d’« invu ». Même voyant, le poème ne cherche pas le point de vue dominant, mais il arrive qu’il ait de l’oreille. Que cela s’entende dans le poème au triple sens du terme, qui joint ouïr, comprendre et une entente, dont l’appel s’étend à tout de nous et en nous comme à tout autour de nous.
La question n’est toujours que d’entendre et de s’entendre. Dans toutes leurs résonnances. Jeu de mots ? « Il suffit de deux lettres communes pour que les mots cessent de s’ignorer » (Jabès) et quand, dans l’arbitraire de ma langue, le sens et les sens sont homonymes, il y a de quoi méditer. Y-a-t-il dans le poème trace de quelque herméneutique, de quelque pilpoul talmudiste ? Il y a de l’entretien avec tout dans et par la langue – avec soi, avec l’autre, avec les mots et les mondes, l’ici comme l’ailleurs, morts et vivants, bêtes et gens, plantes et pierres, novas et neutrinos, possibles et impossibles. Le fatras de tout. Il y a de l’hospitalité dans le poème. De l’aimant aimant et aimantant. De l’utopie.
La parole poétique ne se tient ni en place ni en aucune place. Ni « dans » la Cité ni hors d’elle. Avec elle toujours, je l’ai dit d’emblée, mais aussi dans la tension vers d’autres possibles d’elle. Possibles assimilables à des avancées émancipatrices, mais, au delà de ces dernières comme avec elles, vers un habitat de l’homme, où il s’habite humainement. « La Poésie est l’expression, par le langage humain ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l’existence: elle doue ainsi d’authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle » (Mallarmé).
Dans tout l’empan humain inhumain de l’humain, que le poème n’ignore pas, dont il participe, il prend le parti de l’hospitalité contre le déshumain, édifiant précaire maison de paroles davantage paillote que monument. « Maison perdue » (De Signoribus), parole toujours perdue sans cesse réinventée dans une décision d’acte de foi dans la parole (non une illusion sur ses pouvoirs), qui n’invoque pas nécessairement le Verbe majusculé, mais invite la langue à un travail d’éthique et de vérité par elle et en elle. Tension vers quelque imprononçé et sans doute imprononçable, qui inscrit l’utopie au cœur de la parole poétique. Elan vers « l’être tel que de toute façon il importe». Vers des « propositions de monde » pour reprendre le mot de Ricœur. Utopie.
L’éthique du poème inscrit son hospitalité par et dans une langue cessant d’arraisonner le sens. Le propre du poème est de se déprendre, dans une insurrection implosive de la langue à son murmure comme à sa clameur et dans la conscience de son impuissance, de son impotence qui sait ne convoquer que l’après-coup de ce qui a lieu ou qui s’évanouit dans son dire, dans l’expérience que le compréhension est autant désappropriation qu’appropriation et qu’il n’y a pas d’issue dans l’emprise.
Parce que le poème, son écriture comme sa lecture, invite au colloque singulier et à cet « usage du propre » dont Hölderlin soulignait qu’il est « la tâche la plus difficile » il parle à la Cité du pouvoir qui l’érige comme de son utopie et d’un être « continuellement engendré par sa propre manière » quand, comme l’écrit Agamben, « cet être engendré par sa propre manière est l’unique bonheur vraiment possible pour les hommes. »
Le poème dit cela autrement. Il ne le formule pas. Il le dessine au creux et au plein de sa langue. L’exprime à sa façon, rigoureusement et inventivement, dans et avec la langue. Rappelant aussi que le langage ne sert pas seulement à dire quelque chose, mais, comme l’épouillage des primates, à mettre en contact, à apprivoiser. Cet apprivoisement hospitalier est, pour moi, inséparable du poème. Loin de la bien-pensance et des bonnes intentions - on n’écrit pas du poème avec des intentions et la fraternité du poème n’est pas niaise (« hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère » interpellait déjà Baudelaire)-. Son hospitalité est dans la désappropriation. Dans l’im/propriété toujours – car à proprement parler la langue du poème est impropre à tout usage utilitaire - il la tente. Dans l’utopie explicite ou implicite d’une cité hospitalière au tout vivant.
11-Joie
Parce qu’au bord de l’« entos thalassa », le ciel est haut. Que cette hauteur et son incandescence appellent à la fois le tragique sans mélancolie et sans tristesse – seulement lucide –la joie. Face à la déploration sur la Cité qui s’égare et aux métamorphoses du poème convoqué à sa tribune et à son tribunal, sa joie. Ou son « augmentation dans l’être » pour la synonymer à l’emporte-pièce façon Spinoza. La joie solaire du Dante dans l’amor che move il sole e l’altre stelle.
La légèreté du poème, indissociable d’une densité, qui n’est pas pesanteur, mais tenue. C’est cela aussi la relation du poème à la Cité. Le corps et l’esprit à leur jointure et non à leur déchirement. Une souplesse (de la vie) qui n’est pas mollesse (celle du sentimentalisme). Une rigueur (l’exigence réitérée du poème) qui n’est pas rigidité (celle du sens rangé au rangement définitif de sa clôture ou de la mort). Une complexité qui n’est pas plus complication que sa simplicité simplisme.
Dans « l’entre » le poème. Entre l’immédiateté de l’expérience de vivre et le recul de l’écriture. Entre la vue et la voix. L’oral et l’écrit dans le retrait des deux pour que l’autre soit. Dans l’entre/tien d’une entre/prise où l’oxymore ne figure que le mouvement. Entre diastole et systole. Tsimtsoum kabbaliste et big-bang de l’univers. Dans l’entre de la vie et son écoute qu’il fait écouter. Mode de contact de l'homme avec les choses et le monde, le poème permet de « concevoir son identité personnelle, de la dégager de ce qui n'est pas elle, de la décrasser, décalaminer, de se signifier de s'éterniser enfin, dans l'objoie » écrivait Ponge au néologisme d’un « objoie » qui en lie l'écriture « non comme la transcription, selon un code conventionnel, de quelque idée mais à la vérité comme un orgasme. »
À la fois une jouissance du corps et de l’esprit dans la langue et un medium stare le poème, une médiane oblique ? Pour moi, oui. Une médiation et une méditation de mots et en mots. Une façon d’être au monde. Indissociablement une forme de vie et une pratique de langue joignant le corps et l’esprit, le langage, l’éthique et l’histoire. Partagée ? Plus ou moins aussi bien dans l’histoire commune que dans celle de chacun. Sinon aléatoire, la rencontre du poème est imprévisible. Minoritaire le poème ? Ce n’est pas disqualifiant. Donné en partage, circulant, mais sans nécessité de s’imposer, d’impéria-(lement et listement) s’étendre. Ni honteux ni paradant, ni zélote ni pénitent. Là présent. Sans ambition de totalité, sans dogme et sans ultime révélation. Sans « solution finale ». Simplement là. Dans la question, la relation. Compagnon de route. Dans l’entretien possible avec ceux que Char nommait « les grands astreignants » et Michaux « les copains de génie ». Dans l’entre/tien au tu de toute parole. Le poème accompagne. Sans plus. Aux côtés et à côté. Silencieusement ou à coup d’éclats. Dans l’attention et l’attente. De bouche à oreille. Du trou au trou comme aimaient à dire les Antiques. Ouvert. Dans l’ouvert. L’ouvert de la vie.
Et cet ouvert est joie. Reçue et offerte.
12- Au mitan
Quoique j’écrive, à la diable et au ping-pong de ma voix avec d’autres, demeure point aveugle. Nul ne se retourne sur son ombre ni ne s’extrait de son époque. « Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps. » (Agamben). Le (ou la) poète a quelque avis (opinion voire jugement tranché) sur son rapport à la Cité, n’exagérons pas dans l’aporie, mais ce n’est pas ce qui importe. Ce qu’il ou elle dit d’essentiel de et à la Cité, il ou elle le dit en poésie. Sans savoir s’il ou elle le fait. Non dans la pose de quelque fausse humilité ou parce qu’il n’y aurait pas au poème à la fois impulsion et retour critique distancé, il n’est que de cela, mais parce qu’il est pris dans l’histoire comme chacun.
Si le poème est manière d’être au monde, de le vivre et de le penser, et en cela, pour moi, effort de clarté, incessant effort de clarté, c’est en poésie que je dis quelque chose si tant est que j’y parvienne. De cela je ne peux avoir la certitude. Ecrire en poésie (cet « en poésie » et non « de la poésie » insistant sur l’usage spécifique de la langue que fait le poème) est un acte risqué. Un pari. Une expérience qui s’expérimente et se dit dans cette langue là. Pas dans une autre.
Il est l’heure non de conclure, le poème récuse la parole conclusive et il en a été peu dit comparé à ce qui resterait à dire, mais de s’interrompre, de briser là comme si, en miroir de l’effraction du poème dans la Cité, se devait couper court sans ambages à la parole du poète. Dans la réciprocité. Dans le manque logé dans toute parole, dans l’appel et l’écoute des paroles de l’autre et d’une parole autre.
Où le poète dans la Cité ? Au mitan. Dans l’attention, l’éveil, la vigilance. À l’écoute dans les entrailles de la Cité, qui n’est ni une ni immobile, mais traversée de flux contradictoires et grosse d’autres d’elle-même à la fois promesses et menaces. En plein milieu et excentré car le milieu n’est pas nécessairement le centre de quelque cercle d’une géométrie trop étroitement euclidienne, ni un lieu de stabilité, mais ce que la mathématique nommerait un point d’inflexion ou la physique ce moment de rupture dans un sens ou un autre à partir d'un centre par nature toujours en mouvement
Au mitan de la Cité en mouvement le poème en mouvement. Et parfois dans le mille. Comme au khât décisif du maître zen dans un art poétique à la manière de la pratique du tir à l’arc. Dans « le faisceau de ténèbres» qui émane du présent, parfois, l’éclat diffracté du poème. Dans la Cité, toujours, un besoin de lumière.













