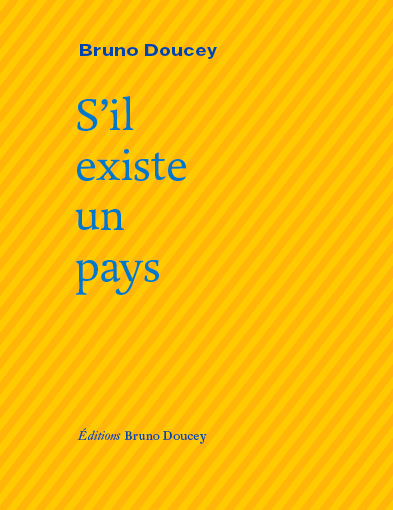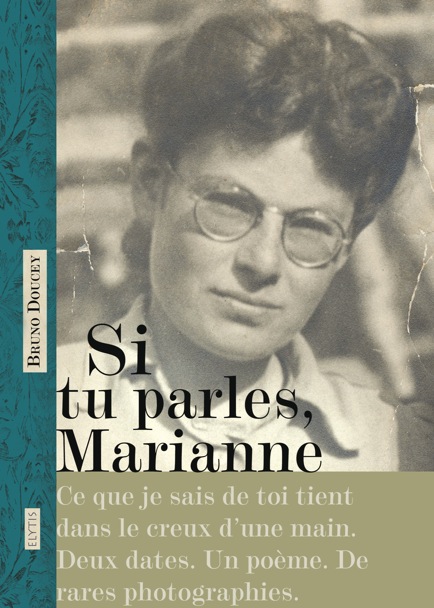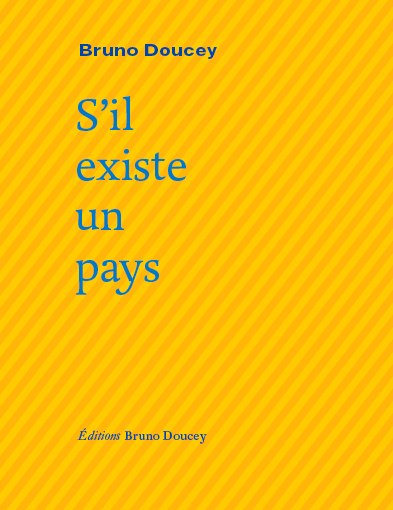BIOBIBLIOGRAPHIE
Bruno Doucey, né en 1961 dans le Jura, est à la fois écrivain et éditeur. Après avoir dirigé les Éditions Seghers, il a fondé une maison d’édition, totalement indépendante, vouée à la défense des poésies du monde et aux valeurs militantes qui l’animent. Sur un plan plus personnel, il est l’auteur d’une œuvre qui mêle l’analyse critique et la poésie, la résistance et le lyrisme, ainsi qu’en témoignent les anthologies de poésie qu’il a publiées aux éditions Gallimard et Seghers (La Poésie engagée, La Poésie lyrique, Je est un autre, Poésies de langue française). Plus encore, ses Poèmes au secret (Le Nouvel Athanor, prix de la SGDL 2007), Agadez ouvrage consacré aux Touareg du Niger (Transbordeurs, 2008) et une série de courts romans consacrés aux poètes qu’on assassine : Victor Jara, non à la dictature (Actes Sud Junior, 2008. Co-lauréat du Prix des Droits de l’Homme 2009) Federico Garcia Lorca, non au franquisme (Actes Sud, 2010) et Si tu parles, Marianne (Elytis, 2014). En 2010, deux de ses recueils paraissent au Québec : Bien loin des pierres éboulées (revue Lèvres urbaines) et La Neuvaine d’amour (Écrits des Forges / Éditions de l’Amandier). À la même époque, il publie un petit livre pour enfants aux éditions À dos d’âne : Théodore Monod, un savant sous les étoiles (2010), récemment complété par Aimé Césaire, un volcan nommé poésie (parution septembre 2014). Maître d’œuvre du Livre des déserts (Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2005), il est selon René Depestre, préfacier de ses poèmes, « un arpenteur des solaires équipées du sable et du vent ». Avec lui, « la poésie s’épanouit en chair et en os, vivement accordée qu’elle est à la bonne combustion naturelle de l’existence. L’enseignement de Paul Eluard possède en l’auteur de ces chants un héritier de rêve ».
Bibliographie sélective
RÉCITS
Si tu parles, Marianne (roman), Éditions Élytis, Bordeaux, 2014.
Aimé Césaire, un volcan nommé poésie, illustrations de Christian Épanya, À dos d’âne, coll. « Des graines et des guides », Paris, 2014.
« S.P.T.C. 22 » (nouvelle) in Non à l’individualisme (avec Gérard Dhôtel, Nimrod, Maria Poblète, Elsa Solal, Murielle Szac), Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », 2011.
L’Aventurier du désert, illustrations de Jean-Michel Charpentier, photographies de Jules Jacques, Élytis, Bordeaux, 2010.
Théodore Monod, un savant sous les étoiles, illustrations de Zaü, À dos d’âne, coll. « Des graines et des guides », Paris, 2010.
Federico Garcia Lorca, non au Franquisme (roman), Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », Paris, 2010. Réédition, 2014.
Victor Jara, non à la dictature (roman), Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », Paris, 2008. Co-lauréat de la Mention spéciale du Prix des Droits de l’homme 2010.
(Livre traduit en portugais, catalan, coréen, allemand, anglais)
La Cité de sable (nouvelles), Rhubarbe, Auxerre, 2007.
(Livre traduit en espagnol)
« Paristanboul » (nouvelle), in Fantômes du jazz, Les Belles Lettres, 2006.
« Le rémanent » (nouvelle), Mystères, diableries et merveilles en Champagne-Ardennes, Le Coq à l’âne, Reims, 2003.
« L’Étrange disparition de Felipe Perez Consuello » (nouvelle), in Une Anthologie de l’imaginaire, Rafaël de Surtis, coll. « Pour une Fontaine de feu », 2000.
Moïse, Retz, Paris, 2001.
(Livre traduit en espagnol)
POÉSIE
Recueils
S’il existe un pays, Éditions Bruno Doucey, coll. « Soleil noir », 2013.
Bien loin des pierres éboulées, in Lèvres urbaines n°42, préface de Claude Beausoleil, Écrits des forges, Trois-Rivières (Québec), 2010.
La Neuvaine d’amour, Écrits des Forges, Trois-Rivières (Québec), 2010 / L’Amandier, Paris, 2010.
Poèmes au secret, Le Nouvel Athanor, Paris, 2006 (Prix de la SGDL 2007). Réédition augmentée en 2008, préface de René Depestre.
Choix de poèmes, in Les Cahiers de Saint-Germain-des-Prés, anthologie n° 5, Le Cherche Midi Éditeur, 1981.
Livres d’artistes
L’attrape-rêves, avec des œuvres de Robert Lobet, Éditions de la Margeride, Nîmes, 2013.
La Neuvaine d’amour, avec des œuvres de Nathalie Fréour, Éditions Opéra, Haute-Goulaine, 2011.
Oratorio pour Federico Garcia Lorca, avec des œuvres de Robert Lobet, Éditions de la Margeride, Nîmes, 2011.
Les Volcans de mon île, avec des gravures d’Ester, Paris, 2011.
Sur un chemin kanak, avec des œuvres de Robert Lobet, Éditions de la Margeride, Nîmes, 2010.
Discographie
Oratorio pour Federico Garcia Lorca et autres poèmes (CD), guitare Pedro Soler, Sous la lime, Paris, 2011. Préface de Jean-Marie Berthier.
Embrasures (CD), poèmes de Bruno Doucey lus par l’auteur, Céline Liger et Claude Aufaure, guitare Jean-Marie Frédéric, Sous la lime, Paris, 2008.
Fulgurances, livret poétique accompagnant le CD du groupe New Tone Jazz Quartet, In the Groove, 1999.
ANTHOLOGIES
Guerre à la guerre, Éditions Bruno Doucey, coll. « Poés’Idéal », à paraître en novembre 2014.
Vive la liberté ! (en collaboration avec Pierre Kobel), Éditions Bruno Doucey, coll. « Poés’Idéal », à paraître en novembre 2014.
La poésie au cœur des arts (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2014.
Les Voix du poème (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2013.
Enfances – Regards de poètes (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2012.
Enfantaisie – Poèmes à lire et à entendre, livre-disque (en collaboration avec Christian Poslaniec), éditions Sous la lime, 2012.
Outremer – Trois océans en poésie (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2011. Grand Prix du livre insulaire 2011.
Terre de femmes – 150 ans de poésie féminine en Haïti, Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2010.
Poésies de langue française, 144 poètes d’aujourd’hui autour du monde (en collaboration avec Stéphane Bataillon et Sylvestre Clancier), Seghers, Paris, 2008.
Je est un autre (en collaboration avec Christian Poslaniec), Seghers, Paris, 2008.
La Poésie lyrique (en collaboration avec Christine Chollet), Gallimard, coll. « La Bibliothèque Gallimard », Paris, 2002.
La Poésie engagée (en collaboration avec Christine Chollet), Gallimard, coll. « La Bibliothèque Gallimard », Paris, 2001.
ESSAIS
Pierre Seghers, Poésie la vie entière : résister, éditer, écrire, Éditions Musée du Montparnasse, / IMEC, Paris, 2011.
Agadez, (avec des photographies d’Edmond Bernus), Transbordeurs, coll. « Cités », Marseille, 2007.
Le Prof et le poète – à l’école de la poésie, Entrelacs, coll. « Connivences », Paris, 2007.
Le Livre des déserts, itinéraires scientifiques, littéraires et spirituels (direction d’ouvrage), Robert Laffont, coll. « Bouquins », Paris, 2006.
La Double Inconstance, de Marivaux, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1997 (nouvelle édition augmentée, 1999).
L’Ile des esclaves, de Marivaux, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1995 (nouvelle édition augmentée, 1999).
Désert, de J.- M. G. Le Clézio, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1994.
Francis Ponge, cinq clefs pour aborder l’oeuvre, cinq textes expliqués, éditions Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1993.
La Ronde de nuit de Patrick Modiano, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1992.
Bibliographie sélective
RÉCITS
Si tu parles, Marianne (roman), Éditions Élytis, Bordeaux, 2014.
Aimé Césaire, un volcan nommé poésie, illustrations de Christian Épanya, À dos d’âne, coll. « Des graines et des guides », Paris, 2014.
« S.P.T.C. 22 » (nouvelle) in Non à l’individualisme (avec Gérard Dhôtel, Nimrod, Maria Poblète, Elsa Solal, Murielle Szac), Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », 2011.
L’Aventurier du désert, illustrations de Jean-Michel Charpentier, photographies de Jules Jacques, Élytis, Bordeaux, 2010.
Théodore Monod, un savant sous les étoiles, illustrations de Zaü, À dos d’âne, coll. « Des graines et des guides », Paris, 2010.
Federico Garcia Lorca, non au Franquisme (roman), Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », Paris, 2010. Réédition, 2014.
Victor Jara, non à la dictature (roman), Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », Paris, 2008. Co-lauréat de la Mention spéciale du Prix des Droits de l’homme 2010.
(Livre traduit en portugais, catalan, coréen, allemand, anglais)
La Cité de sable (nouvelles), Rhubarbe, Auxerre, 2007.
(Livre traduit en espagnol)
« Paristanboul » (nouvelle), in Fantômes du jazz, Les Belles Lettres, 2006.
« Le rémanent » (nouvelle), Mystères, diableries et merveilles en Champagne-Ardennes, Le Coq à l’âne, Reims, 2003.
« L’Étrange disparition de Felipe Perez Consuello » (nouvelle), in Une Anthologie de l’imaginaire, Rafaël de Surtis, coll. « Pour une Fontaine de feu », 2000.
Moïse, Retz, Paris, 2001.
(Livre traduit en espagnol)
POÉSIE
Recueils
S’il existe un pays, Éditions Bruno Doucey, coll. « Soleil noir », 2013.
Bien loin des pierres éboulées, in Lèvres urbaines n°42, préface de Claude Beausoleil, Écrits des forges, Trois-Rivières (Québec), 2010.
La Neuvaine d’amour, Écrits des Forges, Trois-Rivières (Québec), 2010 / L’Amandier, Paris, 2010.
Poèmes au secret, Le Nouvel Athanor, Paris, 2006 (Prix de la SGDL 2007). Réédition augmentée en 2008, préface de René Depestre.
Choix de poèmes, in Les Cahiers de Saint-Germain-des-Prés, anthologie n° 5, Le Cherche Midi Éditeur, 1981.
Livres d’artistes
L’attrape-rêves, avec des œuvres de Robert Lobet, Éditions de la Margeride, Nîmes, 2013.
La Neuvaine d’amour, avec des œuvres de Nathalie Fréour, Éditions Opéra, Haute-Goulaine, 2011.
Oratorio pour Federico Garcia Lorca, avec des œuvres de Robert Lobet, Éditions de la Margeride, Nîmes, 2011.
Les Volcans de mon île, avec des gravures d’Ester, Paris, 2011.
Sur un chemin kanak, avec des œuvres de Robert Lobet, Éditions de la Margeride, Nîmes, 2010.
Discographie
Oratorio pour Federico Garcia Lorca et autres poèmes (CD), guitare Pedro Soler, Sous la lime, Paris, 2011. Préface de Jean-Marie Berthier.
Embrasures (CD), poèmes de Bruno Doucey lus par l’auteur, Céline Liger et Claude Aufaure, guitare Jean-Marie Frédéric, Sous la lime, Paris, 2008.
Fulgurances, livret poétique accompagnant le CD du groupe New Tone Jazz Quartet, In the Groove, 1999.
ANTHOLOGIES
Guerre à la guerre, Éditions Bruno Doucey, coll. « Poés’Idéal », à paraître en novembre 2014.
Vive la liberté ! (en collaboration avec Pierre Kobel), Éditions Bruno Doucey, coll. « Poés’Idéal », à paraître en novembre 2014.
La poésie au cœur des arts (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2014.
Les Voix du poème (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2013.
Enfances – Regards de poètes (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2012.
Enfantaisie – Poèmes à lire et à entendre, livre-disque (en collaboration avec Christian Poslaniec), éditions Sous la lime, 2012.
Outremer – Trois océans en poésie (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2011. Grand Prix du livre insulaire 2011.
Terre de femmes – 150 ans de poésie féminine en Haïti, Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2010.
Poésies de langue française, 144 poètes d’aujourd’hui autour du monde (en collaboration avec Stéphane Bataillon et Sylvestre Clancier), Seghers, Paris, 2008.
Je est un autre (en collaboration avec Christian Poslaniec), Seghers, Paris, 2008.
La Poésie lyrique (en collaboration avec Christine Chollet), Gallimard, coll. « La Bibliothèque Gallimard », Paris, 2002.
La Poésie engagée (en collaboration avec Christine Chollet), Gallimard, coll. « La Bibliothèque Gallimard », Paris, 2001.
ESSAIS
Pierre Seghers, Poésie la vie entière : résister, éditer, écrire, Éditions Musée du Montparnasse, / IMEC, Paris, 2011.
Agadez, (avec des photographies d’Edmond Bernus), Transbordeurs, coll. « Cités », Marseille, 2007.
Le Prof et le poète – à l’école de la poésie, Entrelacs, coll. « Connivences », Paris, 2007.
Le Livre des déserts, itinéraires scientifiques, littéraires et spirituels (direction d’ouvrage), Robert Laffont, coll. « Bouquins », Paris, 2006.
La Double Inconstance, de Marivaux, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1997 (nouvelle édition augmentée, 1999).
L’Ile des esclaves, de Marivaux, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1995 (nouvelle édition augmentée, 1999).
Désert, de J.- M. G. Le Clézio, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1994.
Francis Ponge, cinq clefs pour aborder l’oeuvre, cinq textes expliqués, éditions Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1993.
La Ronde de nuit de Patrick Modiano, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1992.
EXTRAITS
SI TU PARLES, MARIANNE
Éditions Elytis, 2014
Extrait 1
CE que je sais de toi tient dans le creux d’une main. Deux dates. Un poème. De rares photographies. Quelques documents administratifs, simples preuves de ton existence. La conviction que tu n’es pas morte pour rien.
Souvent, ma main je l’ouvre et la regarde. J’y vois le sable du temps qui passe, presque impossible à retenir, puis cette petite étoile qui s’agrippe aux sillons de ma peau. Toi.
Je souffle légèrement dans ma paume ouverte pour déblayer le sable qui m’empêche de voir les contours de la petite étoile. Mes pensées vagabondent, les idées me glissent entre les doigts, ce que je croyais tenir m’échappe. Mais qu’importe, tu es là.
Les choses auraient pu se passer autrement.
Imagine un instant, rien qu’un instant. Je te dis : ferme les yeux, écoute-moi. Je suis né la même année que toi, simplement mes parents sont partis plus tôt. Ils sont arrivés ici, à New York, lorsque j’avais dix ou onze ans. J’en ai dix-huit aujourd’hui et je t’attends sur la jetée, là où les joies et les peines se côtoient, montent et descendent des bateaux, dans un va-et-vient continuel. Je t’attends. C’est un jour de novembre. Il fait froid. Une brume épaisse recouvre l’embouchure de l’Hudson. De l’endroit où je me trouve, on n’aperçoit pas même la statue de la Liberté. Je t’attends depuis des heures, sans prendre garde au froid qui me mord les doigts et la poitrine. Soudain ton bateau apparaît. Le son de la corne de brume d’abord, puis son mufle d’animal essoufflé qui se rapproche jusqu’à venir humer le bois détrempé du ponton.
Maintenant, des gens en descendent. Les valises, les paniers en osier, de lourds baluchons, les nourrissons et les vieillards qu’il faut porter dans une chaîne humaine qui longe tout le quai. Les visages sont fatigués, défaits. Le silence est cousu sur les lèvres et sur les poitrines. À les voir ainsi descendre du bateau, on ne saurait dire si ces gens sont perdus ou sauvés.
Toi, je le sais, tu es sauvée.
Dans un instant, tu franchiras la passerelle. Tes jambes. Tes épaules. Ton sourire. Tout me sera donné d’un coup. Comme les autres, tu attendras ton tour dans les bureaux de l’immigration. Tu es jeune, tu es belle, tu es en bonne santé. Sais-tu qu’ici un sourire comme le tien peut sauver la vie ? […]
Extrait 2
LE sentier serpente entre les arbres dans la chaleur odorante de l’été. Une fois les derniers oliviers franchis, tu t’arrêtes un instant pour t’éponger le front et contempler le village. De l’endroit où tu te trouves, en contrebas de la route, les maisons paraissent imbriquées les unes dans les autres. Seule la couleur les distingue. Certains murs ont été blanchis à la chaux, d’autres ont conservé leur aspect de terre crue, séchée par le soleil, écorcée par les ans.
Tu reprends ta marche silencieuse. La pente est raide et l’on se demande comment les ânes parviennent à tirer les charrettes chargées de branchages ou de sacs en toile remplis d’olives à la saison des récoltes. Au moment d’atteindre les premières maisons, tu croises une vieille femme, vêtue de noir, qui descend la colline à pas lents, le buste légèrement penché sur la canne qui la soutient. Plus loin, c’est un chien qui te regarde passer, sans lever l’oreille, tant la chaleur paraît l’accabler.
À mi-hauteur de la côte, tu avises une porte métallique, entre deux piliers noyés de végétation. Une cour. Des escaliers de pierre. Le perron d’une maison. Te voici dans la pièce à vivre. Tu refermes la porte derrière toi pour éviter que l’air chaud n’y pénètre. Un instant, tu fermes les yeux. Tout te revient en mémoire, l’odeur du vieux plancher, la fraîcheur de l’évier, le silence que le vrombissement des mouches vient parfois troubler. Tu pénètres ici pour la première fois et pourtant tu connais déjà chaque recoin de ces lieux.
Tes parents, ta sœur, où sont-ils ? Tu traverses la pièce pour atteindre la petite porte qui donne sur le jardin. Quelques marches. Une table sur laquelle a été posée une cruche d’eau fraîche. Un couple de tourterelles volètent entre les arbres. Tout est calme, si calme, que l’on croirait l’endroit oublié du reste du monde.
Tu avances lentement. Sur ta gauche, en pleine terre, dans la lumière de l’été, ton petit oranger, celui que la voisine protégeait du vent sur la terrasse de Barcelone. Il est là, devant toi. Des larmes coulent de tes yeux. Tu es heureuse. Tu penses qu’il a réussi à rejoindre les collines, à venir s’enraciner dans le pays des autres orangers. Toi aussi tu es là, maintenant. Tu voudrais dire à tes parents voyez mon petit oranger, nous avons pris des chemins différents, mais nous sommes arrivés sur la même terre, dans la même maison, ensemble.
Tu parles à ton Papa et à ta Maman, tu parles à ta sœur Lisette. Ils sont là, en face de toi, immobiles, presque transparents, dans cette partie du jardin qui domine la vallée. Derrière leurs sihouettes imprécises, tu aperçois les petites fumées qui montent du sol comme des cerfs-volants. Tu hésites à t’approcher. Ta main se tend dans l’espace, comme si elle voulait atteindre les volutes qui s’échappent dans l’air. Tu cherches à te rassurer. Ce sont peut-être des paysans qui travaillent dans les vergers, brûlant les branches mortes qu’ils rassemblent en petits tas, entre les arbres.
À nouveau, tu fermes les yeux. Quand tu les ouvres, il fait nuit. Nuit entre tes quatre murs.
Si tu parles, Marianne, © Éditions Elytis, 2014.
S’IL EXISTE UN PAYS
Éditions Bruno Doucey, 2013
Trois chants pour Yannis Ritsos
1
Monemvassia, 1909
Yannis,
Yannis je te parle
et je parle Ritsos dans ma langue de feu
Le temps qui rêve en nous
déroulant sans relâche l’ombre de ses galets
m’a jeté sur ta rive
Me voici devant toi
vêtu de mes paroles
comme un naufragé
Je découvre d’abord le vaisseau de l’enfance
sous les très hautes voiles des moissons de la mer
Monemvassia, en Laconie, sud-est du Péloponnèse
un grand rocher escarpé, forteresse de ta naissance
Quand ton père, et le père de ton père nourrissaient des familles
de laboureurs à perte d’horizon, comme des pierres immortelles
Frère du premier mai, sais-tu que les poètes rêvent de naître
un premier mai dans une maison-presqu’île construite sur la mer
Mais toi
la vie soudain bascule
un patriarche sur ses terres, assassiné
une serrure qui saute, le vent de la déroute qui vient tout emporter
Mais toi
le frère mort
la mère morte
ton père devenu fou
la ruine qui menace jusqu’aux raisons de vivre
Maison morte vouée aux ombres de la nuit, ton salut
viendra des mots, de la pluie, couvée d’offrandes sur tes lèvres
Et Yannis qui danse
Yannis fait danser Ritsos
à deux pas de l’abîme
les bras tendus vers les étoiles
2
Salonique, 1936
Les ouvriers
des manufactures de tabac
défilent dans la ville
La dictature dresse
d’acier sa herse
sur le cou des colombes
Au milieu de la rue
une mère pleure
son fils abattu
Le lendemain, poète, tu découvres dans les journaux
la photo de cette mère courbée sur le cadavre de son fils
Son cri te brûle, sa détresse, inhumaine détresse, taraude
le fils, le père, le frère, l’amant, l’homme qui est en toi
Et tes mots de poète rouleront sur ses joues, tes mots
de tous les jours endimanchés de deuil sur la tombe des anges
Qu’il était bon et doux
ce fils que perdent
toutes les mères
Que le printemps l’aimait
ce fils vêtu
de mort en mai
Ton livre sera brûlé
devant les colonnes
d’un temple à Athènes
3
Léros, 1968
Un homme, on le dit mort
mais la lumière pose sa main sur vos épaules
Une île, on la croit belle
mais c’est une prison où séjournent des ombres
Un homme, une île
La lune le voyait descendre à la rive chaque nuit
Il y venait écrire
Son chant d’amour en guerre, ses peines journalières
Sa terreur épousée
La trace de ses pas sur le sable encagé
Et cette envie
de vivre à coudre dans le ciel la natte des étoiles
*
Prisonnier
qui secoues dans les airs la suie de ton chagrin
Funambule banni
dont les rêves tiennent en équilibre sur un fil
Toi chant
que les oiseaux couronnent à la cime des arbres
Je te parle
tout bas dans la forêt des gardes à l’âme pétrifiée
Tu m’entends
je le sens au frémir de l’eau sous la paume du vent
À la gouttière
qui s’emplit comme un duvet de rouge-gorge en hiver
*
Tes mots
de poète enfermé à ciel ouvert sans rime ni raison
Sinuent sous les paupières
dévissent les verrous de la nuit aux quatre coins du monde
Ils creusent des sillons
sous la mer, sous la terre, dans la roche de l’indifférence
Quand vient le jour
tu les caches comme des raisons de Corinthe dans une poche trouée
Oiseleur de la liberté
tes bouteilles au vent du large, à la frégate de l’amour
Toi Yannis mon frère
qui offre à l’avenir sa moisson de lumière.
S’il existe un pays © Éditions Bruno Doucey, 2013.
POÈMES INÉDITS, été 2014
Sept fragments apocryphes d’un poème de Yannis Ritsos
traduits du grec par le vent de l’été
1
Dans ce pays
L’aube est une vieille femme vêtue de noir
Qui s’amenuise dans la lumière
Le crépuscule
Une jeune fille qui revient de la fontaine
Un filet d’eau au bout de chaque doigt
2
Dans ce pays
L’ombre de la mélancolie
S’attable à la taverne
Elle fume peu
Mais boit lentement le raki du silence
Dehors
La liberté s’impatiente
Et s’envole
3
Dans ce pays
Une jeune femme du bout du monde
Offre un nid à l’hirondelle des regards
Dans la lumière
Sa chevelure est une ruche
Et son sourire ouvre depuis toujours
Une brèche dans les montagnes
Devant elle
Les marins drapés de nuit
Posent leurs armes
4
Ce pays sommeille dans les pierres
Il est sec
Mais ne s’étonne pas de voir l’eau
Remonter la pente des collines
Chacune d’elles abrite un joueur de flûte
Qui fait chanter l’écorce des arbres
Depuis quatre mille ans
L’horizon qu’il porte en lui
Sort de terre chaque année
Et chaque année la mince tige de roseau qu’il porte à ses lèvres
Éveille le vent d’été et la moisson des astres
5
Les chapelles blanches de ce pays
Gardent en elle toutes les couleurs du passé
Petites pierres posées
Sur la main d’un géant
Les dragons que l’on y terrasse
Protègent les enfants nés
Des amours de la pierre et de la lune
6
Dans ce pays
Les vieilles femmes
Vont toujours de l’ombre à la lumière
Elles mangent peu
Mais tiennent captive en elles
La chaleur du soleil
Quelquefois l’une d’elles
Dévisage la mort
Sur la margelle d’un puits
7
Ce pays tient tout entier
Dans un jardin
Et ce jardin est entré depuis longtemps
Dans la corolle d’une fleur
Il renaît chaque matin
Comme le sourire d’une femme
Devant le temps d’Itanos
La fente âcre de la roche
Laisser passer suffisamment de lumière
Pour que les hommes puissent poursuivre leur route
Chaque matin
Un enfant naît en chantant
Et le murmure d’une main
S’efface devant la mort
Dans ce pays
Il ne vient à personne l’idée de compter les étoiles
Ou les chèvres d’un troupeau
Seuls comptent
Le bélier de la nuit
Et le moutonnement des vagues
Qui claquent contre la barque du pêcheur
Dans ce pays
Une seule jarre enferme plus d’eau fraîche
Que n’en contient le ciel.
Ulysse rêvant
Je ne dors pas à tes côtés, je glisse
dans le sommeil comme une ombre s’allonge
sur les draps de la mer, jambes d’étrave,
bras de cordage, mes chants de marin fou
rêvant ton môle à chaque escale
Tu ne dors pas à mes côtés, tu vogues
en caravelle sur la peau des étoiles
l’ombre qui te visite provient des mots
que tu écris pour un marin perdu
la voie lactée est ton opium
Nous sommes l’un et l’autre en voyage
dans un grand lit toutes voiles ouvertes
le vent y souffle histoires et poèmes
tissés de nuit, habillés de lumière
où sont serments d’amour en mer.
Ils ont offert un visage à la pierre…
Ils ont offert un visage à la pierre
Et la pierre est entrée
Dans la légende des hommes
Elle a cherché son nom
Sur les lèvres du vent
Dans les sourires du sentier
Sous l’humus des nuits
La pierre n’avait encore
Ni rêves ni désir d’envol
Mais elle sentait le goût du sel
Sur la peau du sommeil
Elle sentait les regards
Courir le long de ses veines
Défier le gel
Conjurer le feu
Ils ont offert un visage à la pierre
Sans se douter
Qu’ils chérissaient leurs femmes
Et libéraient à chaque mouvement d’épaule
De grands oiseaux de mer
En ce temps-là
La guerre ne connaissait
Que l’autre versant des collines
Là où les pierres n’avaient
Ni nom ni âme
Ni rien qui puisse éveiller
La fierté d’être au monde
Ils ont offert un visage à la pierre
Et la pierre ainsi promise à la main du semeur
La pierre ainsi caressée par l’ombre des nuages
La pierre enlacée comme un sexe aux racines de l’olivier
La pierre-oiseau qui emportait chaque jour un morceau de ciel
La pierre confiait aux hommes
La patience de la lune
Et les promesses du soleil
Mais cela n’a pas suffi aux hommes
Il a fallu qu’ils aillent charrier la terre
Jusqu’à retourner l’horizon
La pierre est morte
Lorsque les hommes l’ont lancée
Sur d’autres hommes.
© Bruno Doucey.
FEDERICO GARCIA LORCA, NON AU FRANQUISME
Éditions Actes Sud Junior, 2010, réédition 2014.
Sierra de Huetor, Source des Larmes
On le vit cheminer entre les fusils…
Des étoiles scintillaient encore dans le ciel de Grenade quand les portes se sont ouvertes. Les bâtiments du Gouvernement civil ont recraché des petits groupes de soldats à la mine grave, puis une colonne s’est formée dans la rue, entre les véhicules dont les moteurs ronronnaient déjà. Quelques instants plus tard, des miliciens accompagnés du commandant José Valdès Guzman, sont sortis de l’édifice. Dans la pénombre du premier matin, personne ne distinguait les traits de l’homme que l’on escortait sans ménagement. Quand il fut hissé dans le camion parmi les autres prisonniers, chacun le reconnut : c’était Federico Garcia Lorca.
Le jour se levait quand le convoi atteignit les contreforts de la montagne de Huétor. Les prisonniers placés à l’arrière des camions apercevaient les collines couvertes d’oliviers et le romarin des talus. Au loin, Grenade s’éveillait sous les scintillements de la Sierra Nevada. Quand le convoi atteignit les premières maisons de Viznar, Dioscoro Galindo, un maître d’école arrêté pour s’être exprimé en faveur de la laïcité, prit la parole dans un sanglot :
- Est-il vrai… est-il bien vrai que l’on voit défiler sa vie au moment de mourir ?
Personne ne sut que lui répondre, mais dans les cahotements de la route, chacun put entendre ces vers monter comme un vent chaud d’été à l’assaut des collines :
Nul ne te connaît plus. Non. Mais moi je te chante.
Je chante pour demain ton profil et ta grâce
…….
Il tardera longtemps à naître, s’il naît un jour,
un Andalou si clair, si riche d’aventure.
Je dis son élégance avec des mots qui pleurent
Comme une triste brise parmi les oliviers.
On le vit cheminer entre les fusils…
Les camions se sont arrêtés au bout du chemin. Les prisonniers avancent maintenant au-dessus du ravin, dans les coteaux boisés qui s’étendent entre les villages de Viznar et d’Alcafar. Une forte odeur de putréfaction s’échappe des fossés, obligeant certains miliciens à détourner la tête ou à placer un carré de tissu contre leur visage.
Cet endroit situé à quelques kilomètres de Grenade, Federico le connaît bien. N’a t-il pas emprunté plusieurs fois le mauvais chemin qui serpente jusqu’à Viznar ? Il y a quatre ou cinq ans, c’était avec La Barraca, le théâtre ambulant et gratuit que soutenait la toute jeune République. La Barraca… Quelle époque heureuse ! Quels moments forts de la vie ! En quelques années, Federico avait entraîné sa troupe sur toutes les routes d’Espagne, afin de faire connaître aux gens les plus démunis les chefs d’œuvre du répertoire classique. Cervantés, Lope de Vega, Caderon de la Barca et tant d’auteurs inconnus… Non, cette vie-là n’était pas un songe, l’Espagne était alors un pays libre.
Le ravin de Viznar, Federico le connaît pour y être allé quand il était enfant. Oui, c’est bien là, dans cette direction, que se situe Fuente Grande, celle que les Maures appelaient autrefois Ainadamar, la « Source des Larmes ».
- Dieu sait de quelles larmes il s’agit aujourd’hui, se dit Federico en entendant les premières déflagrations. C’est donc ici que nous allons mourir.
Un instant, l’idée le traverse qu’il pourrait fuir à travers les coteaux ou s’envoler comme un oiseau. Lui qui n’a jamais aimé les adieux. Lui qui filait parfois à l’anglaise pour adoucir l’angoisse des séparations.
- N’ai-je pas dit à mes amis que j’avais « la terreur de la mort » ? Que j’étais épouvanté à l’idée de « sentir que je m’en vais, que je vais me dire adieu à moi-même… »
Tandis qu’on l’emmène au bord du ravin, Federico songe au visage qu’il a refusé de voir ce jour d’août 1934, quand le sang d’Ignacio a coulé dans les arènes de Manzanares. Ignacio Sanchez Mejias, son ami, son frère, l’un des plus beaux matadors que l’Espagne ait porté. Un homme sublime qui courtisait la mort en faisant ondoyer sa cape rouge. Ignacio qui mena son dernier combat à cinq heures du soir, dans une bourgade de la Manche, sous les yeux d’un public tétanisé. Ignacio dont les blessures brillaient comme des soleils, et que Federico n’a pu regarder en face.
Ce n’est pas le peloton chargé de l’exécuter que Federico Garcia Lorca voit devant lui, en ce petit jour d’août 1936. Non, ce qu’il voit, tandis que ses bourreaux préparent leurs armes, c’est le poitrail du taureau qui défie le matador, la corne qui pénètre dans l’abdomen de l’homme qui va, la tête haute, à la rencontre de son destin. Pauvre Ignacio qui fit tout pour échapper à la mort que chacun de ses gestes provoquait…
Les Franquistes ont maintenant le doigt posé sur la gâchette. Le soleil darde ses premiers rayons sur la chevelure noire de Federico, mais personne n’ose regarder en face l’homme qui va mourir. Dans un souffle, le poète croit encore entendre la voix de son ami. Oui, c’est elle, c’est bien elle qui bruisse à ses oreilles, comme une triste brise parmi les oliviers :
- Federico, Federico, le savais-tu ? Écoute-moi, le taureau se nommait Granadino.
Federico Garcia Lorca, Non au franquisme, © Éditions Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », 2010. Réédition 2014.
Éditions Elytis, 2014
Extrait 1
CE que je sais de toi tient dans le creux d’une main. Deux dates. Un poème. De rares photographies. Quelques documents administratifs, simples preuves de ton existence. La conviction que tu n’es pas morte pour rien.
Souvent, ma main je l’ouvre et la regarde. J’y vois le sable du temps qui passe, presque impossible à retenir, puis cette petite étoile qui s’agrippe aux sillons de ma peau. Toi.
Je souffle légèrement dans ma paume ouverte pour déblayer le sable qui m’empêche de voir les contours de la petite étoile. Mes pensées vagabondent, les idées me glissent entre les doigts, ce que je croyais tenir m’échappe. Mais qu’importe, tu es là.
Les choses auraient pu se passer autrement.
Imagine un instant, rien qu’un instant. Je te dis : ferme les yeux, écoute-moi. Je suis né la même année que toi, simplement mes parents sont partis plus tôt. Ils sont arrivés ici, à New York, lorsque j’avais dix ou onze ans. J’en ai dix-huit aujourd’hui et je t’attends sur la jetée, là où les joies et les peines se côtoient, montent et descendent des bateaux, dans un va-et-vient continuel. Je t’attends. C’est un jour de novembre. Il fait froid. Une brume épaisse recouvre l’embouchure de l’Hudson. De l’endroit où je me trouve, on n’aperçoit pas même la statue de la Liberté. Je t’attends depuis des heures, sans prendre garde au froid qui me mord les doigts et la poitrine. Soudain ton bateau apparaît. Le son de la corne de brume d’abord, puis son mufle d’animal essoufflé qui se rapproche jusqu’à venir humer le bois détrempé du ponton.
Maintenant, des gens en descendent. Les valises, les paniers en osier, de lourds baluchons, les nourrissons et les vieillards qu’il faut porter dans une chaîne humaine qui longe tout le quai. Les visages sont fatigués, défaits. Le silence est cousu sur les lèvres et sur les poitrines. À les voir ainsi descendre du bateau, on ne saurait dire si ces gens sont perdus ou sauvés.
Toi, je le sais, tu es sauvée.
Dans un instant, tu franchiras la passerelle. Tes jambes. Tes épaules. Ton sourire. Tout me sera donné d’un coup. Comme les autres, tu attendras ton tour dans les bureaux de l’immigration. Tu es jeune, tu es belle, tu es en bonne santé. Sais-tu qu’ici un sourire comme le tien peut sauver la vie ? […]
Extrait 2
LE sentier serpente entre les arbres dans la chaleur odorante de l’été. Une fois les derniers oliviers franchis, tu t’arrêtes un instant pour t’éponger le front et contempler le village. De l’endroit où tu te trouves, en contrebas de la route, les maisons paraissent imbriquées les unes dans les autres. Seule la couleur les distingue. Certains murs ont été blanchis à la chaux, d’autres ont conservé leur aspect de terre crue, séchée par le soleil, écorcée par les ans.
Tu reprends ta marche silencieuse. La pente est raide et l’on se demande comment les ânes parviennent à tirer les charrettes chargées de branchages ou de sacs en toile remplis d’olives à la saison des récoltes. Au moment d’atteindre les premières maisons, tu croises une vieille femme, vêtue de noir, qui descend la colline à pas lents, le buste légèrement penché sur la canne qui la soutient. Plus loin, c’est un chien qui te regarde passer, sans lever l’oreille, tant la chaleur paraît l’accabler.
À mi-hauteur de la côte, tu avises une porte métallique, entre deux piliers noyés de végétation. Une cour. Des escaliers de pierre. Le perron d’une maison. Te voici dans la pièce à vivre. Tu refermes la porte derrière toi pour éviter que l’air chaud n’y pénètre. Un instant, tu fermes les yeux. Tout te revient en mémoire, l’odeur du vieux plancher, la fraîcheur de l’évier, le silence que le vrombissement des mouches vient parfois troubler. Tu pénètres ici pour la première fois et pourtant tu connais déjà chaque recoin de ces lieux.
Tes parents, ta sœur, où sont-ils ? Tu traverses la pièce pour atteindre la petite porte qui donne sur le jardin. Quelques marches. Une table sur laquelle a été posée une cruche d’eau fraîche. Un couple de tourterelles volètent entre les arbres. Tout est calme, si calme, que l’on croirait l’endroit oublié du reste du monde.
Tu avances lentement. Sur ta gauche, en pleine terre, dans la lumière de l’été, ton petit oranger, celui que la voisine protégeait du vent sur la terrasse de Barcelone. Il est là, devant toi. Des larmes coulent de tes yeux. Tu es heureuse. Tu penses qu’il a réussi à rejoindre les collines, à venir s’enraciner dans le pays des autres orangers. Toi aussi tu es là, maintenant. Tu voudrais dire à tes parents voyez mon petit oranger, nous avons pris des chemins différents, mais nous sommes arrivés sur la même terre, dans la même maison, ensemble.
Tu parles à ton Papa et à ta Maman, tu parles à ta sœur Lisette. Ils sont là, en face de toi, immobiles, presque transparents, dans cette partie du jardin qui domine la vallée. Derrière leurs sihouettes imprécises, tu aperçois les petites fumées qui montent du sol comme des cerfs-volants. Tu hésites à t’approcher. Ta main se tend dans l’espace, comme si elle voulait atteindre les volutes qui s’échappent dans l’air. Tu cherches à te rassurer. Ce sont peut-être des paysans qui travaillent dans les vergers, brûlant les branches mortes qu’ils rassemblent en petits tas, entre les arbres.
À nouveau, tu fermes les yeux. Quand tu les ouvres, il fait nuit. Nuit entre tes quatre murs.
Si tu parles, Marianne, © Éditions Elytis, 2014.
S’IL EXISTE UN PAYS
Éditions Bruno Doucey, 2013
Trois chants pour Yannis Ritsos
1
Monemvassia, 1909
Yannis,
Yannis je te parle
et je parle Ritsos dans ma langue de feu
Le temps qui rêve en nous
déroulant sans relâche l’ombre de ses galets
m’a jeté sur ta rive
Me voici devant toi
vêtu de mes paroles
comme un naufragé
Je découvre d’abord le vaisseau de l’enfance
sous les très hautes voiles des moissons de la mer
Monemvassia, en Laconie, sud-est du Péloponnèse
un grand rocher escarpé, forteresse de ta naissance
Quand ton père, et le père de ton père nourrissaient des familles
de laboureurs à perte d’horizon, comme des pierres immortelles
Frère du premier mai, sais-tu que les poètes rêvent de naître
un premier mai dans une maison-presqu’île construite sur la mer
Mais toi
la vie soudain bascule
un patriarche sur ses terres, assassiné
une serrure qui saute, le vent de la déroute qui vient tout emporter
Mais toi
le frère mort
la mère morte
ton père devenu fou
la ruine qui menace jusqu’aux raisons de vivre
Maison morte vouée aux ombres de la nuit, ton salut
viendra des mots, de la pluie, couvée d’offrandes sur tes lèvres
Et Yannis qui danse
Yannis fait danser Ritsos
à deux pas de l’abîme
les bras tendus vers les étoiles
2
Salonique, 1936
Les ouvriers
des manufactures de tabac
défilent dans la ville
La dictature dresse
d’acier sa herse
sur le cou des colombes
Au milieu de la rue
une mère pleure
son fils abattu
Le lendemain, poète, tu découvres dans les journaux
la photo de cette mère courbée sur le cadavre de son fils
Son cri te brûle, sa détresse, inhumaine détresse, taraude
le fils, le père, le frère, l’amant, l’homme qui est en toi
Et tes mots de poète rouleront sur ses joues, tes mots
de tous les jours endimanchés de deuil sur la tombe des anges
Qu’il était bon et doux
ce fils que perdent
toutes les mères
Que le printemps l’aimait
ce fils vêtu
de mort en mai
Ton livre sera brûlé
devant les colonnes
d’un temple à Athènes
3
Léros, 1968
Un homme, on le dit mort
mais la lumière pose sa main sur vos épaules
Une île, on la croit belle
mais c’est une prison où séjournent des ombres
Un homme, une île
La lune le voyait descendre à la rive chaque nuit
Il y venait écrire
Son chant d’amour en guerre, ses peines journalières
Sa terreur épousée
La trace de ses pas sur le sable encagé
Et cette envie
de vivre à coudre dans le ciel la natte des étoiles
*
Prisonnier
qui secoues dans les airs la suie de ton chagrin
Funambule banni
dont les rêves tiennent en équilibre sur un fil
Toi chant
que les oiseaux couronnent à la cime des arbres
Je te parle
tout bas dans la forêt des gardes à l’âme pétrifiée
Tu m’entends
je le sens au frémir de l’eau sous la paume du vent
À la gouttière
qui s’emplit comme un duvet de rouge-gorge en hiver
*
Tes mots
de poète enfermé à ciel ouvert sans rime ni raison
Sinuent sous les paupières
dévissent les verrous de la nuit aux quatre coins du monde
Ils creusent des sillons
sous la mer, sous la terre, dans la roche de l’indifférence
Quand vient le jour
tu les caches comme des raisons de Corinthe dans une poche trouée
Oiseleur de la liberté
tes bouteilles au vent du large, à la frégate de l’amour
Toi Yannis mon frère
qui offre à l’avenir sa moisson de lumière.
S’il existe un pays © Éditions Bruno Doucey, 2013.
POÈMES INÉDITS, été 2014
Sept fragments apocryphes d’un poème de Yannis Ritsos
traduits du grec par le vent de l’été
1
Dans ce pays
L’aube est une vieille femme vêtue de noir
Qui s’amenuise dans la lumière
Le crépuscule
Une jeune fille qui revient de la fontaine
Un filet d’eau au bout de chaque doigt
2
Dans ce pays
L’ombre de la mélancolie
S’attable à la taverne
Elle fume peu
Mais boit lentement le raki du silence
Dehors
La liberté s’impatiente
Et s’envole
3
Dans ce pays
Une jeune femme du bout du monde
Offre un nid à l’hirondelle des regards
Dans la lumière
Sa chevelure est une ruche
Et son sourire ouvre depuis toujours
Une brèche dans les montagnes
Devant elle
Les marins drapés de nuit
Posent leurs armes
4
Ce pays sommeille dans les pierres
Il est sec
Mais ne s’étonne pas de voir l’eau
Remonter la pente des collines
Chacune d’elles abrite un joueur de flûte
Qui fait chanter l’écorce des arbres
Depuis quatre mille ans
L’horizon qu’il porte en lui
Sort de terre chaque année
Et chaque année la mince tige de roseau qu’il porte à ses lèvres
Éveille le vent d’été et la moisson des astres
5
Les chapelles blanches de ce pays
Gardent en elle toutes les couleurs du passé
Petites pierres posées
Sur la main d’un géant
Les dragons que l’on y terrasse
Protègent les enfants nés
Des amours de la pierre et de la lune
6
Dans ce pays
Les vieilles femmes
Vont toujours de l’ombre à la lumière
Elles mangent peu
Mais tiennent captive en elles
La chaleur du soleil
Quelquefois l’une d’elles
Dévisage la mort
Sur la margelle d’un puits
7
Ce pays tient tout entier
Dans un jardin
Et ce jardin est entré depuis longtemps
Dans la corolle d’une fleur
Il renaît chaque matin
Comme le sourire d’une femme
Devant le temps d’Itanos
La fente âcre de la roche
Laisser passer suffisamment de lumière
Pour que les hommes puissent poursuivre leur route
Chaque matin
Un enfant naît en chantant
Et le murmure d’une main
S’efface devant la mort
Dans ce pays
Il ne vient à personne l’idée de compter les étoiles
Ou les chèvres d’un troupeau
Seuls comptent
Le bélier de la nuit
Et le moutonnement des vagues
Qui claquent contre la barque du pêcheur
Dans ce pays
Une seule jarre enferme plus d’eau fraîche
Que n’en contient le ciel.
Ulysse rêvant
Je ne dors pas à tes côtés, je glisse
dans le sommeil comme une ombre s’allonge
sur les draps de la mer, jambes d’étrave,
bras de cordage, mes chants de marin fou
rêvant ton môle à chaque escale
Tu ne dors pas à mes côtés, tu vogues
en caravelle sur la peau des étoiles
l’ombre qui te visite provient des mots
que tu écris pour un marin perdu
la voie lactée est ton opium
Nous sommes l’un et l’autre en voyage
dans un grand lit toutes voiles ouvertes
le vent y souffle histoires et poèmes
tissés de nuit, habillés de lumière
où sont serments d’amour en mer.
Ils ont offert un visage à la pierre…
Ils ont offert un visage à la pierre
Et la pierre est entrée
Dans la légende des hommes
Elle a cherché son nom
Sur les lèvres du vent
Dans les sourires du sentier
Sous l’humus des nuits
La pierre n’avait encore
Ni rêves ni désir d’envol
Mais elle sentait le goût du sel
Sur la peau du sommeil
Elle sentait les regards
Courir le long de ses veines
Défier le gel
Conjurer le feu
Ils ont offert un visage à la pierre
Sans se douter
Qu’ils chérissaient leurs femmes
Et libéraient à chaque mouvement d’épaule
De grands oiseaux de mer
En ce temps-là
La guerre ne connaissait
Que l’autre versant des collines
Là où les pierres n’avaient
Ni nom ni âme
Ni rien qui puisse éveiller
La fierté d’être au monde
Ils ont offert un visage à la pierre
Et la pierre ainsi promise à la main du semeur
La pierre ainsi caressée par l’ombre des nuages
La pierre enlacée comme un sexe aux racines de l’olivier
La pierre-oiseau qui emportait chaque jour un morceau de ciel
La pierre confiait aux hommes
La patience de la lune
Et les promesses du soleil
Mais cela n’a pas suffi aux hommes
Il a fallu qu’ils aillent charrier la terre
Jusqu’à retourner l’horizon
La pierre est morte
Lorsque les hommes l’ont lancée
Sur d’autres hommes.
© Bruno Doucey.
FEDERICO GARCIA LORCA, NON AU FRANQUISME
Éditions Actes Sud Junior, 2010, réédition 2014.
Sierra de Huetor, Source des Larmes
On le vit cheminer entre les fusils…
Des étoiles scintillaient encore dans le ciel de Grenade quand les portes se sont ouvertes. Les bâtiments du Gouvernement civil ont recraché des petits groupes de soldats à la mine grave, puis une colonne s’est formée dans la rue, entre les véhicules dont les moteurs ronronnaient déjà. Quelques instants plus tard, des miliciens accompagnés du commandant José Valdès Guzman, sont sortis de l’édifice. Dans la pénombre du premier matin, personne ne distinguait les traits de l’homme que l’on escortait sans ménagement. Quand il fut hissé dans le camion parmi les autres prisonniers, chacun le reconnut : c’était Federico Garcia Lorca.
Le jour se levait quand le convoi atteignit les contreforts de la montagne de Huétor. Les prisonniers placés à l’arrière des camions apercevaient les collines couvertes d’oliviers et le romarin des talus. Au loin, Grenade s’éveillait sous les scintillements de la Sierra Nevada. Quand le convoi atteignit les premières maisons de Viznar, Dioscoro Galindo, un maître d’école arrêté pour s’être exprimé en faveur de la laïcité, prit la parole dans un sanglot :
- Est-il vrai… est-il bien vrai que l’on voit défiler sa vie au moment de mourir ?
Personne ne sut que lui répondre, mais dans les cahotements de la route, chacun put entendre ces vers monter comme un vent chaud d’été à l’assaut des collines :
Nul ne te connaît plus. Non. Mais moi je te chante.
Je chante pour demain ton profil et ta grâce
…….
Il tardera longtemps à naître, s’il naît un jour,
un Andalou si clair, si riche d’aventure.
Je dis son élégance avec des mots qui pleurent
Comme une triste brise parmi les oliviers.
On le vit cheminer entre les fusils…
Les camions se sont arrêtés au bout du chemin. Les prisonniers avancent maintenant au-dessus du ravin, dans les coteaux boisés qui s’étendent entre les villages de Viznar et d’Alcafar. Une forte odeur de putréfaction s’échappe des fossés, obligeant certains miliciens à détourner la tête ou à placer un carré de tissu contre leur visage.
Cet endroit situé à quelques kilomètres de Grenade, Federico le connaît bien. N’a t-il pas emprunté plusieurs fois le mauvais chemin qui serpente jusqu’à Viznar ? Il y a quatre ou cinq ans, c’était avec La Barraca, le théâtre ambulant et gratuit que soutenait la toute jeune République. La Barraca… Quelle époque heureuse ! Quels moments forts de la vie ! En quelques années, Federico avait entraîné sa troupe sur toutes les routes d’Espagne, afin de faire connaître aux gens les plus démunis les chefs d’œuvre du répertoire classique. Cervantés, Lope de Vega, Caderon de la Barca et tant d’auteurs inconnus… Non, cette vie-là n’était pas un songe, l’Espagne était alors un pays libre.
Le ravin de Viznar, Federico le connaît pour y être allé quand il était enfant. Oui, c’est bien là, dans cette direction, que se situe Fuente Grande, celle que les Maures appelaient autrefois Ainadamar, la « Source des Larmes ».
- Dieu sait de quelles larmes il s’agit aujourd’hui, se dit Federico en entendant les premières déflagrations. C’est donc ici que nous allons mourir.
Un instant, l’idée le traverse qu’il pourrait fuir à travers les coteaux ou s’envoler comme un oiseau. Lui qui n’a jamais aimé les adieux. Lui qui filait parfois à l’anglaise pour adoucir l’angoisse des séparations.
- N’ai-je pas dit à mes amis que j’avais « la terreur de la mort » ? Que j’étais épouvanté à l’idée de « sentir que je m’en vais, que je vais me dire adieu à moi-même… »
Tandis qu’on l’emmène au bord du ravin, Federico songe au visage qu’il a refusé de voir ce jour d’août 1934, quand le sang d’Ignacio a coulé dans les arènes de Manzanares. Ignacio Sanchez Mejias, son ami, son frère, l’un des plus beaux matadors que l’Espagne ait porté. Un homme sublime qui courtisait la mort en faisant ondoyer sa cape rouge. Ignacio qui mena son dernier combat à cinq heures du soir, dans une bourgade de la Manche, sous les yeux d’un public tétanisé. Ignacio dont les blessures brillaient comme des soleils, et que Federico n’a pu regarder en face.
Ce n’est pas le peloton chargé de l’exécuter que Federico Garcia Lorca voit devant lui, en ce petit jour d’août 1936. Non, ce qu’il voit, tandis que ses bourreaux préparent leurs armes, c’est le poitrail du taureau qui défie le matador, la corne qui pénètre dans l’abdomen de l’homme qui va, la tête haute, à la rencontre de son destin. Pauvre Ignacio qui fit tout pour échapper à la mort que chacun de ses gestes provoquait…
Les Franquistes ont maintenant le doigt posé sur la gâchette. Le soleil darde ses premiers rayons sur la chevelure noire de Federico, mais personne n’ose regarder en face l’homme qui va mourir. Dans un souffle, le poète croit encore entendre la voix de son ami. Oui, c’est elle, c’est bien elle qui bruisse à ses oreilles, comme une triste brise parmi les oliviers :
- Federico, Federico, le savais-tu ? Écoute-moi, le taureau se nommait Granadino.
Federico Garcia Lorca, Non au franquisme, © Éditions Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », 2010. Réédition 2014.