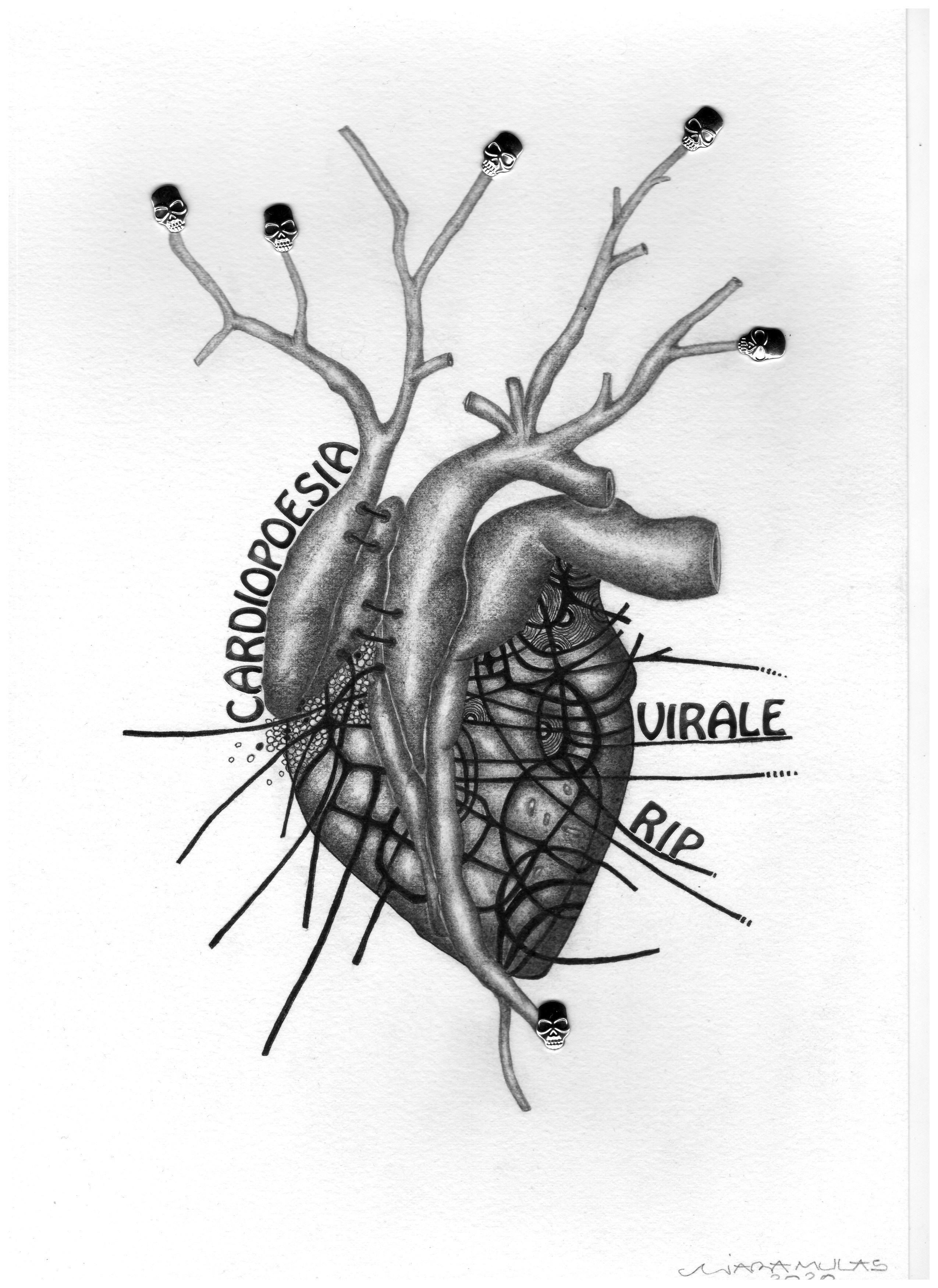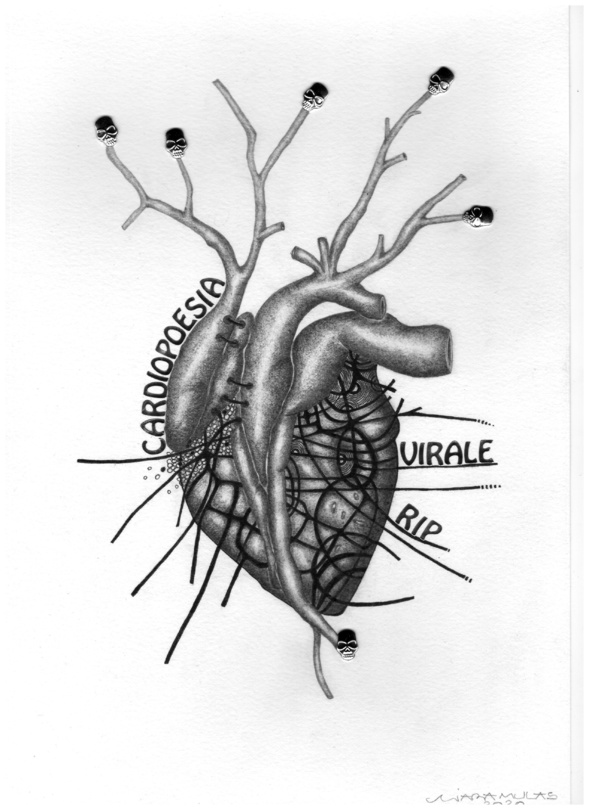CHIARA MULAS
BRONWYN LOUW
Parterre
Par terre le printemps vient se mélanger à l’hiver
au ras du sol des fleurs aux cœurs jaunes
comme des œufs. Et chaque brin d’herbe
chaque détail de mousse – même les feuilles
brunes les tiges jaunies – recouverts d’une
gravure fuyante de givre, marqués ou
peut-être même morts de la persistance
d’un froid qui n’est jamais vraiment venu
mais qui ne part pas non plus.
Poussent dans l’incertitude entre saisons incertaines
quantité de plantes d’un sol richement recouvert.
Cette richesse rompt avec mes habitudes.
Là où je vis le jardin était du béton il y a peu.
Chaque fois que le vert y pousse, qu’y vient
une taupe, ou des vers de terre, on s’exclame
comme du premier pas d’un enfant,
ou d’un convalescent de très longue date.
On pousse des cris heureux quand on voit revenir
même en procession précaire, lentes, les vies du sol.
Ici au verger mi-friche, cette vie n’est pas partie,
ou elle est revenue pour rester il y a assez longtemps
pour exister en splendeur de nombre, d’épaisseur,
aisance de richesse variante qui fait oublier
l’attente dans le presque rien, le maigre espoir
qui vit d’évanouissement en soubresaut, la vie
après la coupure des eaux communicantes.
De toute évidence il y a des choses dont il est
très difficile de revenir. Je n’ai pas l’impression
d’être trop mélancolique en l’écrivant.
Je suis d’un monde aux prises avec une difficulté
de retour, après avoir engendré de l’insoutenable.
Je me dis qu’un début de retour par détour
est de se pencher sur les dessins du sol.
J’entends Nina Simone chanter-crier Mississippi Goddamn,
jetant sa tête en arrière, ses mains sans relâche
engendrent leur rythme menaçant au piano
I’m going home now, going home now,
going hooome now.
Bronwyn Louw
Inédit à paraître in Pensée de verger
Par terre le printemps vient se mélanger à l’hiver
au ras du sol des fleurs aux cœurs jaunes
comme des œufs. Et chaque brin d’herbe
chaque détail de mousse – même les feuilles
brunes les tiges jaunies – recouverts d’une
gravure fuyante de givre, marqués ou
peut-être même morts de la persistance
d’un froid qui n’est jamais vraiment venu
mais qui ne part pas non plus.
Poussent dans l’incertitude entre saisons incertaines
quantité de plantes d’un sol richement recouvert.
Cette richesse rompt avec mes habitudes.
Là où je vis le jardin était du béton il y a peu.
Chaque fois que le vert y pousse, qu’y vient
une taupe, ou des vers de terre, on s’exclame
comme du premier pas d’un enfant,
ou d’un convalescent de très longue date.
On pousse des cris heureux quand on voit revenir
même en procession précaire, lentes, les vies du sol.
Ici au verger mi-friche, cette vie n’est pas partie,
ou elle est revenue pour rester il y a assez longtemps
pour exister en splendeur de nombre, d’épaisseur,
aisance de richesse variante qui fait oublier
l’attente dans le presque rien, le maigre espoir
qui vit d’évanouissement en soubresaut, la vie
après la coupure des eaux communicantes.
De toute évidence il y a des choses dont il est
très difficile de revenir. Je n’ai pas l’impression
d’être trop mélancolique en l’écrivant.
Je suis d’un monde aux prises avec une difficulté
de retour, après avoir engendré de l’insoutenable.
Je me dis qu’un début de retour par détour
est de se pencher sur les dessins du sol.
J’entends Nina Simone chanter-crier Mississippi Goddamn,
jetant sa tête en arrière, ses mains sans relâche
engendrent leur rythme menaçant au piano
I’m going home now, going home now,
going hooome now.
Bronwyn Louw
Inédit à paraître in Pensée de verger
PABLO NERUDA
Je ne suis pas seul dans la nuit
Je suis peuple, innombrable,
J ai dans ma voix la force pure
Qu'il faut pour franchir le silence
Et germer parmi les ténèbres.
Pablo Neruda
Envoi Michel Azama
Je suis peuple, innombrable,
J ai dans ma voix la force pure
Qu'il faut pour franchir le silence
Et germer parmi les ténèbres.
Pablo Neruda
Envoi Michel Azama
CHANTAL DUPUY-DUNIER
Certains hêtres
portent des feuilles écarlates.
Dans leurs nervures,
la même sève que celle
qui irrigue nos veines
et celles des agates.
Leur armure argentée les rend semblables
à de grands poissons verticaux.
La forêt nous habite
en même temps que nous l’habitons.
Transfusion d’air,
l’arbre poumon insuffle son haleine dans ma bouche.
Ma langue devient feuille vibratile.
Chantal Dupuy-Dunier
(Inédit)
portent des feuilles écarlates.
Dans leurs nervures,
la même sève que celle
qui irrigue nos veines
et celles des agates.
Leur armure argentée les rend semblables
à de grands poissons verticaux.
La forêt nous habite
en même temps que nous l’habitons.
Transfusion d’air,
l’arbre poumon insuffle son haleine dans ma bouche.
Ma langue devient feuille vibratile.
Chantal Dupuy-Dunier
(Inédit)
SERGE PEY
Écrire un poème sur la lumière
c’est inlassablement
trouver un synonyme
comme une image
qui se reflète dans un miroir brisé
Nos mains saignent
en ramassant les tessons
des images sur la route
Le silence est fracturé
en mille morceaux et pourtant
on n’entend rien
Le jour où nous avons appris
à faire des nœuds
avec les lacets de nos souliers
nous avons soudain grandi
comme le miroir dénoué
qui nous regarde
Le premier nœud
nous a appris aussi à nouer
le chemin sur lequel on marche
C’est lui qui nous a appris à nouer
La poésie
est un immense synonyme de la vie
qui regarde tous les synonymes de la mort
comme dans un miroir
L’univers est le double
d’un autre univers
que nous ne connaissons pas
comme une paire de chaussure
dont chaque pied
noue la chaussure de l’autre
Ce n’est que plus tard
quand nous n’avons plus de chemin
que nous apprenons
à dénouer nos chaussures
Dénouer une chaussure
est un art supérieur
à celui de les nouer
Nous devenons ainsi
en un instant libres
devant le synonyme unique
de l’univers
qui nous regarde
et à qui rien ne ressemble
Un poème n’est que le synonyme
d’un autre synonyme
dont nous avons sacrifié
les nœuds pour l’empêcher de saigner
Un poème est un garrot
un nœud sur une chaussure
qui ne connaît pas son chemin
L’univers
nous apprend à faire des nœuds
à nos souliers
car lui-même est un soulier
qui vole un de nos pieds
pour en faire un soulier
Tout chemin est fait de souliers
qui se prennent
aussi pour des miroirs
qui parfois défont un à un
tous nos synonymes
Un soulier
est toujours un pied nu
qui cherche infatigablement
son autre pied
Serge Pey
Extrait de Apprentissage des synonymes
***
l’infini
peut être divisé en deux
mais l’acte même de cette division
réalise deux parties
qui ne sont pas infinies
quand on coupe l’infini en deux
il commence par le point qui le divise
en deux morceaux
voici venir
les neiges rouges
voici le chant
des chemises égorgées
ainsi en commençant quelque part
l’infini cesse d’être infini
et crée deux droites
dont le bout est infini
mais dont le départ pour l’une
et l’arrivée pour l’autre sont finis
la division d’une droite
divise aussi le poème
car il s’agit de convaincre ceux
qui ne croient pas
même parmi nous
mais qui remontent les horloges
en fermant les yeux
pour fixer une par une les lettres
du nom de l’horloger
nos vieux morts
ne pèsent jamais l’espérance
car ils savent
qu’elle se retourne
comme une pauvre veste
à la doublure déchirée
les porte-manteaux
ne sont pas des balances
et les poches pèsent plus
que leurs vestes
de carton
pour cette raison
jamais nos morts ne meurent
quand nous décidons
que le rien n’est qu’un instant
et que la joie ne ressemble jamais
à un éclat de rire
Serge Pey
Site
c’est inlassablement
trouver un synonyme
comme une image
qui se reflète dans un miroir brisé
Nos mains saignent
en ramassant les tessons
des images sur la route
Le silence est fracturé
en mille morceaux et pourtant
on n’entend rien
Le jour où nous avons appris
à faire des nœuds
avec les lacets de nos souliers
nous avons soudain grandi
comme le miroir dénoué
qui nous regarde
Le premier nœud
nous a appris aussi à nouer
le chemin sur lequel on marche
C’est lui qui nous a appris à nouer
La poésie
est un immense synonyme de la vie
qui regarde tous les synonymes de la mort
comme dans un miroir
L’univers est le double
d’un autre univers
que nous ne connaissons pas
comme une paire de chaussure
dont chaque pied
noue la chaussure de l’autre
Ce n’est que plus tard
quand nous n’avons plus de chemin
que nous apprenons
à dénouer nos chaussures
Dénouer une chaussure
est un art supérieur
à celui de les nouer
Nous devenons ainsi
en un instant libres
devant le synonyme unique
de l’univers
qui nous regarde
et à qui rien ne ressemble
Un poème n’est que le synonyme
d’un autre synonyme
dont nous avons sacrifié
les nœuds pour l’empêcher de saigner
Un poème est un garrot
un nœud sur une chaussure
qui ne connaît pas son chemin
L’univers
nous apprend à faire des nœuds
à nos souliers
car lui-même est un soulier
qui vole un de nos pieds
pour en faire un soulier
Tout chemin est fait de souliers
qui se prennent
aussi pour des miroirs
qui parfois défont un à un
tous nos synonymes
Un soulier
est toujours un pied nu
qui cherche infatigablement
son autre pied
Serge Pey
Extrait de Apprentissage des synonymes
***
l’infini
peut être divisé en deux
mais l’acte même de cette division
réalise deux parties
qui ne sont pas infinies
quand on coupe l’infini en deux
il commence par le point qui le divise
en deux morceaux
voici venir
les neiges rouges
voici le chant
des chemises égorgées
ainsi en commençant quelque part
l’infini cesse d’être infini
et crée deux droites
dont le bout est infini
mais dont le départ pour l’une
et l’arrivée pour l’autre sont finis
la division d’une droite
divise aussi le poème
car il s’agit de convaincre ceux
qui ne croient pas
même parmi nous
mais qui remontent les horloges
en fermant les yeux
pour fixer une par une les lettres
du nom de l’horloger
nos vieux morts
ne pèsent jamais l’espérance
car ils savent
qu’elle se retourne
comme une pauvre veste
à la doublure déchirée
les porte-manteaux
ne sont pas des balances
et les poches pèsent plus
que leurs vestes
de carton
pour cette raison
jamais nos morts ne meurent
quand nous décidons
que le rien n’est qu’un instant
et que la joie ne ressemble jamais
à un éclat de rire
Serge Pey
Site
GÉRARD CARTIER
Les sens.
Charmer l’œil de couleurs vives délicieux
Bénir la bouche s’enivrer au jardin
Des vents épicés délicieux flatter
De chants l’oreille et au cœur de la nuit
La main la main légère et tout le corps
À la suivre insatiable humide
À l'intérieur de miel et dehors de sueur
Étreignant sans trouver de salut
Convulsivement la chair une sœur
Douce à la bouche à l’œil enivrante
Qui doucement se plaint souple et mobile
Dans chaque pli des épices puissantes
Dont la raison défaille s’épanchant dans la nuit
Et rien ne peut plus nous reprendre l’œil
Obscurci la main tremblante à louer
La forme glorieuse qui nous anéantit
Et tous les sens embarrassés pourtant
Rien qui d’eux ne vienne rien
Qui échappe à ces tyrans d’où naissent
Tous les arts et les chants
***
Voilà... la vie est passée...
Cerisiers dans la croisée et le chant capricieux
Des linottes je suis ce vieillard en costume estival
Chancelant sous son passé rêver sous un nom autre
On peut être heureux de rien et de rien pleurer
Une femme passe dans un miroir mais d’elle
Rien envolée avec le printemps on peut frémir
Enfermé dans sa momie sous la nuit des cintres
Et se regarder souffrir la lumière change
À la vitesse des sentiments et c’est l’hiver
La neige en confetti volette sur les planches
On est seul maison abandonnée les lourds volets
Battent au vent miroir piqué de cendres
Au mur un portrait penche sévère égérie
Les cheveux tirés où nichent les faucheux
Ses yeux seuls semblent vivre tout l’art
Cède devant ce morceau de ténèbres
C’est presque le silence qu’il dure
Poignant jusqu’à ce qu’on meure à son tour
Mais non les voilà tous à sortir du tombeau
Et renaît même au milieu des costumes celle
Qu’on croyait à jamais perdue
Gérard Cartier -
Extrait de Le voyage de Bougainville, L’Amourier, 2015
Charmer l’œil de couleurs vives délicieux
Bénir la bouche s’enivrer au jardin
Des vents épicés délicieux flatter
De chants l’oreille et au cœur de la nuit
La main la main légère et tout le corps
À la suivre insatiable humide
À l'intérieur de miel et dehors de sueur
Étreignant sans trouver de salut
Convulsivement la chair une sœur
Douce à la bouche à l’œil enivrante
Qui doucement se plaint souple et mobile
Dans chaque pli des épices puissantes
Dont la raison défaille s’épanchant dans la nuit
Et rien ne peut plus nous reprendre l’œil
Obscurci la main tremblante à louer
La forme glorieuse qui nous anéantit
Et tous les sens embarrassés pourtant
Rien qui d’eux ne vienne rien
Qui échappe à ces tyrans d’où naissent
Tous les arts et les chants
***
Voilà... la vie est passée...
Cerisiers dans la croisée et le chant capricieux
Des linottes je suis ce vieillard en costume estival
Chancelant sous son passé rêver sous un nom autre
On peut être heureux de rien et de rien pleurer
Une femme passe dans un miroir mais d’elle
Rien envolée avec le printemps on peut frémir
Enfermé dans sa momie sous la nuit des cintres
Et se regarder souffrir la lumière change
À la vitesse des sentiments et c’est l’hiver
La neige en confetti volette sur les planches
On est seul maison abandonnée les lourds volets
Battent au vent miroir piqué de cendres
Au mur un portrait penche sévère égérie
Les cheveux tirés où nichent les faucheux
Ses yeux seuls semblent vivre tout l’art
Cède devant ce morceau de ténèbres
C’est presque le silence qu’il dure
Poignant jusqu’à ce qu’on meure à son tour
Mais non les voilà tous à sortir du tombeau
Et renaît même au milieu des costumes celle
Qu’on croyait à jamais perdue
Gérard Cartier -
Extrait de Le voyage de Bougainville, L’Amourier, 2015
JEAN-MARIE GLEIZE
la flaque n’avait plus de bords
il glissait sur la pente il allait tomber
l’odeur du bois mouillé était de plus en plus forte
Jean-Marie Gleize
Inédit
il glissait sur la pente il allait tomber
l’odeur du bois mouillé était de plus en plus forte
Jean-Marie Gleize
Inédit
CHRISTOPHE LAMIOT
Qu’il fait un frais l’alentour
comme l’annonce d’un bien plus chaud
à venir
promis—plus que promis : de l’été
vient, s’avance
l’alentour, qu’il fait un frais
ralentir
inspirer profondément
écouter : un frais, l’alentour (parlent)—
***
LECTURE EN NORMANDIE ET AU SOLEIL DE LADY CHATTERLEY’S LOVER
Le pas à pas dans les livres
que les mots
tracent
plus jaunes que blanches, feuilles
portez mots
jours ;
pas à pas, partir, à suivre
que les mots
routes
pour passages que ces feuilles
mot par mot
fassent
partir, par pas à pas, vivre
que les mots
feuilles
été, ombrage les feuilles
matins, mots
marches
le pas à pas, trace à trace
dans les mots
livres.
Christophe LAMIOT
Extrait de Sun Bright, Bright (83-84), à paraître.
comme l’annonce d’un bien plus chaud
à venir
promis—plus que promis : de l’été
vient, s’avance
l’alentour, qu’il fait un frais
ralentir
inspirer profondément
écouter : un frais, l’alentour (parlent)—
***
LECTURE EN NORMANDIE ET AU SOLEIL DE LADY CHATTERLEY’S LOVER
Le pas à pas dans les livres
que les mots
tracent
plus jaunes que blanches, feuilles
portez mots
jours ;
pas à pas, partir, à suivre
que les mots
routes
pour passages que ces feuilles
mot par mot
fassent
partir, par pas à pas, vivre
que les mots
feuilles
été, ombrage les feuilles
matins, mots
marches
le pas à pas, trace à trace
dans les mots
livres.
Christophe LAMIOT
Extrait de Sun Bright, Bright (83-84), à paraître.
ANNE TALVAZ
Lorsqu’on doit désormais posséder sa clé propre,
l’insérer dans la serrure et tourner en sachant que personne ne viendra vous recevoir ; qu’on doit lancer une appel et que de son oreille sourde elle entend à peine ;
l’odeur de toujours de la maison vous enveloppe et la lumière du soleil aussi la vieille tante aussi mais quand je la prends dans mes bras elle souffle souffle souffle
***
Le passé est plein d’oiseaux.
Les étourneaux sous la pluie que j’essayai de dessiner.
Les mésanges acrobatiques sur la mangeoire.
La grive musicienne trop jeune qui me suivait en confiance et à qui j’aurais volontiers donné un escargot ou deux. Les goélands beaux, méchants et puants au cri pleurard et poétique. La cigogne microscopique, en incroyable altitude, dont les ailes clignotaient à la lumière du matin.
Les guêpiers confidentiels tournoyant devant leur banc de sable.
La buse avec sa grosse culotte.
Le pic qui se balançait sur une branche de saule pleureur qui manifestement grouillait d’insectes. La crécerelle en saint-esprit dont on souhaitait
qu’elle attrape sa proie tant elle persistait.
Anne Talvaz,
inédit
l’insérer dans la serrure et tourner en sachant que personne ne viendra vous recevoir ; qu’on doit lancer une appel et que de son oreille sourde elle entend à peine ;
l’odeur de toujours de la maison vous enveloppe et la lumière du soleil aussi la vieille tante aussi mais quand je la prends dans mes bras elle souffle souffle souffle
***
Le passé est plein d’oiseaux.
Les étourneaux sous la pluie que j’essayai de dessiner.
Les mésanges acrobatiques sur la mangeoire.
La grive musicienne trop jeune qui me suivait en confiance et à qui j’aurais volontiers donné un escargot ou deux. Les goélands beaux, méchants et puants au cri pleurard et poétique. La cigogne microscopique, en incroyable altitude, dont les ailes clignotaient à la lumière du matin.
Les guêpiers confidentiels tournoyant devant leur banc de sable.
La buse avec sa grosse culotte.
Le pic qui se balançait sur une branche de saule pleureur qui manifestement grouillait d’insectes. La crécerelle en saint-esprit dont on souhaitait
qu’elle attrape sa proie tant elle persistait.
Anne Talvaz,
inédit
JEAN MARIE BARNAUD
On croit qu’on vieillira doucement
qu’on finira sa course
à bout de souffle
Un filet d’eau
qui se perd dans le sable
Mais non
La bête de l’âge
vient d’un bond sur la scène
Jean-Marie Barnaud
Fragments d'un corps incertain Cheyne éditeur, 2009, prix Apollinaire 2010
Envoi Marie Hélène Audier
qu’on finira sa course
à bout de souffle
Un filet d’eau
qui se perd dans le sable
Mais non
La bête de l’âge
vient d’un bond sur la scène
Jean-Marie Barnaud
Fragments d'un corps incertain Cheyne éditeur, 2009, prix Apollinaire 2010
Envoi Marie Hélène Audier
BERNARD POZIER
Après la dévastation
quand craquent crispées les glaces
au seuil du soleil soudain
en dessous du blanc fracas
l’eau revient roucouler dans nos yeux
La débâcle dérive les blocs bruts
l’ultime peau de la neige recule peu à peu
l’herbe novice gagne du terrain
le fleuve ancestral s’élargit à nouveau
la fureur apprivoise la paix
Ours au sortir de l’hibernation
anti-climax du cataclysme
questionner l’existence de la réalité
croire au songe quel qu’il soit
Après le déluge ou l’apocalypse
à connaître désormais mieux la mort
la vie se fait-elle pour autant
plus ou moins importante qu’avant
Avec l’aube au printemps
sur la portée du premier remous
le jour augural rejoue l’aurore de son initial balbutiement
Bernard Pozier,
Post-scriptum, Écrits des Forges, 2011
quand craquent crispées les glaces
au seuil du soleil soudain
en dessous du blanc fracas
l’eau revient roucouler dans nos yeux
La débâcle dérive les blocs bruts
l’ultime peau de la neige recule peu à peu
l’herbe novice gagne du terrain
le fleuve ancestral s’élargit à nouveau
la fureur apprivoise la paix
Ours au sortir de l’hibernation
anti-climax du cataclysme
questionner l’existence de la réalité
croire au songe quel qu’il soit
Après le déluge ou l’apocalypse
à connaître désormais mieux la mort
la vie se fait-elle pour autant
plus ou moins importante qu’avant
Avec l’aube au printemps
sur la portée du premier remous
le jour augural rejoue l’aurore de son initial balbutiement
Bernard Pozier,
Post-scriptum, Écrits des Forges, 2011
TITA REUT
La mort dans l’âme
fait un bruit de saison
Coups sans secousses
Le disque tourne
gratte sur un filament
plus rouillé que la distance
Drôle de timbre
Une passion cardiaque
Tout le matériau fait écho
L’hérésie moucharde son poison
Voici mon déficit
dit le corps
à ce qui ne pense plus
mais réitère
Ni rage ni froissement
Un chose censurante
et comme relâchée
semble une nature
sans l’être
Attendre est le mot d’ordre
Peu à peu
les fils de la toile se retissent
Au centre
nous sommes une lune
qui cherche sa rotation
***
Jardins ouvriers
orée de jardin
Espace d’inachèvement
qui semble une philosophie
Suivant les saisons
la jachère et le plein
Alternance de durées
contraintes dans un espace
***
Parcelles de quotidien
semblent contaminer
la terre de pauvreté
Les simples les rares
ont la couleur du précieux
Les petites faims sont humbles
Tita Reut
Inédits
fait un bruit de saison
Coups sans secousses
Le disque tourne
gratte sur un filament
plus rouillé que la distance
Drôle de timbre
Une passion cardiaque
Tout le matériau fait écho
L’hérésie moucharde son poison
Voici mon déficit
dit le corps
à ce qui ne pense plus
mais réitère
Ni rage ni froissement
Un chose censurante
et comme relâchée
semble une nature
sans l’être
Attendre est le mot d’ordre
Peu à peu
les fils de la toile se retissent
Au centre
nous sommes une lune
qui cherche sa rotation
***
Jardins ouvriers
orée de jardin
Espace d’inachèvement
qui semble une philosophie
Suivant les saisons
la jachère et le plein
Alternance de durées
contraintes dans un espace
***
Parcelles de quotidien
semblent contaminer
la terre de pauvreté
Les simples les rares
ont la couleur du précieux
Les petites faims sont humbles
Tita Reut
Inédits
RENÉ CHAR
Commune présence (extraits)
II
Tu es pressé d'écrire
Comme si tu étais en retard sur la vie
S'il en est ainsi fais cortège à tes sources
Hâte-toi
Hâte-toi de transmettre
Ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance
Effectivement tu es en retard sur la vie
La vie inexprimable
La seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t'unir
Celle qui t'est refusée chaque jour par les êtres et par les choses
Dont tu obtiens péniblement de-ci de-là quelques fragments
décharnés
Au bout de combats sans merci
Hors d'elle tout n'est qu'agonie soumise fin grossière
Si tu rencontres la mort durant ton labeur
Reçois-la comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride
En t'inclinant
Si tu veux rire
Offre ta soumission
Jamais tes armes
Tu as été créé pour des moments peu communs
Modifie-toi disparais sans regret
Au gré de la rigueur suave
Quartier suivant quartier la liquidation du monde se poursuit
Sans interruption
Sans égarement
Essaime la poussière
Nul ne décèlera votre union.
René Char
In Commune présence - Éditions Gallimard / Collection Poésie
***
Le nu perdu
Porteront rameaux ceux dont l’endurance sait user la nuit noueuse qui précède et suit l’éclair. Leur parole reçoit existence du fruit intermittent qui la propage en se dilacérant. Ils sont les fils incestueux de l’entaille et du signe, qui élevèrent aux margelles le cercle en fleurs de la jarre du ralliement. La rage des cents les maintient encore dévêtus. Contre eux vole un duvet de nuit noire.
René Char
Retour amont, 1971, Gallimard
Envoi Corinne Leenhardt
II
Tu es pressé d'écrire
Comme si tu étais en retard sur la vie
S'il en est ainsi fais cortège à tes sources
Hâte-toi
Hâte-toi de transmettre
Ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance
Effectivement tu es en retard sur la vie
La vie inexprimable
La seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t'unir
Celle qui t'est refusée chaque jour par les êtres et par les choses
Dont tu obtiens péniblement de-ci de-là quelques fragments
décharnés
Au bout de combats sans merci
Hors d'elle tout n'est qu'agonie soumise fin grossière
Si tu rencontres la mort durant ton labeur
Reçois-la comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride
En t'inclinant
Si tu veux rire
Offre ta soumission
Jamais tes armes
Tu as été créé pour des moments peu communs
Modifie-toi disparais sans regret
Au gré de la rigueur suave
Quartier suivant quartier la liquidation du monde se poursuit
Sans interruption
Sans égarement
Essaime la poussière
Nul ne décèlera votre union.
René Char
In Commune présence - Éditions Gallimard / Collection Poésie
***
Le nu perdu
Porteront rameaux ceux dont l’endurance sait user la nuit noueuse qui précède et suit l’éclair. Leur parole reçoit existence du fruit intermittent qui la propage en se dilacérant. Ils sont les fils incestueux de l’entaille et du signe, qui élevèrent aux margelles le cercle en fleurs de la jarre du ralliement. La rage des cents les maintient encore dévêtus. Contre eux vole un duvet de nuit noire.
René Char
Retour amont, 1971, Gallimard
Envoi Corinne Leenhardt
PATRICIA CASTEX
De
l'inconnu partout,
dans tous les noms que l'on se donne,
ou
que l'on prête
aux choses qui nous regardent.
On
fait naufrage dans la beauté du verbe,
à
lire le reflet du sens
comme une carte du monde.
(...)
S’il
convient maintenant d’ouvrir les yeux,
ce
sera comme on remonte du fond d’un lac,
brasses
lentes de la pensée,
vers
la surface enfin
où nous attend d’une seule vue
l’étrangeté
des commencements.
°°°
Sur
la table,
les choses simples restent pour la nuit.
Le
bol et le pot ont leur éternité,
une
bonté peut-être de repères,
pour les errants que nous sommes.
(...)
À peine avons-nous bâti pour demain, laissé quelques pierres se resserrer autour du feu. Nous allons dans la lumière poignante et le vent qui tourne. Qu'aurons-nous mis au monde d'autres que nous
Patricia Castex
In Chemin d’éveil éditions le Cheyne
envoi L’Antre lieu
(...)
S’il
convient maintenant d’ouvrir les yeux,
ce
sera comme on remonte du fond d’un lac,
brasses
lentes de la pensée,
vers
la surface enfin
où nous attend d’une seule vue
l’étrangeté
des commencements.
°°°
Sur
la table,
les choses simples restent pour la nuit.
Le
bol et le pot ont leur éternité,
une
bonté peut-être de repères,
pour les errants que nous sommes.
(...)
À peine avons-nous bâti pour demain, laissé quelques pierres se resserrer autour du feu. Nous allons dans la lumière poignante et le vent qui tourne. Qu'aurons-nous mis au monde d'autres que nous
Patricia Castex
In Chemin d’éveil éditions le Cheyne
envoi L’Antre lieu
HÉLÈNE DORION
Aurons-nous le temps d'aller très loin
de traverser les carrefours, les mers, les nuages
d'habiter ce monde qui va parmi nos pas
d'un infini secret à l'autre, pourrons-nous écouter
le remuement des corps à travers le sable;
aurons-nous le temps
de tout nous dire et d'arrêter d'être effrayés
par nos tendresses, nos chutes communes;
pourrons-nous tout écrire
d'un passage du vent sur nos visages
ces murmures de l'univers, ces éclats d'immensité;
aurons-nous le temps de trouver
un mètre carré de terre et d'y vivre
ce qui nous échappe;
je ne sais pas encore.
Hélène DORION,
extrait de Un Visage appuyé contre le monde, coéd. Le Noroît / Le Dé bleu, 1990
Envoi Jacques Fournier
de traverser les carrefours, les mers, les nuages
d'habiter ce monde qui va parmi nos pas
d'un infini secret à l'autre, pourrons-nous écouter
le remuement des corps à travers le sable;
aurons-nous le temps
de tout nous dire et d'arrêter d'être effrayés
par nos tendresses, nos chutes communes;
pourrons-nous tout écrire
d'un passage du vent sur nos visages
ces murmures de l'univers, ces éclats d'immensité;
aurons-nous le temps de trouver
un mètre carré de terre et d'y vivre
ce qui nous échappe;
je ne sais pas encore.
Hélène DORION,
extrait de Un Visage appuyé contre le monde, coéd. Le Noroît / Le Dé bleu, 1990
Envoi Jacques Fournier
RAINER MARIA RILKE
Note XVI
Que ce soit le chant d’une lampe ou la voix de la tempête, que ce soit le souffle du soir ou le gémissement de la mer, qui t’environne — toujours veille derrière toi une ample mélodie, tissée de mille voix, dans laquelle ton solo n’a sa place que de temps à autre. Savoir à quel moment c’est à toi d’attaquer, voilà le secret de ta solitude: tout comme l’art du vrai commerce c’est: de la hauteur des mots se laisser choir dans la mélodie une et commune.
Rainer Maria Rilke
Extrait de Notes sur la mélodie des choses
traduction Bernard Pautrat, édition Allia, 2008
envoi Françoise Ascal
Que ce soit le chant d’une lampe ou la voix de la tempête, que ce soit le souffle du soir ou le gémissement de la mer, qui t’environne — toujours veille derrière toi une ample mélodie, tissée de mille voix, dans laquelle ton solo n’a sa place que de temps à autre. Savoir à quel moment c’est à toi d’attaquer, voilà le secret de ta solitude: tout comme l’art du vrai commerce c’est: de la hauteur des mots se laisser choir dans la mélodie une et commune.
Rainer Maria Rilke
Extrait de Notes sur la mélodie des choses
traduction Bernard Pautrat, édition Allia, 2008
envoi Françoise Ascal
FRANÇOISE ASCAL
Ce que nos bouches murmurent
dans l’obscur
ce que nos yeux entrevoient
dans la lumière
dites-le nous
hiéroglyphes
issus du songe
traduisez
notre effroi
notre espoir
sur la pierre l’écorce le sable
faites croître
une fleur de sens
Françoise Ascal
Entre Chair et Terre
Editions Le Réalgar, 2017.
dans l’obscur
ce que nos yeux entrevoient
dans la lumière
dites-le nous
hiéroglyphes
issus du songe
traduisez
notre effroi
notre espoir
sur la pierre l’écorce le sable
faites croître
une fleur de sens
Françoise Ascal
Entre Chair et Terre
Editions Le Réalgar, 2017.
ANTOINE EMAZ
Poème-lettre
on est allé jusqu’à ne plus savoir comment plus loin un mur indéfiniment un jour on ira plus loin d’ici là le temps comme pauvre et la force prise dans l’attente tendue sans bouger on reste en face à la longue ça devrait déplacer le pays ou bien jusqu’à ne plus tenir n’être plus tenu un matin il y aura une mémoire d’eau une vaste pluie devant rien d’autre on viendra au jour avec seulement dedans le temps ou l’air on sera devenu assez léger pour passer
Antoine Emaz
In Caisse claire, Poèmes 1990-1997, Éditions Points, 2007
envoi l'Antre lieu
on est allé jusqu’à ne plus savoir comment plus loin un mur indéfiniment un jour on ira plus loin d’ici là le temps comme pauvre et la force prise dans l’attente tendue sans bouger on reste en face à la longue ça devrait déplacer le pays ou bien jusqu’à ne plus tenir n’être plus tenu un matin il y aura une mémoire d’eau une vaste pluie devant rien d’autre on viendra au jour avec seulement dedans le temps ou l’air on sera devenu assez léger pour passer
Antoine Emaz
In Caisse claire, Poèmes 1990-1997, Éditions Points, 2007
envoi l'Antre lieu
HÉLÈNE SANGUINETTI
CHANT DE VIEIL-AMOUR ENRUBANNÉ
(extrait)
6│
Ne pas mourir
ne, Veut, pas, mourir
mourir mais vif
ainsi courir se dérater
du couru Et transpire tombe
au pied d’un arbre marronnier
en fleurs de sa vie,
7│
STOP. Veux sortir
frémir couiner gogoter
dulciner passer les bras
plaquer le très grand frisé
hop la montagne
de l’autre côté
embarquer sur ton derrière
oiseau, à califourchon,
planter mes griffes, ah,
ne, pas, tomber,
Merci à Hospitalité légendaire
du conte, à
Hospitalité légendaire des
plumés chanteurs, à
Hospitalité légendaire de la
promenade au ciel,
allons !
8│
Dieux de toute la nature
faites que :
pupilles
rougissent
bleuissent
verdoient
à la fois
Hélène Sanguinetti
Domaine des englués suivi de Six réponses à Jean-Baptiste Para,
La Lettre volée, 2017
(extrait)
6│
Ne pas mourir
ne, Veut, pas, mourir
mourir mais vif
ainsi courir se dérater
du couru Et transpire tombe
au pied d’un arbre marronnier
en fleurs de sa vie,
7│
STOP. Veux sortir
frémir couiner gogoter
dulciner passer les bras
plaquer le très grand frisé
hop la montagne
de l’autre côté
embarquer sur ton derrière
oiseau, à califourchon,
planter mes griffes, ah,
ne, pas, tomber,
Merci à Hospitalité légendaire
du conte, à
Hospitalité légendaire des
plumés chanteurs, à
Hospitalité légendaire de la
promenade au ciel,
allons !
8│
Dieux de toute la nature
faites que :
pupilles
rougissent
bleuissent
verdoient
à la fois
Hélène Sanguinetti
Domaine des englués suivi de Six réponses à Jean-Baptiste Para,
La Lettre volée, 2017
PATRICK QUILLIER
WING KARDJO ENTRE GARUT ET JAPON
Je suis Wing Kardjo. Je meurs au Japon
Le 19 mars 2002, moi qui
Suis né le 23 avril mille neuf
Cent trente sept dans la bonne ville de
Garut, au cœur de la Province de
Java occidental (Indonésie).
Mais entre ces lieux et entre ces dates
Il s’est passé pour moi beaucoup de choses :
Amours, événements, péripéties,
Études, lectures, méditations,
Rencontres, controverses, discussions,
Et toutes les espèces d’aventures,
Les unes (la plupart), si minuscules,
Les autres (quelques-unes), formidables,
Et ainsi de suite comme dans la
Vie de tout un chacun.
Et même si,
Comme le dit Alberto Caeiro,
Entre ces lieux, entre ces dates, tous
Les jours furent à moi, je vous le jure :
Tous les jours furent aussi, autour de
Moi, à toutes celles et à tous ceux
Que j’aimais, et à travers eux, au monde
Entier. Mais vous savez tous ce que c’est.
Je vous redirai aujourd’hui le flux
D’images qui, dans les tout derniers jours,
M’envahissaient avant mon agonie.
Des doigts, des doigts si beaux, si décharnés,
Qu’on aurait dit des modèles de doigts
Platoniciens, si l’on avait envie
D’ajouter foi au beau récit de la
Caverne, donc en un mot comme en cent
Des doigts en soi, pareils à des racines
Que je voyais fouiller sans fin la terre,
Toujours plus loin, toujours plus loin, au cœur
Du noir… Parfois, ces doigts, je les voyais
Qui écrivaient des mots vraiment tranchants,
Bien plus tranchants qu’un couteau affuté
Quand il pénètre et déchire le corps.
C’était alors un long écoulement
De rêve au long des artères, des veines,
Jusqu’au moindre des vaisseaux capillaires.
Je le voyais, ce rêve récurrent,
Bondir comme une vague déferlante,
S’écraser sur ma rive imaginaire,
Repartir vers la haute mer de mes
Aspirations, puis se précipiter,
Horde d’écume et de fracas, amas
Mobile d’une masse menaçante,
Vers la grève, afin d’avaler la terre.
Parfois, j’aimais dans ces lames labiles
Leur colère dépourvue de pitié.
Je me disais que là était la force
Qui consentait un peu que nous vivions
Mais qui tôt ou tard nous engloutissait
Irrémédiable, lame sans retour.
Sans doute avez-vous deviné pourquoi
Ici je vous redis ces obsessions :
Elles ont traversé la nuit des temps,
De génération en génération,
Mais nous manquons parfois à la leçon
D’humilité mêlée de force qu’elles
N’ont eu de cesse de nous délivrer.
Voilà, dans ce flux et reflux je suis
Mort. Ce même flux et reflux où j’ai
Vécu. Et nous partageons vous et moi
Cet héroïsme de tous les instants.
Je ne veux surtout pas en rester là
Avec vous. Entre héros des moments
De tous les jours et de toutes les nuits,
Nous nous devons de partager ce qui
Nous a marqués au sceau du mémorable.
Par exemple mes heures à Paris
Où, dans un café place Saint-Michel,
Je venais m’asseoir n’ayant rien d’autre à
Faire que regarder autour de moi
Les gens bavarder avec ou sans hargne,
Les couples s’embrasser dans un sourire,
L’essaim des employés tourbillonner.
Je pensais alors à ces vers puissants
Que toute une pléthore de poètes
Futuristes, sans doute fécondés
Par le cher Walt Whitman, ont dédié
À la foule moderne dans les villes,
Cette si merveilleuse faune des
Bas-fonds de la vie dont parla un jour,
Cyclothymique, Álvaro de Campos.
Alors je me mettais à composer
Des vers méticuleusement écrits
Mais creux car ils étaient inattentifs
Aux misères humaines comme à celles
De tout le vivant dans le monde entier.
J’étais semblable à Pablo Neruda
Dans ses premiers recueils inféodés
Aux carcans de la subjectivité.
Ailleurs, un peu partout, se poursuivaient
Les guerres, nuit, matin et soir, sans trêve,
D’autres humains continuaient leur lutte
Pour améliorer leur condition,
Pour affirmer avec force et fierté
La singularité de leur culture
Menacée par la terrible avancée
D’une irrémédiable uniformité.
Comprenez-moi bien : je ne prêche pas
Pour défendre ici les identités
Meurtrières ni contre les valeurs
Proclamées par quelques déclarations
Universelles. Je dis simplement
Qu’à l’époque, à Paris, dans ce café
Place Saint-Michel, j’étais éloigné
Des combats communs de l’humanité
Tout en communiant avec mes semblables,
Sacrée contradiction pour un poète !
Mon univers se réduisait à ça :
Une cour sans soleil, sans douleur grande,
Sans rien qui puisse causer de l’envie,
Du soupçon, de la jalousie. Mon lot,
Je l’acceptais en tentant d’être sage,
Me comblant de mots, mon seul héritage,
Ne demandant rien, ne protestant pas,
Comme un enfant mais aussi comme un homme
Se souvenant d’avoir lu dans l’extase
Les maximes de paix, d’ataraxie,
Du subtil médecin Ricardo Reis.
Et puis peu à peu l’hiver harcelait,
Souffle venant du nord telle une pointe
De douleur, cet homme désemparé,
Tiraillé entre sa vie quotidienne
De poète quelque peu désœuvré
Et son amour fou de l’humanité.
L’hiver faisait monter du sol gelé
Un immense message de détresse,
Un appel général à l’amitié,
Alors, dans la conscience solitaire,
S’allumait tant bien que mal la chandelle
De la sollicitude universelle,
Et un je-ne-sais-quoi comme de l’âme
Se sentait submergé par le besoin
De questionner. Et je sentais fort bien
Que ce rien d’âme était en tout le monde,
Pas seulement en moi. En vous aussi
Par conséquent, qui m’écoutez, sincères.
Il faut que je vous dise sans ambages
Que j’ai parfois dessiné mon portrait
En poète maudit, et je vous dois
De vous expliquer pour quelle raison.
C’est qu’un maudit n’est pas ce que l’on croit.
Inutile de le guetter aux portes,
Aux fenêtres, dans la lumière de
La lampe. Il n’est là véritablement
Que lorsque les petits sont endormis,
Enfin perdus dans le rêve serein
Que leur offre l’amour qui les entoure.
C’est qu’il est parti errer au hasard,
Les yeux dans les étoiles, dans la lune,
Dans les nuages que le vent transforme.
Il toussote, il est sans repos, il pense
Aux mille liens qui l’attachent au monde,
Lui qui sait qu’ailleurs est la vraie vie.
Écoutez ses pensées et apprenez
Que son rêve idéal, depuis longtemps,
Récuse l’enfer doux des servitudes
Consenties, jour après jour, nuit après
Nuit. La nuit, parlons-en, justement !
Amère, une vision lui alourdit
Les paupières, parce que dans sa nuit,
Même s’il va aussi vers sa lumière,
Un rideau d’ombre plus que sombre voile
Les yeux, nombreux, qui regardent depuis
Demain. Certes, me direz-vous, voilà
Le lot commun que les temps nous assignent.
Certes, me direz-vous, il faut lutter,
C’est cela qui compte, pour l’existence,
L’existence dûment dotée du sens
Des responsabilités. Vous avez
Peut-être raison, mais pour lui, poète
Maudit, ce sens que l’on invoque pour
Mieux courber l’échine l’insupporte :
Il le trouve lourd, lesté des semelles
De plomb qu’ont toutes les copies conformes
Qui ne pensent qu’à saisir à deux mains
L’ensemble des obligations concrètes.
Lui, il aspire à la désinvolture
Du vent qui vient souffler là où il veut.
C’est ainsi que fidèle à l’horizon
Oblique que lui trace le soleil,
Il va-et-vient, vilipendant partout
L’insupportable pesanteur du monde
Tel qu’il lui apparaît. Et malgré tout
Il ramène aux petits quelque pitance,
Que l’assiette tendue ne soit pas vide.
Ce poète est semblable au vagabond
Des cités anonymes, ce pauvre homme
Si répandu et pourtant invisible,
Tremblant de désarroi dans l’existence
Précaire où tout ressemble trop au jour
Quand il décroît très vite sous le vent
Mauvais qui souffle fort en appelant
De ses âpres rafales la nuit noire.
Vous devinez sa déception, peut-être,
Celle d’un homme qui voit tout le monde
Se noyer dans des torrents de formules :
Gabegie, corruption, prostitution,
Dette publique, déficit public,
Chômage, inflation… Perplexité sans
Issue. Et en effet, il dit : « Loin de
Moi tout cela, que m’importe la vie
Qui n’est qu’un pari. Il faut en finir ! »
Alors, comme dans un conte, il évoque
Un nouvel ordre, un ordre solidaire.
Mais dans cet ordre aussi il ne possède
Encore et toujours que l’univers des
Mots, signes et symboles impuissants.
Ah, quelle rage immense le saisit,
À bien comprendre que, dans sa dérive,
Il ne fait rien de plus que tous ces autres
Qui suivent sans broncher apparemment
L’engrenage inflexible qui les broie.
Quelle rage, mais aussi quel amour
Renouvelé pour les déshérités,
Ces héros des moments de tous les jours
Et de toutes les nuits. Pendant ce temps,
Sans discontinuer depuis Platon,
À coups de ratiocinations variant
Selon les idées dominantes de
Chaque époque, l’on argumente pour
Chasser de la République Idéale
Le poète. Dangereux, le poète
Qui ensorcelle les cavernes de
Vertige, qui jette un charme insolent
À toutes les grottes secrètes de
L’esprit. Oh oui, dangereux, ce maudit
Qui s’occupe de la plante fragile
Aux incalculables vertus, qu’on nomme
L’âme. L’ordre des logiques binaires,
C’est du plomb que vient vite altérer
L’albe alchimie chimérique du chant.
Nous devons tous nous sentir les victimes
Sacrificielles de cette beauté
Irréelle et vaine, dont tout poète
Maudit a versé partout le poison
Chatoyant. Et cela, sans oublier
Qu’en même temps il faut nous acquitter
De tous nos devoirs humains. La nuit ronfle,
Les petits ont fermé les yeux, on parle
Dans un sommeil dont on entend sans cesse
Le ressac, écume, fracas, amas
Mobile d’un embrun bouleversant.
La fleur de beauté que nous cultivons
Dans le souffle du vent vient se mourir.
Nous rentrons. Nous venons toquer à la
Vitre comme un reflet échoué sur
Les récifs. Pitié, ah, pitié pour nous !
Dans le dense brouillard qui vous saisit,
Vous les vivants, à m’écouter ainsi,
Je voudrais bien vous adresser, bonheur
Léger, ce mot de Pessoa : « C’est l’heure ! »
Patrick Quillier
Inédit, fait partie d'un des quatre volumes prévus d'une Épopée des épopées, dont le premier volume Voix éclatées (de 14 à 18), Éditions Fédérop 2018 a obtenu le prix Kowalski 2018.
Je suis Wing Kardjo. Je meurs au Japon
Le 19 mars 2002, moi qui
Suis né le 23 avril mille neuf
Cent trente sept dans la bonne ville de
Garut, au cœur de la Province de
Java occidental (Indonésie).
Mais entre ces lieux et entre ces dates
Il s’est passé pour moi beaucoup de choses :
Amours, événements, péripéties,
Études, lectures, méditations,
Rencontres, controverses, discussions,
Et toutes les espèces d’aventures,
Les unes (la plupart), si minuscules,
Les autres (quelques-unes), formidables,
Et ainsi de suite comme dans la
Vie de tout un chacun.
Et même si,
Comme le dit Alberto Caeiro,
Entre ces lieux, entre ces dates, tous
Les jours furent à moi, je vous le jure :
Tous les jours furent aussi, autour de
Moi, à toutes celles et à tous ceux
Que j’aimais, et à travers eux, au monde
Entier. Mais vous savez tous ce que c’est.
Je vous redirai aujourd’hui le flux
D’images qui, dans les tout derniers jours,
M’envahissaient avant mon agonie.
Des doigts, des doigts si beaux, si décharnés,
Qu’on aurait dit des modèles de doigts
Platoniciens, si l’on avait envie
D’ajouter foi au beau récit de la
Caverne, donc en un mot comme en cent
Des doigts en soi, pareils à des racines
Que je voyais fouiller sans fin la terre,
Toujours plus loin, toujours plus loin, au cœur
Du noir… Parfois, ces doigts, je les voyais
Qui écrivaient des mots vraiment tranchants,
Bien plus tranchants qu’un couteau affuté
Quand il pénètre et déchire le corps.
C’était alors un long écoulement
De rêve au long des artères, des veines,
Jusqu’au moindre des vaisseaux capillaires.
Je le voyais, ce rêve récurrent,
Bondir comme une vague déferlante,
S’écraser sur ma rive imaginaire,
Repartir vers la haute mer de mes
Aspirations, puis se précipiter,
Horde d’écume et de fracas, amas
Mobile d’une masse menaçante,
Vers la grève, afin d’avaler la terre.
Parfois, j’aimais dans ces lames labiles
Leur colère dépourvue de pitié.
Je me disais que là était la force
Qui consentait un peu que nous vivions
Mais qui tôt ou tard nous engloutissait
Irrémédiable, lame sans retour.
Sans doute avez-vous deviné pourquoi
Ici je vous redis ces obsessions :
Elles ont traversé la nuit des temps,
De génération en génération,
Mais nous manquons parfois à la leçon
D’humilité mêlée de force qu’elles
N’ont eu de cesse de nous délivrer.
Voilà, dans ce flux et reflux je suis
Mort. Ce même flux et reflux où j’ai
Vécu. Et nous partageons vous et moi
Cet héroïsme de tous les instants.
Je ne veux surtout pas en rester là
Avec vous. Entre héros des moments
De tous les jours et de toutes les nuits,
Nous nous devons de partager ce qui
Nous a marqués au sceau du mémorable.
Par exemple mes heures à Paris
Où, dans un café place Saint-Michel,
Je venais m’asseoir n’ayant rien d’autre à
Faire que regarder autour de moi
Les gens bavarder avec ou sans hargne,
Les couples s’embrasser dans un sourire,
L’essaim des employés tourbillonner.
Je pensais alors à ces vers puissants
Que toute une pléthore de poètes
Futuristes, sans doute fécondés
Par le cher Walt Whitman, ont dédié
À la foule moderne dans les villes,
Cette si merveilleuse faune des
Bas-fonds de la vie dont parla un jour,
Cyclothymique, Álvaro de Campos.
Alors je me mettais à composer
Des vers méticuleusement écrits
Mais creux car ils étaient inattentifs
Aux misères humaines comme à celles
De tout le vivant dans le monde entier.
J’étais semblable à Pablo Neruda
Dans ses premiers recueils inféodés
Aux carcans de la subjectivité.
Ailleurs, un peu partout, se poursuivaient
Les guerres, nuit, matin et soir, sans trêve,
D’autres humains continuaient leur lutte
Pour améliorer leur condition,
Pour affirmer avec force et fierté
La singularité de leur culture
Menacée par la terrible avancée
D’une irrémédiable uniformité.
Comprenez-moi bien : je ne prêche pas
Pour défendre ici les identités
Meurtrières ni contre les valeurs
Proclamées par quelques déclarations
Universelles. Je dis simplement
Qu’à l’époque, à Paris, dans ce café
Place Saint-Michel, j’étais éloigné
Des combats communs de l’humanité
Tout en communiant avec mes semblables,
Sacrée contradiction pour un poète !
Mon univers se réduisait à ça :
Une cour sans soleil, sans douleur grande,
Sans rien qui puisse causer de l’envie,
Du soupçon, de la jalousie. Mon lot,
Je l’acceptais en tentant d’être sage,
Me comblant de mots, mon seul héritage,
Ne demandant rien, ne protestant pas,
Comme un enfant mais aussi comme un homme
Se souvenant d’avoir lu dans l’extase
Les maximes de paix, d’ataraxie,
Du subtil médecin Ricardo Reis.
Et puis peu à peu l’hiver harcelait,
Souffle venant du nord telle une pointe
De douleur, cet homme désemparé,
Tiraillé entre sa vie quotidienne
De poète quelque peu désœuvré
Et son amour fou de l’humanité.
L’hiver faisait monter du sol gelé
Un immense message de détresse,
Un appel général à l’amitié,
Alors, dans la conscience solitaire,
S’allumait tant bien que mal la chandelle
De la sollicitude universelle,
Et un je-ne-sais-quoi comme de l’âme
Se sentait submergé par le besoin
De questionner. Et je sentais fort bien
Que ce rien d’âme était en tout le monde,
Pas seulement en moi. En vous aussi
Par conséquent, qui m’écoutez, sincères.
Il faut que je vous dise sans ambages
Que j’ai parfois dessiné mon portrait
En poète maudit, et je vous dois
De vous expliquer pour quelle raison.
C’est qu’un maudit n’est pas ce que l’on croit.
Inutile de le guetter aux portes,
Aux fenêtres, dans la lumière de
La lampe. Il n’est là véritablement
Que lorsque les petits sont endormis,
Enfin perdus dans le rêve serein
Que leur offre l’amour qui les entoure.
C’est qu’il est parti errer au hasard,
Les yeux dans les étoiles, dans la lune,
Dans les nuages que le vent transforme.
Il toussote, il est sans repos, il pense
Aux mille liens qui l’attachent au monde,
Lui qui sait qu’ailleurs est la vraie vie.
Écoutez ses pensées et apprenez
Que son rêve idéal, depuis longtemps,
Récuse l’enfer doux des servitudes
Consenties, jour après jour, nuit après
Nuit. La nuit, parlons-en, justement !
Amère, une vision lui alourdit
Les paupières, parce que dans sa nuit,
Même s’il va aussi vers sa lumière,
Un rideau d’ombre plus que sombre voile
Les yeux, nombreux, qui regardent depuis
Demain. Certes, me direz-vous, voilà
Le lot commun que les temps nous assignent.
Certes, me direz-vous, il faut lutter,
C’est cela qui compte, pour l’existence,
L’existence dûment dotée du sens
Des responsabilités. Vous avez
Peut-être raison, mais pour lui, poète
Maudit, ce sens que l’on invoque pour
Mieux courber l’échine l’insupporte :
Il le trouve lourd, lesté des semelles
De plomb qu’ont toutes les copies conformes
Qui ne pensent qu’à saisir à deux mains
L’ensemble des obligations concrètes.
Lui, il aspire à la désinvolture
Du vent qui vient souffler là où il veut.
C’est ainsi que fidèle à l’horizon
Oblique que lui trace le soleil,
Il va-et-vient, vilipendant partout
L’insupportable pesanteur du monde
Tel qu’il lui apparaît. Et malgré tout
Il ramène aux petits quelque pitance,
Que l’assiette tendue ne soit pas vide.
Ce poète est semblable au vagabond
Des cités anonymes, ce pauvre homme
Si répandu et pourtant invisible,
Tremblant de désarroi dans l’existence
Précaire où tout ressemble trop au jour
Quand il décroît très vite sous le vent
Mauvais qui souffle fort en appelant
De ses âpres rafales la nuit noire.
Vous devinez sa déception, peut-être,
Celle d’un homme qui voit tout le monde
Se noyer dans des torrents de formules :
Gabegie, corruption, prostitution,
Dette publique, déficit public,
Chômage, inflation… Perplexité sans
Issue. Et en effet, il dit : « Loin de
Moi tout cela, que m’importe la vie
Qui n’est qu’un pari. Il faut en finir ! »
Alors, comme dans un conte, il évoque
Un nouvel ordre, un ordre solidaire.
Mais dans cet ordre aussi il ne possède
Encore et toujours que l’univers des
Mots, signes et symboles impuissants.
Ah, quelle rage immense le saisit,
À bien comprendre que, dans sa dérive,
Il ne fait rien de plus que tous ces autres
Qui suivent sans broncher apparemment
L’engrenage inflexible qui les broie.
Quelle rage, mais aussi quel amour
Renouvelé pour les déshérités,
Ces héros des moments de tous les jours
Et de toutes les nuits. Pendant ce temps,
Sans discontinuer depuis Platon,
À coups de ratiocinations variant
Selon les idées dominantes de
Chaque époque, l’on argumente pour
Chasser de la République Idéale
Le poète. Dangereux, le poète
Qui ensorcelle les cavernes de
Vertige, qui jette un charme insolent
À toutes les grottes secrètes de
L’esprit. Oh oui, dangereux, ce maudit
Qui s’occupe de la plante fragile
Aux incalculables vertus, qu’on nomme
L’âme. L’ordre des logiques binaires,
C’est du plomb que vient vite altérer
L’albe alchimie chimérique du chant.
Nous devons tous nous sentir les victimes
Sacrificielles de cette beauté
Irréelle et vaine, dont tout poète
Maudit a versé partout le poison
Chatoyant. Et cela, sans oublier
Qu’en même temps il faut nous acquitter
De tous nos devoirs humains. La nuit ronfle,
Les petits ont fermé les yeux, on parle
Dans un sommeil dont on entend sans cesse
Le ressac, écume, fracas, amas
Mobile d’un embrun bouleversant.
La fleur de beauté que nous cultivons
Dans le souffle du vent vient se mourir.
Nous rentrons. Nous venons toquer à la
Vitre comme un reflet échoué sur
Les récifs. Pitié, ah, pitié pour nous !
Dans le dense brouillard qui vous saisit,
Vous les vivants, à m’écouter ainsi,
Je voudrais bien vous adresser, bonheur
Léger, ce mot de Pessoa : « C’est l’heure ! »
Patrick Quillier
Inédit, fait partie d'un des quatre volumes prévus d'une Épopée des épopées, dont le premier volume Voix éclatées (de 14 à 18), Éditions Fédérop 2018 a obtenu le prix Kowalski 2018.
SUITE DE LA FORÊT DES SIGNES P3
LA FORÊT DES SIGNES SUITE PAGE 3
CLIQUER ICI
CLIQUER ICI