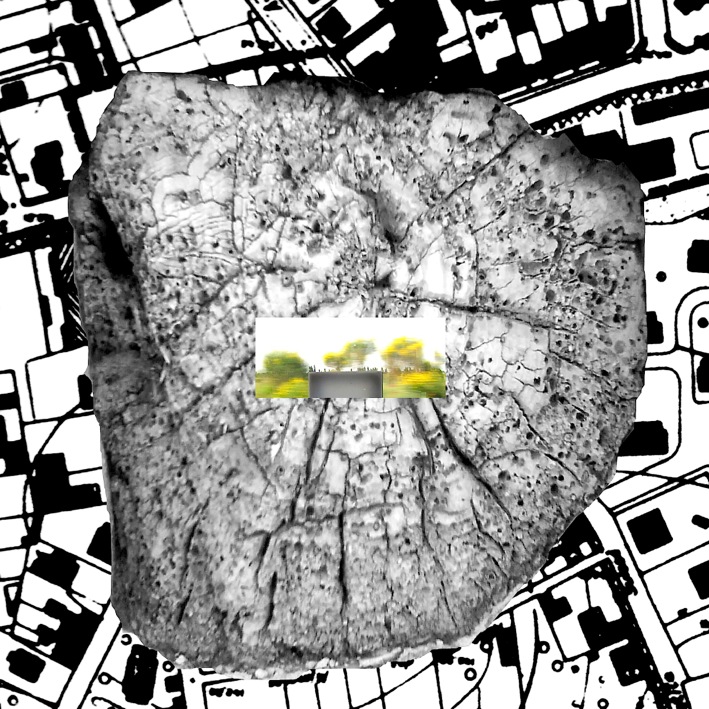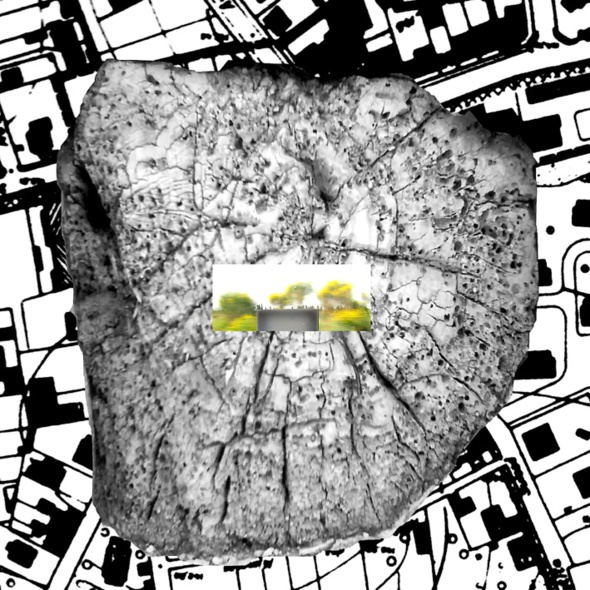GINEY AYME
JACQUES ANCET
Ça ne bouge même pas.
C’est comme sur le ciel la trace
d’un vol mais sans les oiseaux
ou comme le bruit de l’eau
mais sans eau. Ça n’est pas là.
C’est, en toi, ce qui n’est ni
ton corps ni, dans ton regard,
l’éclat qui porte ton nom.
c’est sans mot, mais ça insiste
comme sous la peau, le sang.
Même si on ne sait pas. Avec des gestes pour rien. Même si on dort, si c’est dans la lenteur de l’amour, avant le sommeil. On dit tu as entendu, écoute. Les mains s’arrêtent, les mots. On voit l’ombre d’une tasse et son anse sur le mur. C’est le bord. On ne voit pas.
C’est peut-être la lenteur, un feu qui brûle sans flammes. Malgré moteurs, hurlements, le vent arrêté, les feuilles immobiles avec les ombres. C’est peut-être un germe d’air, l’imperceptible, son aile absente sous les images. On attend. Les mots se taisent. C’est là. Ça ne viendra pas.
Même si tu sais que rien ne sera dit, même si se répète chaque jour avec ses mouches, ses fleurs, dans sa profusion d’images, tu t’arrêtes. Entre deux ombres, la même ombre. Il y a comme quelqu’un qui parle. C’est là. Mais sans mots,sans bouche presque: un bruit d’eau — ou autre chose.
Toujours. On voudrait savoir. Cet intervalle, toujours. Comme entre ton corps, le mien le fil qui n’existe pas. Mais il est là, on est sûr, pareil aux mouches qui grincent et qu’on ne voit pas, pareil à ce qui souffle. Tu te dis: ce n’est même pas de l’air, c’est autre chose, mais quoi.
Jacques Ancet
In L’imperceptible, Éditions Lettres Vives
envoi Antre Lieu
Même si on ne sait pas. Avec des gestes pour rien. Même si on dort, si c’est dans la lenteur de l’amour, avant le sommeil. On dit tu as entendu, écoute. Les mains s’arrêtent, les mots. On voit l’ombre d’une tasse et son anse sur le mur. C’est le bord. On ne voit pas.
C’est peut-être la lenteur, un feu qui brûle sans flammes. Malgré moteurs, hurlements, le vent arrêté, les feuilles immobiles avec les ombres. C’est peut-être un germe d’air, l’imperceptible, son aile absente sous les images. On attend. Les mots se taisent. C’est là. Ça ne viendra pas.
Même si tu sais que rien ne sera dit, même si se répète chaque jour avec ses mouches, ses fleurs, dans sa profusion d’images, tu t’arrêtes. Entre deux ombres, la même ombre. Il y a comme quelqu’un qui parle. C’est là. Mais sans mots,sans bouche presque: un bruit d’eau — ou autre chose.
Toujours. On voudrait savoir. Cet intervalle, toujours. Comme entre ton corps, le mien le fil qui n’existe pas. Mais il est là, on est sûr, pareil aux mouches qui grincent et qu’on ne voit pas, pareil à ce qui souffle. Tu te dis: ce n’est même pas de l’air, c’est autre chose, mais quoi.
Jacques Ancet
In L’imperceptible, Éditions Lettres Vives
envoi Antre Lieu
YVES PEYRÉ
Près du songe, la pierre du toit,
la poussée,
le cri, la vocifération et les feuilles
qui palpitent,
milliers de soupirs jetés en pâture
au ciel,
peu à peu je deviens, je monte,
je m’agrippe.
Un bras et un coude, ma branche ne casse pas, cristal de l’incertitude, elle se plaît à l’angle, depuis la terre, elle élance son dessin, une sève exubérante, l’eau lourde qui m’irrigue, je tourne et reviens, je suis droit, je ponctue la distance.
Frêle bâtonnet dit arbre, dit homme, voisin de la caillasse, je bois en terre, je suis feuillage, je me rêve déjà ombrelle, grande courbure, parasol, je marche sur la vague immobile de l’être, un grand silence, une parure, un excès de mots ou de feuilles.
Je redescends, qui s’exalte, c’est un vent, une caresse, je vais contre, j’enlace, je désespère, têtu, fier de l’écorce qui craque, du sourire qui pointe, je ne vois pas plus loin que ma branche, craignant le feu qui cajole ou la saison qui dépeuple.
Un parfum ou la criée du songe, je frissonne encore, je vais loin dans ma marche imperceptible, me perdant vers le haut, m’inventant à mesure un ciel, j’abandonne les tentations vaines, je tisonne mon ardeur, une frénésie de verdure et la souplesse des branches sveltes qui se couchent non sans tendresse.
Un dernier bien, seul arbre parmi mille, l’immense d’une course, la mêlée, la bataille, la foule, mes racines sont silencieuses, elles me remémorent mes luttes, mes élans et le désir du partage : feuilles, sève, chorégraphie du mouvement, je tangue sur la terre, au ras du ciel, je m’époumone en frondaison et en eau, mon rêve se perd dans le sol, il remonte haut, il s’embrase avec le vent.
Je vais, je ne me retiens pas, je nais de terre, le ciel est à portée, je mêle le noir et le bleu, j’avoue la jonchée et le murmure, je persiste et sans cesse deviens.
Yves Peyré
In Destinée végétale, Éditions Céphéides, 1997
Envoi l'Antre Lieu
Un bras et un coude, ma branche ne casse pas, cristal de l’incertitude, elle se plaît à l’angle, depuis la terre, elle élance son dessin, une sève exubérante, l’eau lourde qui m’irrigue, je tourne et reviens, je suis droit, je ponctue la distance.
Frêle bâtonnet dit arbre, dit homme, voisin de la caillasse, je bois en terre, je suis feuillage, je me rêve déjà ombrelle, grande courbure, parasol, je marche sur la vague immobile de l’être, un grand silence, une parure, un excès de mots ou de feuilles.
Je redescends, qui s’exalte, c’est un vent, une caresse, je vais contre, j’enlace, je désespère, têtu, fier de l’écorce qui craque, du sourire qui pointe, je ne vois pas plus loin que ma branche, craignant le feu qui cajole ou la saison qui dépeuple.
Un parfum ou la criée du songe, je frissonne encore, je vais loin dans ma marche imperceptible, me perdant vers le haut, m’inventant à mesure un ciel, j’abandonne les tentations vaines, je tisonne mon ardeur, une frénésie de verdure et la souplesse des branches sveltes qui se couchent non sans tendresse.
Un dernier bien, seul arbre parmi mille, l’immense d’une course, la mêlée, la bataille, la foule, mes racines sont silencieuses, elles me remémorent mes luttes, mes élans et le désir du partage : feuilles, sève, chorégraphie du mouvement, je tangue sur la terre, au ras du ciel, je m’époumone en frondaison et en eau, mon rêve se perd dans le sol, il remonte haut, il s’embrase avec le vent.
Je vais, je ne me retiens pas, je nais de terre, le ciel est à portée, je mêle le noir et le bleu, j’avoue la jonchée et le murmure, je persiste et sans cesse deviens.
Yves Peyré
In Destinée végétale, Éditions Céphéides, 1997
Envoi l'Antre Lieu
CHAWKI ABDELAMIR
Parole du rêve
Alors que là-haut
Me revenait le rêve
J’étais seul
Oiseau à l’orée de la nuit.
Sans me faire verbe
Il a légué à l’encre ses éléments
Et à mon sang
Un peu de ses forêts et de ses mystères.
J’ai appris comment le vent
Peut devenir un heaume pour ses voyages,
J’ai appris comment laisser dans son viatique
Mon nuage
Les talismans de mon siècle
Et un ciel qui troquait
Les maximes contre les jours.
De ce rêve je ne connais que ces mains
Qui étreignent des arbres
Gorgés d’absence, de peine
Et d’une pluie pourpre
Qui purifie mon chant.
Une nuit s’interpose
Entre cette aube jaillie comme un goéland éclairé
Par l’incendie et moi,
Elle me pare d’une heure incertaine.
La nudité grosse d’effroi est son domaine
Elle me somme de dissimuler
L’exsangue corps du temps alerte.
Entre le mur et moi
Du rêve je déploie le visage
Comme un écran de lointaines contrées.
Quand toutes les orbites se confondent
J’ai encore ta voix qui invente la caravane.
Je vois
Je me vois
Je vois le rêve
Je vois un matin qui regagne son village,
Je vois dans mon âme une forêt d’oiseaux captifs.
J’effleure les confins
Et je les peuple de frontières
La ville se dépouille de ses arbres
Elle émigre à travers les champs gris.
Quelle fontaine fera de moi
Une parure de poussière?
Quel miroir en le brisant me sera une porte
Dans la solitude de la nuit?
Qui, bec et griffes,
Se désaltérera de ma plaie ouverte
Au poignard de l’azur?
Le rêve m’a dit:
- Je tire orgueil
De m’abreuver au bout des cimes.
Le vent est l’enfance d’un chant
Qui ne saurait vieillir.
- Je n’avais soif que de mon eau.
Ma bannière était patrie et exils.
Je la plante dans les terres de l’errance
Et lui fais don de ma nudité
Mais je lui ai choisi la berge
Où traverser mes âges.
Braise je lui ai appris à n’être que braise.
Pour un chant sur ta plaie
Comme cendre incandescente
Pour cette voix recouvrant ta voix diffuse
Pour une banderole qui ne fut que mon feu
Pour un silence qui est visage
Venu hisser les années
Sur la selle de mon attente
Je recueillerai les villages-forêts de l’hier
Ou je me dissoudrai en arbres entre des mains.
Arbres à venir
Sang luxuriant
Entre deux pouces.
Chawki Abdelamir
In Parole du Qarmate, Traduit de l’arabe par Eugène Guillevic et Mohamed Kacimik Éditions Arfuyen
Alors que là-haut
Me revenait le rêve
J’étais seul
Oiseau à l’orée de la nuit.
Sans me faire verbe
Il a légué à l’encre ses éléments
Et à mon sang
Un peu de ses forêts et de ses mystères.
J’ai appris comment le vent
Peut devenir un heaume pour ses voyages,
J’ai appris comment laisser dans son viatique
Mon nuage
Les talismans de mon siècle
Et un ciel qui troquait
Les maximes contre les jours.
De ce rêve je ne connais que ces mains
Qui étreignent des arbres
Gorgés d’absence, de peine
Et d’une pluie pourpre
Qui purifie mon chant.
Une nuit s’interpose
Entre cette aube jaillie comme un goéland éclairé
Par l’incendie et moi,
Elle me pare d’une heure incertaine.
La nudité grosse d’effroi est son domaine
Elle me somme de dissimuler
L’exsangue corps du temps alerte.
Entre le mur et moi
Du rêve je déploie le visage
Comme un écran de lointaines contrées.
Quand toutes les orbites se confondent
J’ai encore ta voix qui invente la caravane.
Je vois
Je me vois
Je vois le rêve
Je vois un matin qui regagne son village,
Je vois dans mon âme une forêt d’oiseaux captifs.
J’effleure les confins
Et je les peuple de frontières
La ville se dépouille de ses arbres
Elle émigre à travers les champs gris.
Quelle fontaine fera de moi
Une parure de poussière?
Quel miroir en le brisant me sera une porte
Dans la solitude de la nuit?
Qui, bec et griffes,
Se désaltérera de ma plaie ouverte
Au poignard de l’azur?
Le rêve m’a dit:
- Je tire orgueil
De m’abreuver au bout des cimes.
Le vent est l’enfance d’un chant
Qui ne saurait vieillir.
- Je n’avais soif que de mon eau.
Ma bannière était patrie et exils.
Je la plante dans les terres de l’errance
Et lui fais don de ma nudité
Mais je lui ai choisi la berge
Où traverser mes âges.
Braise je lui ai appris à n’être que braise.
Pour un chant sur ta plaie
Comme cendre incandescente
Pour cette voix recouvrant ta voix diffuse
Pour une banderole qui ne fut que mon feu
Pour un silence qui est visage
Venu hisser les années
Sur la selle de mon attente
Je recueillerai les villages-forêts de l’hier
Ou je me dissoudrai en arbres entre des mains.
Arbres à venir
Sang luxuriant
Entre deux pouces.
Chawki Abdelamir
In Parole du Qarmate, Traduit de l’arabe par Eugène Guillevic et Mohamed Kacimik Éditions Arfuyen
SABINE HUYNH
Écoute le vent
Écoute le vent, sache combien la nuit dans laquelle je m’étais glissée était lumineuse, combien elle était robe duveteuse, étoilée. Elle était chambre, emplie de ton odeur, lit, peuplé de chance et de bonheur. Cet état d’yeux fermés, qu’embrassait un souffle lourd. Au bout d’une ficelle autour de mon cou se balançaient des rêves à moitié mûrs, planètes perdues aux anneaux gazeux se heurtant sans bruit.
Sache que nous dormions dos à dos, aussi attentifs aux bruits que des louves, et que j’ai été frappée par le fait que jusqu’alors tu n’avais jamais été à proximité.
Écoute le vent, sache que lorsque je me suis réveillée tu n’étais plus là. J’ai entendu le volet grincer. Un appel long et strident, le martin-pêcheur était revenu. Puis, des petits coups rapides au-dessus de ma tête. Le corbeau a craillé trois fois, le colibri a lancé huit trilles, avant que je n’ouvre les yeux, face à la pièce muette des jours solitaires, et je me suis demandée si les étoiles de mer y voyaient quelque chose.
J’ai lu qu’elles pouvaient vivre trente-cinq ans. Ainsi, je me suis demandée si cela prendrait toute une vie jusqu’à ce que je te revoie, et quand ce fossé engloutissant tout cessera de s’élargir.
Écoute le vent, sache que je suis complètement réveillée à présent et que les planètes se sont dissoutes. J’aimerais te dire pourquoi mais le ciel blême m’en empêche, alors je préfère laisser le son harmonieux du carillon en bambou nous relier. Je me souviens du carillon jaune jonquille en forme de poisson que tu m’avais donné un jour.
Comment il luttait, pour disperser la sagesse gravée sur sa queue, qu’aucun de nous n’arrivions à lire, malgré notre ardeur.
***
Ce mois-là
Ce mois-là, je lisais L’Enfer de Dante à l’aube et la nuit je veillais sur le sommeil de mon amour. En l’écoutant respirer, je sentais ses cuisses se contracter sous le poids de rêves frénétiques, mais ce qui secouait son corps bien plus que les scènes ressurgies le matin c’était la menace invisible, aussi écrasante que l’absence totale de sons, un silence irréel que nous ne subissions qu’après un attentat-suicide dans la ville. Par ailleurs, le m de bombe est aussi silencieux que les m de membre et de tombe, même si vous les aimez énormément.
Ce mois-là, ma fille a appris à faire éclore des œufs de supermarché en regardant des vidéos et la nuit elle rêvait intensément de poussins sautant à la corde sous des néons dans des allées parfois désertes, parfois pleines de poètes barbus et sans enfants, pendant que le monde était assommé par une crise cardiaque silencieuse causée par une créature heureuse d’exister pleinement parmi les humains, la plus ouverte de tous, et qui nous révélait que vivre en gardant le silence est un traumatisme supplémentaire enduré par la plupart des survivants.
Ce mois-là, il a plu chaque nuit et j’ai fait un gâteau chaque jour, car quel mal y avait-il à mâcher au lieu de parler, ou même à rire dans un espace fermé la bouche pleine de miettes du passé ? Ai-je dit qu’à l’aube j’attendais que le soleil me dise d’aller préparer le petit-déjeuner de mes anges endormis, moins les poussins pas encore nés ? Aujourd’hui les oiseaux se sont levés avant moi et quand je me suis approchée de la fenêtre pour chercher la lumière et que je n’y ai trouvé que le reflet de mon visage et mes cheveux hirsutes, l’un d’eux est venu taper à la vitre et j’ai sursauté à la vue d’une harpie à la bouche ouverte.
Ce mois-là le printemps avait du retard et nous avons vécu sans savoir ce qui se tramait sans nous car nous craignions de nous toucher les uns les autres, pensant que cela nous rendrait encore plus malades que nous ne l’étions déjà. Nous prenions des pauses interminables et les temps forts de nos journées étaient passés à contempler le néant. Nous avons découvert que c’était bon de flotter indéfiniment, de partir sans but et loin d’attentes que nous n’avions jamais bien comprises, et qu’être des mères parfaites semblait aussi futile et facile que de laisser nos enfants regarder des dessins animés pendant trois heures d’affilée pendant que nous disparaissions dans des terriers de marmottes, laissant enfin les oiseaux se poser dans nos cerveaux privés de rêveries.
Sabine Huynh
inédits
Écoute le vent, sache combien la nuit dans laquelle je m’étais glissée était lumineuse, combien elle était robe duveteuse, étoilée. Elle était chambre, emplie de ton odeur, lit, peuplé de chance et de bonheur. Cet état d’yeux fermés, qu’embrassait un souffle lourd. Au bout d’une ficelle autour de mon cou se balançaient des rêves à moitié mûrs, planètes perdues aux anneaux gazeux se heurtant sans bruit.
Sache que nous dormions dos à dos, aussi attentifs aux bruits que des louves, et que j’ai été frappée par le fait que jusqu’alors tu n’avais jamais été à proximité.
Écoute le vent, sache que lorsque je me suis réveillée tu n’étais plus là. J’ai entendu le volet grincer. Un appel long et strident, le martin-pêcheur était revenu. Puis, des petits coups rapides au-dessus de ma tête. Le corbeau a craillé trois fois, le colibri a lancé huit trilles, avant que je n’ouvre les yeux, face à la pièce muette des jours solitaires, et je me suis demandée si les étoiles de mer y voyaient quelque chose.
J’ai lu qu’elles pouvaient vivre trente-cinq ans. Ainsi, je me suis demandée si cela prendrait toute une vie jusqu’à ce que je te revoie, et quand ce fossé engloutissant tout cessera de s’élargir.
Écoute le vent, sache que je suis complètement réveillée à présent et que les planètes se sont dissoutes. J’aimerais te dire pourquoi mais le ciel blême m’en empêche, alors je préfère laisser le son harmonieux du carillon en bambou nous relier. Je me souviens du carillon jaune jonquille en forme de poisson que tu m’avais donné un jour.
Comment il luttait, pour disperser la sagesse gravée sur sa queue, qu’aucun de nous n’arrivions à lire, malgré notre ardeur.
***
Ce mois-là
Ce mois-là, je lisais L’Enfer de Dante à l’aube et la nuit je veillais sur le sommeil de mon amour. En l’écoutant respirer, je sentais ses cuisses se contracter sous le poids de rêves frénétiques, mais ce qui secouait son corps bien plus que les scènes ressurgies le matin c’était la menace invisible, aussi écrasante que l’absence totale de sons, un silence irréel que nous ne subissions qu’après un attentat-suicide dans la ville. Par ailleurs, le m de bombe est aussi silencieux que les m de membre et de tombe, même si vous les aimez énormément.
Ce mois-là, ma fille a appris à faire éclore des œufs de supermarché en regardant des vidéos et la nuit elle rêvait intensément de poussins sautant à la corde sous des néons dans des allées parfois désertes, parfois pleines de poètes barbus et sans enfants, pendant que le monde était assommé par une crise cardiaque silencieuse causée par une créature heureuse d’exister pleinement parmi les humains, la plus ouverte de tous, et qui nous révélait que vivre en gardant le silence est un traumatisme supplémentaire enduré par la plupart des survivants.
Ce mois-là, il a plu chaque nuit et j’ai fait un gâteau chaque jour, car quel mal y avait-il à mâcher au lieu de parler, ou même à rire dans un espace fermé la bouche pleine de miettes du passé ? Ai-je dit qu’à l’aube j’attendais que le soleil me dise d’aller préparer le petit-déjeuner de mes anges endormis, moins les poussins pas encore nés ? Aujourd’hui les oiseaux se sont levés avant moi et quand je me suis approchée de la fenêtre pour chercher la lumière et que je n’y ai trouvé que le reflet de mon visage et mes cheveux hirsutes, l’un d’eux est venu taper à la vitre et j’ai sursauté à la vue d’une harpie à la bouche ouverte.
Ce mois-là le printemps avait du retard et nous avons vécu sans savoir ce qui se tramait sans nous car nous craignions de nous toucher les uns les autres, pensant que cela nous rendrait encore plus malades que nous ne l’étions déjà. Nous prenions des pauses interminables et les temps forts de nos journées étaient passés à contempler le néant. Nous avons découvert que c’était bon de flotter indéfiniment, de partir sans but et loin d’attentes que nous n’avions jamais bien comprises, et qu’être des mères parfaites semblait aussi futile et facile que de laisser nos enfants regarder des dessins animés pendant trois heures d’affilée pendant que nous disparaissions dans des terriers de marmottes, laissant enfin les oiseaux se poser dans nos cerveaux privés de rêveries.
Sabine Huynh
inédits
ARNAUD BEAUJEU
Puissance du châtaignier tronc ligneux feuilles au vent
Des branchages le grincement
Socle moussu
Le chemin jonché de chatons bogues et papillons
Et des clèdes de pierre des branches qui font pont
La forêt chante la lumière chatoie sur le sentier
Dans la forêt du val perdu, ailes de libellule sèches, chamois sur un rocher
Remonter à la source aux ancêtres légers, eau profonde et perlée
Le ruisseau coule en cascade, sur la roche les étés, fraîcheur de feuille évasée
L’oiseau sous la cascade vole dans la lumière perlée, cascade de mousse et fraîcheur, à l’aura sacrée
Arnaud Beaujeu
Extraits de L'Amour de vivre, , éd. NU(e), 2014
Des branchages le grincement
Socle moussu
Le chemin jonché de chatons bogues et papillons
Et des clèdes de pierre des branches qui font pont
La forêt chante la lumière chatoie sur le sentier
Dans la forêt du val perdu, ailes de libellule sèches, chamois sur un rocher
Remonter à la source aux ancêtres légers, eau profonde et perlée
Le ruisseau coule en cascade, sur la roche les étés, fraîcheur de feuille évasée
L’oiseau sous la cascade vole dans la lumière perlée, cascade de mousse et fraîcheur, à l’aura sacrée
Arnaud Beaujeu
Extraits de L'Amour de vivre, , éd. NU(e), 2014
JEAN TARDIEU
Lettre d’ici
Je suis celui qui habite aujourd’hui parmi vous
l’un de vous. Mes souliers vont sur le goudron des villes
tranquillement comme si j’ignorais
que le sol n’est qu’une feuille mince
entre deux étendues sans couleur et sans nom.
Moi cependant qui parle j’ai un nom
je suis celui qui est là parmi vous l’un de vous
ma bouche parle mes yeux voient mes mains travaillent
innocent ! comme si j’ignorais que ma peau
n’est qu’une feuille mince
entre moi et la mort.
Je suis celui qui ne regarde pas plus haut que les toits
plus loin que l’horizon parallèle des rues
Le soleil qui se casse aux carreaux avares
me cache le sommeil étoilé du monde
où je n’ai que faire, homme de ce côté-ci.
Mon espoir ah tout mon espoir est parmi vous
près de vous près de moi je n’ai pas honte
de commencer dans les piétinements
(j’ai rêvé d’un désert où j’étais seul
mais comme j’étais seul je ne pouvais me voir
je n’existais donc plus le sable entrait en moi)
Ici je suis bien j’écoute on cause
dans la pièce à côté
et toujours cette voix même si elle change
c’est toujours vous c’est toujours moi qui parle.
que dire encore ? Nous vivons d’un verre d’eau
tiré au robinet de la cuisine
et de la vie et de la mort continuelles
dans un monde éclatant immortel
givre du temps acier des anges
pluie et feux inhumains aux quatre coins du ciel.
Jean Tardieu
Extrait de Une voix sans personne
Envoi Benoit Conort
Je suis celui qui habite aujourd’hui parmi vous
l’un de vous. Mes souliers vont sur le goudron des villes
tranquillement comme si j’ignorais
que le sol n’est qu’une feuille mince
entre deux étendues sans couleur et sans nom.
Moi cependant qui parle j’ai un nom
je suis celui qui est là parmi vous l’un de vous
ma bouche parle mes yeux voient mes mains travaillent
innocent ! comme si j’ignorais que ma peau
n’est qu’une feuille mince
entre moi et la mort.
Je suis celui qui ne regarde pas plus haut que les toits
plus loin que l’horizon parallèle des rues
Le soleil qui se casse aux carreaux avares
me cache le sommeil étoilé du monde
où je n’ai que faire, homme de ce côté-ci.
Mon espoir ah tout mon espoir est parmi vous
près de vous près de moi je n’ai pas honte
de commencer dans les piétinements
(j’ai rêvé d’un désert où j’étais seul
mais comme j’étais seul je ne pouvais me voir
je n’existais donc plus le sable entrait en moi)
Ici je suis bien j’écoute on cause
dans la pièce à côté
et toujours cette voix même si elle change
c’est toujours vous c’est toujours moi qui parle.
que dire encore ? Nous vivons d’un verre d’eau
tiré au robinet de la cuisine
et de la vie et de la mort continuelles
dans un monde éclatant immortel
givre du temps acier des anges
pluie et feux inhumains aux quatre coins du ciel.
Jean Tardieu
Extrait de Une voix sans personne
Envoi Benoit Conort
BERNARD NOËL
Le bât de la bouche
Fragments
A Jan Voss,
La vie
un peu d’eau
quelques mots sur la langue
Il n’y a que le visible
seulement il s’ampute de lui-même
pour être le jour sans la nuit
Les signes
eux
sont toujours noir sur blanc
Le lisible est lié à l’obscur
La mort écrit derrière les yeux
mais les contraires
de l’un à l’autre tendent
une même lumière
et c’est en nous l’excès de nuit
qui nous fait la peau blanche
Je sens ma voix
quand quelque chose cherche
mes lèvres
Chacun a sa part de parole
mais j’ai soif
cat le vieux désert déroule entre mes côtes
sa page de sable
Il y a partout un dessous
en travail
et le souffle comme le vent
- Qu’écris-tu donc ?
Le désir d’une piste
vers le lieu sans désir
- Que vois-tu ?
- Je vois le temps qui fait la scie
et son mouvement est l’haleine des os
Parfois
ouvert à ce qui s’ouvre
je suis ce que j’écris
mais l’ouvert est trop vaste
pour ma bouche
Parfois
j’écris contre moi
j’écris mon nom sur mon corps
et ma peau voudrait se retourner
Les dieux sont bêtes
ils gardent notre vieille maison
pendant que l’immédiat s’écroule
dans l’idée
Entre les choses et moi
je vois la venue
du là
qui n’est jamais tout à fait là
Chaque mot maintient la distance
et pourtant dans chaque mot
je la mange
Le présent n’a pas de lieu
La source n’est pas dans la source
Je me dénombre
pour dérouiller mes yeux
Bernard Noël
In Revue « Les Lettres nouvelles, février-mars 1977 » Editions Julliard, 1977
Envoi L’Antre Lieux
Fragments
A Jan Voss,
La vie
un peu d’eau
quelques mots sur la langue
Il n’y a que le visible
seulement il s’ampute de lui-même
pour être le jour sans la nuit
Les signes
eux
sont toujours noir sur blanc
Le lisible est lié à l’obscur
La mort écrit derrière les yeux
mais les contraires
de l’un à l’autre tendent
une même lumière
et c’est en nous l’excès de nuit
qui nous fait la peau blanche
Je sens ma voix
quand quelque chose cherche
mes lèvres
Chacun a sa part de parole
mais j’ai soif
cat le vieux désert déroule entre mes côtes
sa page de sable
Il y a partout un dessous
en travail
et le souffle comme le vent
- Qu’écris-tu donc ?
Le désir d’une piste
vers le lieu sans désir
- Que vois-tu ?
- Je vois le temps qui fait la scie
et son mouvement est l’haleine des os
Parfois
ouvert à ce qui s’ouvre
je suis ce que j’écris
mais l’ouvert est trop vaste
pour ma bouche
Parfois
j’écris contre moi
j’écris mon nom sur mon corps
et ma peau voudrait se retourner
Les dieux sont bêtes
ils gardent notre vieille maison
pendant que l’immédiat s’écroule
dans l’idée
Entre les choses et moi
je vois la venue
du là
qui n’est jamais tout à fait là
Chaque mot maintient la distance
et pourtant dans chaque mot
je la mange
Le présent n’a pas de lieu
La source n’est pas dans la source
Je me dénombre
pour dérouiller mes yeux
Bernard Noël
In Revue « Les Lettres nouvelles, février-mars 1977 » Editions Julliard, 1977
Envoi L’Antre Lieux
SIMONE MOLINA
un jour il s’est agi de prendre la parole
c’était il y a des années pourtant les mots échappent et la langue – ma langue maternelle – est étrangère en sa maison
un conte magnifique fut bouée et phare sur la mer rêverie au centre de l’énigme souffle pour traverser le gué il racontait l’amour et la langue – l’amour de la langue
je ne voyais pas la route sinon la lumière écrire trace et évidence pour ne rien achever qui s’est ouvert je ne sais quand écrire dans le bercement ou la stridence cris affolements muets foulard de soie posé où surgira la voix au creux de la poitrine
un jour ça se détache lambeaux fragments copeaux l’outil flamboie et ouvre le passage
(...)
tu n’es ni savant ni prophète
tu vas ta vie
portée par le vent de la plaine
tu vas
l’embrasure des roches est un refuge
sous la dent le goût du sel
le coton des images sous la paupière
tu imagines
l’oiseau de Magritte sur les saisons
elles avancent dans le pas du temps
qu’écouteras-tu
la fleur minuscule qui pourpre la couronne d’épine
la lumière nimbant l’olivier
les parures de verre d’un mât
au-delà des ruines
l’embrasement tardif des eaux
après que l’averse a grossi la rivière
après que le pont a lutté
te rassembler sous le vent sera ton pari
Simone Molina
In Voile blanche sur fond d'écran Éditions la Tête à l'envers (2016)
Envoi l'Antre Lieux
c’était il y a des années pourtant les mots échappent et la langue – ma langue maternelle – est étrangère en sa maison
un conte magnifique fut bouée et phare sur la mer rêverie au centre de l’énigme souffle pour traverser le gué il racontait l’amour et la langue – l’amour de la langue
je ne voyais pas la route sinon la lumière écrire trace et évidence pour ne rien achever qui s’est ouvert je ne sais quand écrire dans le bercement ou la stridence cris affolements muets foulard de soie posé où surgira la voix au creux de la poitrine
un jour ça se détache lambeaux fragments copeaux l’outil flamboie et ouvre le passage
(...)
tu n’es ni savant ni prophète
tu vas ta vie
portée par le vent de la plaine
tu vas
l’embrasure des roches est un refuge
sous la dent le goût du sel
le coton des images sous la paupière
tu imagines
l’oiseau de Magritte sur les saisons
elles avancent dans le pas du temps
qu’écouteras-tu
la fleur minuscule qui pourpre la couronne d’épine
la lumière nimbant l’olivier
les parures de verre d’un mât
au-delà des ruines
l’embrasement tardif des eaux
après que l’averse a grossi la rivière
après que le pont a lutté
te rassembler sous le vent sera ton pari
Simone Molina
In Voile blanche sur fond d'écran Éditions la Tête à l'envers (2016)
Envoi l'Antre Lieux
ANNE LISE BLANCHARD
Pas bouger pas bouger d’un cil. Juste fermer
les yeux pour contempler les filaments de
vieillesse se mettre en place. Veilleuse.
Vieillesse qui se joue du. Ciel sans ciller. Pas
bouger sous l’œil de la fileuse. Sinon accéléra-
tion. Vieillissement du corps
et de ses périphéries. Filer dans tous les sens,
laisser filer le sens. Silence autour des pro-
messes de cinéfaction. De la vie pourtant
abhorration. Sans que cillent les édiles ah
délicatesse de l’éloquence.
Les signes pleurent leur polysémie. Se signer
devant les maîtres du cirque maîtres du
temps. Public et privé. Dans le secret de
main à main passent des cierges quand déca-
pités les fleurs souffles cimeaux.
Cils cousus avec la paupière. Être sûr de voir
tout est pareil. Laine mordille la paupière.
Suinte le sel de la douleur. Douleur iné-dite.
Pas à dire pas à dire. Sans ciller
le sel sourd. Obstrue les artères. Lesté usé le
sens. La peur altère les sens. Entreclos juste.
Les cils perlés de sel, organes fossiles. Ils
indurent paroles volatiles. Tremblant de
lèvres tendres mais fièvre volubile oreilles
taillées, disions-nous, éradiqué le nez qui fut
saillant, colonne brisée sous votre pelisse de
cils poils soyeux.
Rendre à, comment. Son mouvement vibra-
tile à intervalles mouillés à l’animalité voulue
par l’humaine logique. Seulement si
mille saisons de lampe à huile derrière tes cils
d’oiseau venu de la steppe ne laminent veines
de sueur sellerie. Alors passe le seuil. Le seuil
impollu de mes îles où se déplient de blonds
arbres à sel enclins à sans crainte de l’œil
ensoleillé enrouler langues de sable d’aveugle
de liesse.
Derrière les cils de la rivière aux versatiles
versets, consommé le sel de l’impatience.
Doucement entendre le ressac, espace de ma
soif.
Anne-Lise Blanchard
Extrait de "Epitomé du mort et du vif", Jacques André éditeur, 2019
les yeux pour contempler les filaments de
vieillesse se mettre en place. Veilleuse.
Vieillesse qui se joue du. Ciel sans ciller. Pas
bouger sous l’œil de la fileuse. Sinon accéléra-
tion. Vieillissement du corps
et de ses périphéries. Filer dans tous les sens,
laisser filer le sens. Silence autour des pro-
messes de cinéfaction. De la vie pourtant
abhorration. Sans que cillent les édiles ah
délicatesse de l’éloquence.
Les signes pleurent leur polysémie. Se signer
devant les maîtres du cirque maîtres du
temps. Public et privé. Dans le secret de
main à main passent des cierges quand déca-
pités les fleurs souffles cimeaux.
Cils cousus avec la paupière. Être sûr de voir
tout est pareil. Laine mordille la paupière.
Suinte le sel de la douleur. Douleur iné-dite.
Pas à dire pas à dire. Sans ciller
le sel sourd. Obstrue les artères. Lesté usé le
sens. La peur altère les sens. Entreclos juste.
Les cils perlés de sel, organes fossiles. Ils
indurent paroles volatiles. Tremblant de
lèvres tendres mais fièvre volubile oreilles
taillées, disions-nous, éradiqué le nez qui fut
saillant, colonne brisée sous votre pelisse de
cils poils soyeux.
Rendre à, comment. Son mouvement vibra-
tile à intervalles mouillés à l’animalité voulue
par l’humaine logique. Seulement si
mille saisons de lampe à huile derrière tes cils
d’oiseau venu de la steppe ne laminent veines
de sueur sellerie. Alors passe le seuil. Le seuil
impollu de mes îles où se déplient de blonds
arbres à sel enclins à sans crainte de l’œil
ensoleillé enrouler langues de sable d’aveugle
de liesse.
Derrière les cils de la rivière aux versatiles
versets, consommé le sel de l’impatience.
Doucement entendre le ressac, espace de ma
soif.
Anne-Lise Blanchard
Extrait de "Epitomé du mort et du vif", Jacques André éditeur, 2019
GABRIEL LE GAL
Le corps s'est alourdi
Tombant sur soi
Traînant sa vie
Pourrait-il en monter
Voeu suprême ou défi
Tout muscle et dispos
Le poème
L'enfance toujours prête
Le danseur sous la peau
Mon vieux poirier, lui,
A ne crouler
Que sous les fleurs
Gabriel Le Gal
Extrait de "Ainsi va le poème" Ed. Jacques André 2006
Envoi Anne Lise Blanchard
Tombant sur soi
Traînant sa vie
Pourrait-il en monter
Voeu suprême ou défi
Tout muscle et dispos
Le poème
L'enfance toujours prête
Le danseur sous la peau
Mon vieux poirier, lui,
A ne crouler
Que sous les fleurs
Gabriel Le Gal
Extrait de "Ainsi va le poème" Ed. Jacques André 2006
Envoi Anne Lise Blanchard
PALOMA KIRCHMANN
Octobre
Ainsi va le poème de la terreur
les vers cheminent parmi les larmes en cage
des cris de révolte font jaillir le sang des sacs de dignité et de courage
pèsent sur le dos comme des pierres
avancent dans les rues tapissées de colère
Courir courir courir
Des messagers de la mort galopent vers le peuple
Des monstres de pouvoir le visent, ce David
Qui crie devant
Courir courir courir
Toutes les rues sont l’enfer et dans le ciel des oiseaux empoisonnés
Plombés de gaz foncent dans le mur du silence
les enfants agrippés à leurs mères qui agrippent casserole et banderole
Grandissent à chaque pas et font l’histoire
Courir courir courir
Nous sommes des bêtes pour le corbeau vert
et son bec qui s’allonge nous condamne
À la cruelle roue de l'infamie
Et mutilés, nous devenons invincibles
Nous tendons les mains et nos poings
Deviendront bâton et oeil
Courir courir courir furieux et gavés de poudre ils viennent
pour faire taire les tambours, nous accuser
effacer nos messages, nous accabler mais la rue est à nous et nous ne bougerons pas
Paloma Kirchmann
Traduit de l’espagnol (Chili) Lucile Cranskens
Envoi Caroline Cranskens
Ainsi va le poème de la terreur
les vers cheminent parmi les larmes en cage
des cris de révolte font jaillir le sang des sacs de dignité et de courage
pèsent sur le dos comme des pierres
avancent dans les rues tapissées de colère
Courir courir courir
Des messagers de la mort galopent vers le peuple
Des monstres de pouvoir le visent, ce David
Qui crie devant
Courir courir courir
Toutes les rues sont l’enfer et dans le ciel des oiseaux empoisonnés
Plombés de gaz foncent dans le mur du silence
les enfants agrippés à leurs mères qui agrippent casserole et banderole
Grandissent à chaque pas et font l’histoire
Courir courir courir
Nous sommes des bêtes pour le corbeau vert
et son bec qui s’allonge nous condamne
À la cruelle roue de l'infamie
Et mutilés, nous devenons invincibles
Nous tendons les mains et nos poings
Deviendront bâton et oeil
Courir courir courir furieux et gavés de poudre ils viennent
pour faire taire les tambours, nous accuser
effacer nos messages, nous accabler mais la rue est à nous et nous ne bougerons pas
Paloma Kirchmann
Traduit de l’espagnol (Chili) Lucile Cranskens
Envoi Caroline Cranskens
PAUL NOUGÉ
L'intérieur de votre tête
n'est pas cette
masse
grise et blanche
que l'on vous a dite
c'est un
paysage
de sources et de branches
une
maison de feu
mieux encore
la
ville miraculeuse
qu'il vous plaira
d'
inventer.
Paul Nougé (1895-1967)
envoi Katrine D.
n'est pas cette
masse
grise et blanche
que l'on vous a dite
c'est un
paysage
de sources et de branches
une
maison de feu
mieux encore
la
ville miraculeuse
qu'il vous plaira
d'
inventer.
Paul Nougé (1895-1967)
envoi Katrine D.
JEAN PIERRE THUILLAT
Petit matin à la fenêtre
Virus couronné
frasques des hommes
mais par-dessus tout ça
la Grande Ourse toujours là
ce matin à 5 heures
calée sur l'occident.
Et l'étoile polaire
à cinq pas derrière elle
montre toujours le nord
dans son clin d'oeil complice.
Rien n'a bougé dans notre ciel
l'émotion de la pandémie
n'a pas même déplacé
d'un cheveu la planète.
Jean-Pierre Thuillat
inédit
Virus couronné
frasques des hommes
mais par-dessus tout ça
la Grande Ourse toujours là
ce matin à 5 heures
calée sur l'occident.
Et l'étoile polaire
à cinq pas derrière elle
montre toujours le nord
dans son clin d'oeil complice.
Rien n'a bougé dans notre ciel
l'émotion de la pandémie
n'a pas même déplacé
d'un cheveu la planète.
Jean-Pierre Thuillat
inédit
GISÈLE SANS
La maison dans le parc
En souvenir de la maison natale de Frédéric Chopin à Żelazowa Wola
1
Habiter une maison de verre
sans cloisons
avec des rameaux bienveillants
appuyés
et des liserons volubiles
un jardin de fleurs
à offrir
qui s’invite à l’intérieur
2
Parfois
des zéniths imperturbables
d’espérance
des couchants écarlates
teintés de garance
qui se courbent
de tendresse
et précèdent
les mauves du soir
3
La spirale de l’escalier vers la lumière
des étoiles à poursuivre
des éclats oubliés de lune
dans tous ses états
avant
la rosée des matins clairs
les collines qui se touchent
les visages qui se penchent
les silences pleins de sens
4
Nature et musique
avec un piano fou
comme une chevelure
dans la nostalgie
des modes mineurs
de la joie
au bord des larmes
Pureté et perfection
au milieu des fougères souples
des plantes ornementales
qui accueillent
l’épeire
et sa toile de soie
5
Beauté sauvage
contenue
La maison se cherche
dans les accords
revit
Vibrants feuillages
pleins d’oiseaux épanouis
lorsque les agapanthes
chantent
leur arrogance
pour un temps
Gisèle Sans
In Personne ne dira le dernier mot
En souvenir de la maison natale de Frédéric Chopin à Żelazowa Wola
1
Habiter une maison de verre
sans cloisons
avec des rameaux bienveillants
appuyés
et des liserons volubiles
un jardin de fleurs
à offrir
qui s’invite à l’intérieur
2
Parfois
des zéniths imperturbables
d’espérance
des couchants écarlates
teintés de garance
qui se courbent
de tendresse
et précèdent
les mauves du soir
3
La spirale de l’escalier vers la lumière
des étoiles à poursuivre
des éclats oubliés de lune
dans tous ses états
avant
la rosée des matins clairs
les collines qui se touchent
les visages qui se penchent
les silences pleins de sens
4
Nature et musique
avec un piano fou
comme une chevelure
dans la nostalgie
des modes mineurs
de la joie
au bord des larmes
Pureté et perfection
au milieu des fougères souples
des plantes ornementales
qui accueillent
l’épeire
et sa toile de soie
5
Beauté sauvage
contenue
La maison se cherche
dans les accords
revit
Vibrants feuillages
pleins d’oiseaux épanouis
lorsque les agapanthes
chantent
leur arrogance
pour un temps
Gisèle Sans
In Personne ne dira le dernier mot
DOMINIQUE ZINENBERG
Les mots ne coulent pas de source
Ils se tiennent à carreaux,
calfeutrés dans l’ombre,
comme si on allait leur taper dessus
s’ils ne sont ni propres,
ni appropriés.
Les mots ont peur du châtiment
qui les menace, s’ils ne filent pas droit.
Ce qui leur pend au nez,
• Passez-moi l’expression -
C’est la censure, la biffure, le caviardage.
En voilà des manières de revendiquer la solidarité de la
répétition,
voire de l’anaphore !
En voilà du toupet de rechercher un mot valise
au moment où plus personne ne voyage,
de marcher l’amble avec un oxymore, se rapprochant ainsi
dangereusement du voisin à qui l’on battait froid,
d’ordinaire.
Et que dire de l’outrecuidance de ces mots pris en flagrant délit
de métaphores, de métonymies et autres personnifications !
Les mots pris de panique au mieux balbutient, bégaient, en oublient l’orthographe ;
Au pire, les voilà comme des carpes.
Maltraités par l’adversité, ils utilisent l’euphémisme ou bien la litote,
bannissent à corps perdus l’ostentatoire hyperbole.
Ils deviennent hypocrites et se camouflent dans la périphrase ou l’antiphrase.
On ne les reconnaît plus.
Ils sortent masqués comme s’ils craignaient,
ô qu’ils sont bêtes,
une contamination…
On ne peut même plus se payer de mots à présent !
Dominique Zinenberg,
inédit.
Ils se tiennent à carreaux,
calfeutrés dans l’ombre,
comme si on allait leur taper dessus
s’ils ne sont ni propres,
ni appropriés.
Les mots ont peur du châtiment
qui les menace, s’ils ne filent pas droit.
Ce qui leur pend au nez,
• Passez-moi l’expression -
C’est la censure, la biffure, le caviardage.
En voilà des manières de revendiquer la solidarité de la
répétition,
voire de l’anaphore !
En voilà du toupet de rechercher un mot valise
au moment où plus personne ne voyage,
de marcher l’amble avec un oxymore, se rapprochant ainsi
dangereusement du voisin à qui l’on battait froid,
d’ordinaire.
Et que dire de l’outrecuidance de ces mots pris en flagrant délit
de métaphores, de métonymies et autres personnifications !
Les mots pris de panique au mieux balbutient, bégaient, en oublient l’orthographe ;
Au pire, les voilà comme des carpes.
Maltraités par l’adversité, ils utilisent l’euphémisme ou bien la litote,
bannissent à corps perdus l’ostentatoire hyperbole.
Ils deviennent hypocrites et se camouflent dans la périphrase ou l’antiphrase.
On ne les reconnaît plus.
Ils sortent masqués comme s’ils craignaient,
ô qu’ils sont bêtes,
une contamination…
On ne peut même plus se payer de mots à présent !
Dominique Zinenberg,
inédit.
JOSÉ ENGEL VALENTE
L’apparition de l’oiseau qui vole et
revient et qui se pose
sur ta poitrine et te transforme en grain,
grumeau, goutte céréale, l’oiseau
qui vole à l’intérieur
de toi, tandis que tu deviens
pure transparence,
pure lumière,
ta pure matière, corps
absorbé par l’oiseau.
(...)
Dans l'assoiffé, l'obscur, le rapide
déchirement du jour
t'es-tu peu à peu changé en autre chose
limitrophe de toi,
pas toi.
Tu ne te
retrouves pas
si tu reviens à tâtons
au corps qui fut le tien,
au lieu où avait brûlé
jusqu'au blanc du rêve
le métal de l'amour.
Dépose ton visage
qu'à présent tu ne connais plus.
Laisse fuir tes paroles,
libère-les de toi
et passe lentement
sans mémoire et aveugle,
sous l'arc doré
qu'étend là-haut le vaste automne
comme un hommage posthume aux ombres.
(...)
Ton image mélancolique
sur la vitre si ténue
effacée par la pluie
est l'image d'un enfant
toujours penché au-dedans de lui-même
qui cherche à tâtons l'image brisée
de ce qu'il a voulu être.
José Angel Valente
In Fragments d’un livre futur Traduction Jacques Ancet Éditions José Corti
Envoi L' Antre Lieux
revient et qui se pose
sur ta poitrine et te transforme en grain,
grumeau, goutte céréale, l’oiseau
qui vole à l’intérieur
de toi, tandis que tu deviens
pure transparence,
pure lumière,
ta pure matière, corps
absorbé par l’oiseau.
(...)
Dans l'assoiffé, l'obscur, le rapide
déchirement du jour
t'es-tu peu à peu changé en autre chose
limitrophe de toi,
pas toi.
Tu ne te
retrouves pas
si tu reviens à tâtons
au corps qui fut le tien,
au lieu où avait brûlé
jusqu'au blanc du rêve
le métal de l'amour.
Dépose ton visage
qu'à présent tu ne connais plus.
Laisse fuir tes paroles,
libère-les de toi
et passe lentement
sans mémoire et aveugle,
sous l'arc doré
qu'étend là-haut le vaste automne
comme un hommage posthume aux ombres.
(...)
Ton image mélancolique
sur la vitre si ténue
effacée par la pluie
est l'image d'un enfant
toujours penché au-dedans de lui-même
qui cherche à tâtons l'image brisée
de ce qu'il a voulu être.
José Angel Valente
In Fragments d’un livre futur Traduction Jacques Ancet Éditions José Corti
Envoi L' Antre Lieux
SÉBASTIEN MINAUX
Toutes ces femmes qui assemblent les chemises, l’attente peinte sur les lèvres. Qui dira leurs désirs le doigt posé sur l’or du soir ?
Quand vient midi les portes s’ouvrent. Allongées près du fleuve, un rêve à chaque doigt, leur souffle est un coton léger.
Elles font la couture des vallées qui accueillent les morts, posés là parmi les feuilles de bronze.
Et leur sourire est une énigme, un chiffre sans nom.
Sébastien Minaux
Poème paru en 2019 dans "Concerto pour marées et silence, revue"
Envoi Colette Klein
Quand vient midi les portes s’ouvrent. Allongées près du fleuve, un rêve à chaque doigt, leur souffle est un coton léger.
Elles font la couture des vallées qui accueillent les morts, posés là parmi les feuilles de bronze.
Et leur sourire est une énigme, un chiffre sans nom.
Sébastien Minaux
Poème paru en 2019 dans "Concerto pour marées et silence, revue"
Envoi Colette Klein
LUMINITZA C. TIGIRLAS
Temps d’obéir au désamour crucifié
lorsque le sol s’ouvre
La terre dé-tremblera-t-elle ?
Ah mélange docile entre les mains
de la sainte amnésie. Elle est en tendresse
avec une fileuse de l’invisible velours
Tu me remets une pelure – ta mémoire
est en déportation de la trajectoire lactée
Un téton délie tes lèvres
*
Tu l’as surprise : elle accouche de sa splendeur
Sous les œillades de l’avoine bleutée
l’amie du blanc extrême de la pivoine
Ici à nouveau – dans tes visions rutilantes
l’obéissance se fendille d’un ton inénarrable
Œuf dévot d’un mystère dévoreur
Ton eau s’égosille
Ton vent cherche la poupe d’une barque en papyrus
son écrit s’est tourné sur les parois de la cale
Le naufrage renoue les vœux d’allégeance
avec un nouveau sommeil
Luminitza C. Tigirlas
Fragments inédits
Site personnel : C. Tigirlas - Le mot infini du poème
lorsque le sol s’ouvre
La terre dé-tremblera-t-elle ?
Ah mélange docile entre les mains
de la sainte amnésie. Elle est en tendresse
avec une fileuse de l’invisible velours
Tu me remets une pelure – ta mémoire
est en déportation de la trajectoire lactée
Un téton délie tes lèvres
*
Tu l’as surprise : elle accouche de sa splendeur
Sous les œillades de l’avoine bleutée
l’amie du blanc extrême de la pivoine
Ici à nouveau – dans tes visions rutilantes
l’obéissance se fendille d’un ton inénarrable
Œuf dévot d’un mystère dévoreur
Ton eau s’égosille
Ton vent cherche la poupe d’une barque en papyrus
son écrit s’est tourné sur les parois de la cale
Le naufrage renoue les vœux d’allégeance
avec un nouveau sommeil
Luminitza C. Tigirlas
Fragments inédits
Site personnel : C. Tigirlas - Le mot infini du poème
JASNA SAMIC
Confinement
Dans ma ville assiégée pendant quatre ans dans les années 90, les apprentis du mal ne cessaient de voler et violer, leurs maîtres réduisaient tout en cendre. Et les seigneurs de guerre, imbibés de sang, chantaient l'amour. L'amour de leur peuple ! Sous les ruines, les poètes cherchaient un éditeur, les vieillards cherchaient des miettes de pain, fumant des cigarettes faites des livres de poètes de la ville meurtrie, tandis que les serviteurs du mal pour un tas de ducats vendaient des bougies sous lesquelles les poètes dans leurs maisons sans murs chantaient leur mort proche.
Pendant ce temps-là, dans la ville lumière, dans toutes les villes non assiégées, on ne faisait que calculer, vendre, courir, s'amuser, s'embrasser. On vendait tout, parfois même le brouillard, de la fumée. Tout était calculé au détail près. Tout courait.
Vers où?
Dans les villes libres, comme dans les villes meurtries, les poètes s'évertuaient à faire leur prière : leurs vers que personne n'entendait.
Impossible de ne pas comparer. A moins que rien ne soit comparable. Il y a presque 30 ans, la guerre éclata en Yougoslavie. Vukovar rasée, personne ne crut à la guerre. Les Sarajeviens « confinés » ne crurent pas au mal. Mais soupçonnaient leur fin. Tout en restant libres. Libres de mourir ! De jouer avec sa vie.
Nous voilà dans la ville lumière libre, emprisonnés. Par l’invisible. On payera cher au visible - l’état - si on veut rester libre. Si on décide de sortir. Si on veut être libre de mourir. Et liberté tue en ce moment.
Non, rien n’est comparable !
Dans ma ville assiégée, il n’y avait rien à manger. Rien d’autre que la liberté d’être tué.
A Paris, on mange, on achète. Et calcule. La mort nous menace. Mais vit-on vraiment ? Vivions-nous pendant que les cadrans de l’horloge tournaient follement ? Le temps s’est figé.
Le temps- l’une de nos illusions.
La Planète se venge contre cette montre démente, contre nos semblables : mégalomanes, escrocs qui la conduisent depuis une belle lurette vers une fin tragique.
On n’avait pas d’imagination pour deviner son aspect.
Les menteurs et les escrocs vont-ils être punis ? Ou bien seront-ils encore plus redoutables après le drame ? Drame nommé virus.
Je regarde autour de moi. Attends. Quoi ?
« Regarde l’irréel omniprésent », conseille le philosophe. (…) Mais jusqu’à quand ? Jusqu’à la perte de l’esprit ».
Triste poète, as-tu raison ? On ne t’a jamais écouté.
Sans doute ai-je moi aussi compté: des instants et des larmes, des astres, des fleurs. Comme tout le reste. Aujourd’hui, je connais le vide. Celui de tout poète, de tout être lucide.
Le Tout Puissant n’a jamais compté ses morts. On tue à son nom sans répit.
La mort menace. Pas d’obus cette fois-ci, ni chars, ni feu.
Le ciel entre dans ma chambre par la fenêtre ouverte. Je contemple le monde renfermé. Regarde l’arbre dans la cour, pense au mal inné à l’homme. Solidaires et bons, après les catastrophes il devient encore plus mauvais. Ainsi se passa-t-il dans les Balkans après la guerre.
Je vois la lune, la fleur sur mon balcon, ne vois que les souvenirs : hommes et femmes, immenses poupées mécaniques dansent et pleurent, tombent, puis se relèvent, chantent et crient, marionnettes aliénées ! On meurt sans savoir ce que c'est, on vit sans savoir ce qu'est la vie.
Une autre image m’assaille : une lune rouge cyclopéenne à la bouche grande ouverte pour nous boire. Tandis que des miroirs géants content nos heures déchirantes.
Ne cherchez pas à comprendre. Qui dit confinement, dit souvenirs. Qui dit souvenirs, dit images. Qui dit images, dit hallucinations.
Voilà mon confinement. Vire-t-il à la démence ? Ou à la poésie ?
Jasna Samic
inédit
Dans ma ville assiégée pendant quatre ans dans les années 90, les apprentis du mal ne cessaient de voler et violer, leurs maîtres réduisaient tout en cendre. Et les seigneurs de guerre, imbibés de sang, chantaient l'amour. L'amour de leur peuple ! Sous les ruines, les poètes cherchaient un éditeur, les vieillards cherchaient des miettes de pain, fumant des cigarettes faites des livres de poètes de la ville meurtrie, tandis que les serviteurs du mal pour un tas de ducats vendaient des bougies sous lesquelles les poètes dans leurs maisons sans murs chantaient leur mort proche.
Pendant ce temps-là, dans la ville lumière, dans toutes les villes non assiégées, on ne faisait que calculer, vendre, courir, s'amuser, s'embrasser. On vendait tout, parfois même le brouillard, de la fumée. Tout était calculé au détail près. Tout courait.
Vers où?
Dans les villes libres, comme dans les villes meurtries, les poètes s'évertuaient à faire leur prière : leurs vers que personne n'entendait.
Impossible de ne pas comparer. A moins que rien ne soit comparable. Il y a presque 30 ans, la guerre éclata en Yougoslavie. Vukovar rasée, personne ne crut à la guerre. Les Sarajeviens « confinés » ne crurent pas au mal. Mais soupçonnaient leur fin. Tout en restant libres. Libres de mourir ! De jouer avec sa vie.
Nous voilà dans la ville lumière libre, emprisonnés. Par l’invisible. On payera cher au visible - l’état - si on veut rester libre. Si on décide de sortir. Si on veut être libre de mourir. Et liberté tue en ce moment.
Non, rien n’est comparable !
Dans ma ville assiégée, il n’y avait rien à manger. Rien d’autre que la liberté d’être tué.
A Paris, on mange, on achète. Et calcule. La mort nous menace. Mais vit-on vraiment ? Vivions-nous pendant que les cadrans de l’horloge tournaient follement ? Le temps s’est figé.
Le temps- l’une de nos illusions.
La Planète se venge contre cette montre démente, contre nos semblables : mégalomanes, escrocs qui la conduisent depuis une belle lurette vers une fin tragique.
On n’avait pas d’imagination pour deviner son aspect.
Les menteurs et les escrocs vont-ils être punis ? Ou bien seront-ils encore plus redoutables après le drame ? Drame nommé virus.
Je regarde autour de moi. Attends. Quoi ?
« Regarde l’irréel omniprésent », conseille le philosophe. (…) Mais jusqu’à quand ? Jusqu’à la perte de l’esprit ».
Triste poète, as-tu raison ? On ne t’a jamais écouté.
Sans doute ai-je moi aussi compté: des instants et des larmes, des astres, des fleurs. Comme tout le reste. Aujourd’hui, je connais le vide. Celui de tout poète, de tout être lucide.
Le Tout Puissant n’a jamais compté ses morts. On tue à son nom sans répit.
La mort menace. Pas d’obus cette fois-ci, ni chars, ni feu.
Le ciel entre dans ma chambre par la fenêtre ouverte. Je contemple le monde renfermé. Regarde l’arbre dans la cour, pense au mal inné à l’homme. Solidaires et bons, après les catastrophes il devient encore plus mauvais. Ainsi se passa-t-il dans les Balkans après la guerre.
Je vois la lune, la fleur sur mon balcon, ne vois que les souvenirs : hommes et femmes, immenses poupées mécaniques dansent et pleurent, tombent, puis se relèvent, chantent et crient, marionnettes aliénées ! On meurt sans savoir ce que c'est, on vit sans savoir ce qu'est la vie.
Une autre image m’assaille : une lune rouge cyclopéenne à la bouche grande ouverte pour nous boire. Tandis que des miroirs géants content nos heures déchirantes.
Ne cherchez pas à comprendre. Qui dit confinement, dit souvenirs. Qui dit souvenirs, dit images. Qui dit images, dit hallucinations.
Voilà mon confinement. Vire-t-il à la démence ? Ou à la poésie ?
Jasna Samic
inédit
MICHÈLE PASSIGNANI
Nord
Les avions ont redessiné le ciel
Y traçant leurs blanches scarifications,
Toile abstraite que la nature ne reconnaît pas.
Les bras des éoliennes brassent du vent
Paroles en l’air
Personne ne les comprend.
Ballet géométrique
Des bras damnés brandis vers des cieux aveugles
Épouvantails à tête d’alien des plaines picardes
Leur unique œil d’étoile des vents cligne
Tel un Nouveau Phare sur les mers brunes des terres grasses.
Les pylônes électriques vous regardent avec envie :
Vous leur semblez libres.
Leurs bras écartés et faméliques restent pour toujours figés dans leurs lianes de cuivre,
Tandis que vous dansez lorsque le vent vous enchante.
Droit devant : la mer
Grise
Probablement
Michèle Passignani
inédit
Envoi Anne Talvaz
Les avions ont redessiné le ciel
Y traçant leurs blanches scarifications,
Toile abstraite que la nature ne reconnaît pas.
Les bras des éoliennes brassent du vent
Paroles en l’air
Personne ne les comprend.
Ballet géométrique
Des bras damnés brandis vers des cieux aveugles
Épouvantails à tête d’alien des plaines picardes
Leur unique œil d’étoile des vents cligne
Tel un Nouveau Phare sur les mers brunes des terres grasses.
Les pylônes électriques vous regardent avec envie :
Vous leur semblez libres.
Leurs bras écartés et faméliques restent pour toujours figés dans leurs lianes de cuivre,
Tandis que vous dansez lorsque le vent vous enchante.
Droit devant : la mer
Grise
Probablement
Michèle Passignani
inédit
Envoi Anne Talvaz
ARMAND MONJO
DU TEMPS EN PLUS
Du temps en plus pour l'amitié des plantes
pour une orbe élargie de caresses
pour plus de science à respirer
cette bouche de joie la fleur
Plus subtile l'oreille
aux vies élémentaires
du bois de la pierre des flammes
Plus disponible à la foule des feuilles
ces mains tendues
Du temps pour tendre une lanterne
à l'inconnu perdu dans son brouillard
pour transmettre au voisin le geste qui libère
le regard qui nourrit
pour apprendre aux plus mal vivants
ce temps en plus
qui peut-être pourra doubler leur vie
Armand Monjo (1913-1998)
La Quadrature du XXe siècle, éditions Subervie, 1983.
Envoi Jacques Fournier
Du temps en plus pour l'amitié des plantes
pour une orbe élargie de caresses
pour plus de science à respirer
cette bouche de joie la fleur
Plus subtile l'oreille
aux vies élémentaires
du bois de la pierre des flammes
Plus disponible à la foule des feuilles
ces mains tendues
Du temps pour tendre une lanterne
à l'inconnu perdu dans son brouillard
pour transmettre au voisin le geste qui libère
le regard qui nourrit
pour apprendre aux plus mal vivants
ce temps en plus
qui peut-être pourra doubler leur vie
Armand Monjo (1913-1998)
La Quadrature du XXe siècle, éditions Subervie, 1983.
Envoi Jacques Fournier
FEMMES DALIT
Quelle tromperie (Taruśhikhā)
Ta mainmise sur l’eau sacrée du Gange
Et pour moi pas même de puits
La femme de ton foyer, une ‘déesse’
Et pour moi pas même une bénédiction ?
En lui faisant porter des atours de princesse
Tu la maintiens elle aussi dans la tromperie
Et nous arraches
Jusqu’à notre peau d’être humain !
Mais nous savons tous déjà
Comment tu as divisé
Pour mieux régner
Pour que ton opinion soit imposée
Trouve quelque chose d’autre à présent
Tous ces arguments sont dépassés
Nous parlerons d’égal à égal
Assez d’arbitraire
Contiens-toi donc un peu à présent.
Tu t’écrouleras (Bhāṣhā Siṅgh)
Je ne t’apparais pas
Tu ne parviens pas à me voir
Nulle part tu n’enregistres mon existence
Je suis absente de tes cartes, de l’ensemble de tes sondages
Au tribunal toutes tes déclarations sous serment
Nient
Mon existence
Elle ne veut rien voir, ta société ‘civilisée’
décochant mensonge sur mensonge, tes gouvernements
Projettent toute leur puissance
Contre moi
Me croyant épuisée
Noyés dans l’impudence
Tes yeux éclatent d’un rire tonitruant
Tu ne sais pas
Qu’à partir du jour où je jetterai
Ton panier plein d’excréments
Tu t’écrouleras
Sur les belles demeures de la civilisation
Et
Tu ne seras plus visible nulle part.
Pour une poignée de ciel, poèmes au nom des femmes Dalit
Traduction par Jiliane Cardey d’une anthologie en langue hindi parue en 2013 à Delhi. Cette anthologie donne la parole à des « intouchables », Dalit, et des autochtones, Ādivāsī, de l’Inde.
Editions Bruno Doucey, 2020
Ta mainmise sur l’eau sacrée du Gange
Et pour moi pas même de puits
La femme de ton foyer, une ‘déesse’
Et pour moi pas même une bénédiction ?
En lui faisant porter des atours de princesse
Tu la maintiens elle aussi dans la tromperie
Et nous arraches
Jusqu’à notre peau d’être humain !
Mais nous savons tous déjà
Comment tu as divisé
Pour mieux régner
Pour que ton opinion soit imposée
Trouve quelque chose d’autre à présent
Tous ces arguments sont dépassés
Nous parlerons d’égal à égal
Assez d’arbitraire
Contiens-toi donc un peu à présent.
Tu t’écrouleras (Bhāṣhā Siṅgh)
Je ne t’apparais pas
Tu ne parviens pas à me voir
Nulle part tu n’enregistres mon existence
Je suis absente de tes cartes, de l’ensemble de tes sondages
Au tribunal toutes tes déclarations sous serment
Nient
Mon existence
Elle ne veut rien voir, ta société ‘civilisée’
décochant mensonge sur mensonge, tes gouvernements
Projettent toute leur puissance
Contre moi
Me croyant épuisée
Noyés dans l’impudence
Tes yeux éclatent d’un rire tonitruant
Tu ne sais pas
Qu’à partir du jour où je jetterai
Ton panier plein d’excréments
Tu t’écrouleras
Sur les belles demeures de la civilisation
Et
Tu ne seras plus visible nulle part.
Pour une poignée de ciel, poèmes au nom des femmes Dalit
Traduction par Jiliane Cardey d’une anthologie en langue hindi parue en 2013 à Delhi. Cette anthologie donne la parole à des « intouchables », Dalit, et des autochtones, Ādivāsī, de l’Inde.
Editions Bruno Doucey, 2020
HALA MOHAMMAD
Idée 1
La maison n'est plus qu'une idée
Au seuil un paillasson bleu sur lequel on peut lire Bienvenue
en arabe et en anglais
Au milieu de nuages qui rient
Tu sonnes et la porte rit. La maison s'ouvre devant toi et
rit. Les chambres, les assiettes, la table et la poussière
sur les rideaux rient. Le carrelage, comme l'or du soleil
qui s'y colore, rit.
Le mur abattu par le bombardement rit. Les décombres
où les oiseaux ont construit leurs nids rient
La paille et le nid rient. Le triste roseau du nay,
éclaboussé par le ruisseau, et le ruisseau rient
Les voix restées à la maison de ceux qui sont partis,
résonnent encore et rient
Et celui qui y demeure, demeure dans une photo qui rit,
sur un mur qui rit.
Hala Mohammad
in Prête-moi une fenêtre, éd. Bruno Doucey, 2018, trad. de l'arabe (Syrie) par Antoine Jockey
Envoi Jacques Fournier
Née à Lattaquié,
La maison n'est plus qu'une idée
Au seuil un paillasson bleu sur lequel on peut lire Bienvenue
en arabe et en anglais
Au milieu de nuages qui rient
Tu sonnes et la porte rit. La maison s'ouvre devant toi et
rit. Les chambres, les assiettes, la table et la poussière
sur les rideaux rient. Le carrelage, comme l'or du soleil
qui s'y colore, rit.
Le mur abattu par le bombardement rit. Les décombres
où les oiseaux ont construit leurs nids rient
La paille et le nid rient. Le triste roseau du nay,
éclaboussé par le ruisseau, et le ruisseau rient
Les voix restées à la maison de ceux qui sont partis,
résonnent encore et rient
Et celui qui y demeure, demeure dans une photo qui rit,
sur un mur qui rit.
Hala Mohammad
in Prête-moi une fenêtre, éd. Bruno Doucey, 2018, trad. de l'arabe (Syrie) par Antoine Jockey
Envoi Jacques Fournier
Née à Lattaquié,
BENJAMIN FONDANE
C’est à vous que je parle, homme des antipodes,
je parle d’homme à homme,
avec le peu en moi qui demeure de l’homme,
avec le peu de voix qui me reste au gosier,
mon sang est sur les routes, puisse-t-il, puisse-t-il
ne pas crier vengeance !
L’hallali est donné, les bêtes sont traquées,
laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots
que nous eûmes en partage –
il reste peu d’intelligibles !
Un jour viendra, c’est sûr, de la soif apaisée,
nous serons au-delà du souvenir, la mort,
aura parachevé les travaux de la haine,
je serai un bouquet d’orties sous vos pieds,
- alors, eh bien, sachez que j’avais un visage
comme vous. Une bouche qui priait, comme vous.
(...)
Oui, j’ai été un homme comme les autres hommes,
nourri de pain, de rêve, de désespoir. Eh oui,
j’ai aimé, j’ai pleuré, j’ai haï, j’ai souffert,
j’ai acheté des fleurs et je n’ai pas toujours
payé mon terme. Le dimanche j’allais à la campagne
pêcher, sous l’œil de Dieu, des poissons irréels,
je me baignais dans la rivière
qui chantait dans les joncs et je mangeais des frites
le soir. Après, après, je rentrais me coucher
fatigué, le cœur las et plein de solitude,
plein de pitié pour moi,
plein de pitié pour l’homme,
cherchant, cherchant en vain sur un ventre de femme
cette paix impossible que nous avions perdue
naguère, dans un grand verger où fleurissait
au centre, l’arbre de la vie…
(...)
Un jour viendra sans doute, quand le poème lu
se trouvera devant vos yeux. Il ne demande
rien ! Oubliez-le, oubliez-le ! Ce n’est
qu’un cri, qu’on ne peut pas mettre dans un poème
parfait, avais-je donc le temps de le finir ?
Mais quand vous foulerez ce bouquet d’orties
qui avait été moi, dans un autre siècle,
en une histoire qui vous sera périmée,
souvenez-vous seulement que j’étais innocent
et que, tout comme vous, mortels de ce jour-là,
j’avais eu, moi aussi, un visage marqué
par la colère, par la pitié et la joie,
un visage d’homme, tout simplement !
Benjamin Fondane
In L’exode Éditions de la Fenêtre ardente, 1965
Envoi l'Antre Lieux
je parle d’homme à homme,
avec le peu en moi qui demeure de l’homme,
avec le peu de voix qui me reste au gosier,
mon sang est sur les routes, puisse-t-il, puisse-t-il
ne pas crier vengeance !
L’hallali est donné, les bêtes sont traquées,
laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots
que nous eûmes en partage –
il reste peu d’intelligibles !
Un jour viendra, c’est sûr, de la soif apaisée,
nous serons au-delà du souvenir, la mort,
aura parachevé les travaux de la haine,
je serai un bouquet d’orties sous vos pieds,
- alors, eh bien, sachez que j’avais un visage
comme vous. Une bouche qui priait, comme vous.
(...)
Oui, j’ai été un homme comme les autres hommes,
nourri de pain, de rêve, de désespoir. Eh oui,
j’ai aimé, j’ai pleuré, j’ai haï, j’ai souffert,
j’ai acheté des fleurs et je n’ai pas toujours
payé mon terme. Le dimanche j’allais à la campagne
pêcher, sous l’œil de Dieu, des poissons irréels,
je me baignais dans la rivière
qui chantait dans les joncs et je mangeais des frites
le soir. Après, après, je rentrais me coucher
fatigué, le cœur las et plein de solitude,
plein de pitié pour moi,
plein de pitié pour l’homme,
cherchant, cherchant en vain sur un ventre de femme
cette paix impossible que nous avions perdue
naguère, dans un grand verger où fleurissait
au centre, l’arbre de la vie…
(...)
Un jour viendra sans doute, quand le poème lu
se trouvera devant vos yeux. Il ne demande
rien ! Oubliez-le, oubliez-le ! Ce n’est
qu’un cri, qu’on ne peut pas mettre dans un poème
parfait, avais-je donc le temps de le finir ?
Mais quand vous foulerez ce bouquet d’orties
qui avait été moi, dans un autre siècle,
en une histoire qui vous sera périmée,
souvenez-vous seulement que j’étais innocent
et que, tout comme vous, mortels de ce jour-là,
j’avais eu, moi aussi, un visage marqué
par la colère, par la pitié et la joie,
un visage d’homme, tout simplement !
Benjamin Fondane
In L’exode Éditions de la Fenêtre ardente, 1965
Envoi l'Antre Lieux
PIER PAOLO PASOLINI
Cette lumière était espérance de justice :
je ne savais laquelle : la Justice.
La lumière est toujours pareille à la lumière.
Puis elle changea : de lumière, elle se fit aube incertaine,
une aube qui croissait, qui grandissait
sur les champs du Frioul, sur les canaux.
Elle éclairait les journaliers en lutte.
Ainsi l’aube naissante fut une lumière
en dehors de l’éternité du style…
Dans l’histoire, la justice fut conscience
d’une division humaine des richesses,
et l’espérance prit une nouvelle lumière.
(...)
Et maintenant je rentre, riche de ces années
si fraîches que je n'aurais jamais pensé
les retrouver fanées, en mon âme
qui s'en est éloignée, comme il en va pour tout passé.
Je grimpe au long des allées du Janicule, figé
d'un carrefour Liberty à une place plantée d'arbres,
ou à un tronçon de rempart - désormais tout au bout
de la ville face à la plaine onduleuse
qui s'ouvre sur la mer. Et de nouveau, je sens germer
en mon âme inerte et obscure
comme la nuit s'abandonne aux parfums -
une semence désormais trop mûre...
Pier Paolo Pasolini
In Poésies 1953-1964 & Les Cendres de Gramsci.
Traduction José Guidi, Éditions Gallimard
Envoi L'Antre Lieux
je ne savais laquelle : la Justice.
La lumière est toujours pareille à la lumière.
Puis elle changea : de lumière, elle se fit aube incertaine,
une aube qui croissait, qui grandissait
sur les champs du Frioul, sur les canaux.
Elle éclairait les journaliers en lutte.
Ainsi l’aube naissante fut une lumière
en dehors de l’éternité du style…
Dans l’histoire, la justice fut conscience
d’une division humaine des richesses,
et l’espérance prit une nouvelle lumière.
(...)
Et maintenant je rentre, riche de ces années
si fraîches que je n'aurais jamais pensé
les retrouver fanées, en mon âme
qui s'en est éloignée, comme il en va pour tout passé.
Je grimpe au long des allées du Janicule, figé
d'un carrefour Liberty à une place plantée d'arbres,
ou à un tronçon de rempart - désormais tout au bout
de la ville face à la plaine onduleuse
qui s'ouvre sur la mer. Et de nouveau, je sens germer
en mon âme inerte et obscure
comme la nuit s'abandonne aux parfums -
une semence désormais trop mûre...
Pier Paolo Pasolini
In Poésies 1953-1964 & Les Cendres de Gramsci.
Traduction José Guidi, Éditions Gallimard
Envoi L'Antre Lieux
FIN DE LA FORÊT DES SIGNES ET EXTENSION

Photographie Adrienne Arth
FIN DE LA FORÊT DES SIGNES ET EXTENSION
J’ai reçu, durant cette action de LA FORÊT DES SIGNES, une avalanche de poèmes.
Impossible de tous les installer, mais je n’ai pas voulu écarter définitivement cette volée de poèmes qui témoignent, dans leur diversité « forestière », de la vigueur et de la nécessité de la poésie.
La forêt est par définition non domestiquée. S’y côtoient arbres, arbustes et arbrisseaux, rouvres vénérables et jeunes pousses, lianes et mousses, buissons et broussailles, ruine de Rome et sceau de Salomon, sabot de la vierge et pied de mouton, reptiles, insectes, oiseaux, bêtes et bestioles à poils, à écailles et à fourrure dans un fouillis sylvestre de flore et de faune.
Ce fouillis c’est la vie dans son chaos et sa puissance, dont l’épisode de la pandémie nous rappelle que nous ne sommes que partie de son tout et combien elle mérite, en toutes ses formes, égards et considération.
J’ai donc décidé d’ajouter une EXTENSION À LA FORET DES SIGNES pour y accueillir les textes qui n'ont pu trouver place dans la forêt.
Merci à toutes et à tous de votre enthousiaste participation, de votre soutien, de votre gratitude!
Amitiés en poésie !
Et que chacun, chacune trace son chemin à sa guise dans la forêt et son extension…
POUR ACCÉDER A L'EXTENSION DE LA FORÊT DES SIGNES
CLIQUER ICI
FIN DE LA FORÊT DES SIGNES ET EXTENSION
J’ai reçu, durant cette action de LA FORÊT DES SIGNES, une avalanche de poèmes.
Impossible de tous les installer, mais je n’ai pas voulu écarter définitivement cette volée de poèmes qui témoignent, dans leur diversité « forestière », de la vigueur et de la nécessité de la poésie.
La forêt est par définition non domestiquée. S’y côtoient arbres, arbustes et arbrisseaux, rouvres vénérables et jeunes pousses, lianes et mousses, buissons et broussailles, ruine de Rome et sceau de Salomon, sabot de la vierge et pied de mouton, reptiles, insectes, oiseaux, bêtes et bestioles à poils, à écailles et à fourrure dans un fouillis sylvestre de flore et de faune.
Ce fouillis c’est la vie dans son chaos et sa puissance, dont l’épisode de la pandémie nous rappelle que nous ne sommes que partie de son tout et combien elle mérite, en toutes ses formes, égards et considération.
J’ai donc décidé d’ajouter une EXTENSION À LA FORET DES SIGNES pour y accueillir les textes qui n'ont pu trouver place dans la forêt.
Merci à toutes et à tous de votre enthousiaste participation, de votre soutien, de votre gratitude!
Amitiés en poésie !
Et que chacun, chacune trace son chemin à sa guise dans la forêt et son extension…
POUR ACCÉDER A L'EXTENSION DE LA FORÊT DES SIGNES
CLIQUER ICI